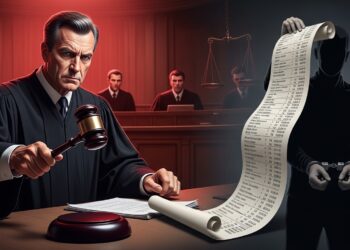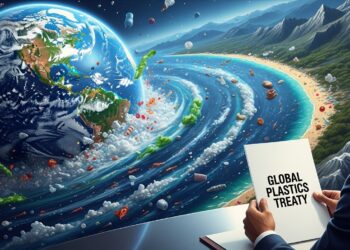Dans les années 1980, le Zimbabwe, fraîchement indépendant, a été le théâtre d’une tragédie qui hante encore ses habitants : le massacre de Gukurahundi. Ce drame, qui a coûté la vie à des dizaines de milliers de personnes, devait enfin être abordé à travers des audiences publiques très attendues. Mais un récent report, annoncé en raison de problèmes logistiques et de menaces judiciaires, soulève des questions sur la volonté réelle de faire la lumière sur cette page sombre de l’histoire. Que se passe-t-il réellement derrière ce retard ?
Gukurahundi : une blessure toujours ouverte
Le terme Gukurahundi, qui signifie « la pluie qui lave tout » en langue shona, désigne une série d’opérations violentes menées dans les années 1980 dans la région du Matabeleland, à l’ouest du Zimbabwe. À l’époque, une unité militaire d’élite, formée à l’étranger, a été déployée pour réprimer ce qui était perçu comme une révolte. Le résultat fut dévastateur : environ 20 000 personnes, principalement des civils, ont perdu la vie, selon des estimations d’organisations comme Amnesty International.
Ces événements, survenus sous la présidence de Robert Mugabe, restent un sujet tabou. Mugabe, décédé en 2019, n’a jamais assumé la responsabilité de ces actes, les qualifiant simplement de « moment de folie ». Aujourd’hui, sous la présidence d’Emmerson Mnangagwa, le Zimbabwe tente d’ouvrir un dialogue sur ce passé douloureux, mais les obstacles s’accumulent.
Un processus retardé : des excuses logistiques
Les audiences villageoises, prévues pour permettre aux survivants de partager leurs témoignages, devaient débuter récemment. Pourtant, elles ont été reportées à la dernière minute. Selon le président du Conseil des chefs, Mtshane Khumalo, ce retard est dû à l’indisponibilité de certains chefs traditionnels, retenus par une cérémonie officielle. « Tout est prêt, à part quelques détails », a-t-il assuré.
Cependant, des voix discordantes se font entendre. Certains chefs, s’exprimant sous couvert d’anonymat, pointent du doigt des problèmes bien plus terre-à-terre : un manque de financement, notamment pour le carburant et les indemnités promises. Ils décrivent une « confusion » autour de l’organisation du programme, révélant des failles dans la préparation de cet événement crucial.
« Tout est prêt, à part quelques détails. »
Mtshane Khumalo, président du Conseil des chefs
Des défis judiciaires et éthiques
Outre les problèmes logistiques, le processus fait face à des obstacles judiciaires. Sibangilizwe Nkomo, fils d’un ancien rival de Mugabe, a saisi la Haute Cour pour bloquer les audiences. Son parti conteste la légitimité des chefs traditionnels à présider ces discussions. Cette action en justice reflète un scepticisme plus large : les chefs, souvent perçus comme politiquement alignés, peuvent-ils garantir une impartialité nécessaire pour traiter un sujet aussi sensible ?
Musa Kika, directeur d’une organisation panafricaine de défense des droits humains, partage ces préoccupations. Selon lui, bien que les chefs aient le droit légal de s’impliquer dans cette affaire, leur objectivité est compromise par leur proximité avec le pouvoir politique. « Ils ne sont pas des arbitres neutres », a-t-il déclaré, mettant en lumière les tensions entre tradition et justice.
« Les chefs sont fortement politisés et ne sont pas des arbitres neutres. »
Musa Kika, expert en droits humains
Un contexte historique complexe
Pour comprendre l’importance de ces audiences, il faut remonter aux années qui ont suivi l’indépendance du Zimbabwe en 1980. Après des décennies de colonisation britannique, le pays était en proie à des tensions internes. Le Matabeleland, région majoritairement peuplée par l’ethnie Ndebele, était perçu comme un foyer de dissidence. En 1983, le gouvernement de Mugabe a lancé une opération militaire d’une brutalité extrême pour étouffer toute opposition.
Cette campagne, menée par une unité formée à l’étranger, a ciblé non seulement les dissidents armés, mais aussi des civils innocents. Villages incendiés, exécutions sommaires, disparitions forcées : les témoignages des survivants dressent un tableau accablant. Pourtant, pendant des décennies, le silence a prévalu, les autorités minimisant ou ignorant ces atrocités.
Pourquoi ces audiences sont cruciales
Les audiences villageoises représentent une tentative de justice transitionnelle, un processus visant à reconnaître les souffrances des victimes et à favoriser la réconciliation. Elles offrent une plateforme pour que les survivants puissent raconter leur histoire, souvent pour la première fois. Mais leur succès dépend de plusieurs facteurs :
- Transparence : Les témoignages doivent être recueillis sans censure ni pression politique.
- Inclusivité : Toutes les communautés affectées, en particulier les Ndebele, doivent se sentir représentées.
- Indépendance : Les chefs doivent agir en tant qu’arbitres impartiaux, malgré les critiques sur leur politisation.
- Suivi : Les audiences doivent déboucher sur des actions concrètes, comme des réparations ou des poursuites judiciaires.
Pour beaucoup, ces audiences sont une lueur d’espoir, mais aussi un test pour la crédibilité du gouvernement actuel. Emmerson Mnangagwa, qui était un haut responsable sous Mugabe à l’époque des massacres, porte une part de responsabilité historique. Sa volonté de faire avancer ce processus est scrutée de près.
Les attentes des survivants
Les survivants du Gukurahundi attendent avant tout une reconnaissance officielle des horreurs qu’ils ont vécues. Pour beaucoup, le simple fait de pouvoir raconter leur histoire publiquement est un pas vers la guérison. Mais ils demandent également des réparations, qu’il s’agisse de compensations financières, de soutien psychologique ou de projets communautaires pour reconstruire les régions dévastées.
Les attentes sont élevées, mais les défis sont nombreux. Les tensions ethniques entre les Shona, majoritaires, et les Ndebele, principales victimes du massacre, restent vives. Toute perception de favoritisme ou de manipulation politique pourrait raviver ces divisions.
Un avenir incertain
Le report des audiences a semé le doute sur la capacité du Zimbabwe à affronter son passé. Les obstacles logistiques, bien que techniques, révèlent des failles dans l’engagement des autorités. Les contestations judiciaires, quant à elles, soulignent un manque de consensus sur la manière de traiter cette tragédie.
Pour que ce processus réussisse, il faudra plus qu’une simple volonté politique. Les chefs traditionnels devront prouver leur impartialité, et le gouvernement devra garantir un cadre transparent et inclusif. Sans cela, les blessures du Gukurahundi risquent de rester ouvertes, alimentant la méfiance et la division.
Le Zimbabwe se trouve à un tournant. Les audiences sur le Gukurahundi pourraient être une opportunité unique de panser les plaies d’une nation. Mais sans une exécution rigoureuse, elles risquent de devenir un simple exercice de façade.
Alors que le pays attend la reprise des audiences, une question demeure : le Zimbabwe est-il prêt à regarder son passé en face, ou ce report n’est-il qu’un symptôme d’une réticence plus profonde ? L’histoire nous le dira.