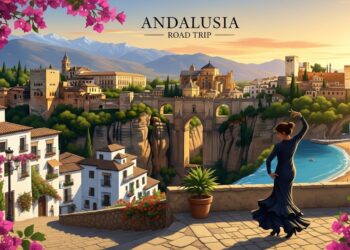Et si le destin de l’industrie européenne se jouait désormais dans les couloirs feutrés de Bruxelles autour d’un simple mot : régulation ? Lundi dernier, les États-Unis ont franchi un cap dans leurs relations commerciales avec l’Union européenne. Leur message est aussi clair que brutal : assouplissez vos lois sur les géants du numérique, ou oubliez toute baisse des droits de douane sur votre acier.
Un chantage assumé au cœur de Bruxelles
Howard Lutnick, secrétaire américain au Commerce, n’a pas mâché ses mots à l’issue d’une réunion à Bruxelles. Pour lui, la balle est dans le camp européen. Il ne s’agit pas d’abandonner complètement les règles, mais de trouver « un équilibre qui nous convienne ». Traduction : un équilibre qui convienne d’abord aux intérêts américains.
Ce discours intervient alors que l’administration actuelle à Washington maintient une pression constante sur les régulations européennes, perçues comme une menace directe pour les champions nationaux du numérique.
Des investissements colossaux brandis comme carotte
Le chiffre avancé par Howard Lutnick a de quoi faire tourner la tête : sept grandes entreprises américaines prévoient chacune d’investir 500 milliards de dollars aux États-Unis pour construire des centres de données. Un total astronomique qui fait rêver n’importe quel responsable économique.
Mais l’argument massue arrive ensuite. Si l’Europe accepte de revoir ses règles, ces géants pourraient délocaliser une partie de ces investissements massifs sur le Vieux Continent. Lutnick parle même d’un millier de milliards de dollars, soit environ un point et demi de croissance supplémentaire pour l’économie européenne.
« Si l’Union européenne réussit à établir des règles numériques équilibrées, je pense qu’elle recevrait 1 000 milliards de dollars d’investissements »
Howard Lutnick, secrétaire américain au Commerce
Cette promesse, aussi alléchante soit-elle, ressemble surtout à une carotte tendue au-dessus de la tête des dirigeants européens.
Le DMA dans le viseur américain
Au centre des critiques : le Digital Markets Act, ce règlement européen entré en vigueur qui impose de lourdes contraintes aux grandes plateformes. Pour Jamieson Greer, représentant américain au Commerce, les seuils fixés par ce texte visent presque exclusivement les entreprises américaines.
Et l’application ne fait pas dans la dentelle. Les amendes prévues peuvent atteindre des montants vertigineux, jusqu’à plusieurs milliards d’euros. Un montant qui, selon Washington, décourage toute forme d’investissement et d’innovation.
Le message est clair : ces règles ne sont pas seulement contraignantes, elles sont considérées comme discriminatoires par nature.
La réponse européenne : « Nos règles ne sont pas discriminatoires »
Face à ces accusations, la réplique européenne ne s’est pas fait attendre. Maros Sefcovic, commissaire européen au Commerce, a tenu à rappeler un principe fondamental : les règles mises en place s’appliquent de manière équitable à toutes les entreprises, quelle que soit leur nationalité.
Un porte-parole de la Commission européenne a complété cette position en soulignant que ces régulations ne concernent que le marché intérieur européen. Elles ne visent personne en particulier et ne constituent en aucun cas une attaque ciblée contre les sociétés américaines.
Pour Bruxelles, il s’agit avant tout de protéger les consommateurs et de garantir une concurrence loyale sur son territoire.
Un accord commercial en toile de fond
Cette passe d’armes intervient dans un contexte particulier. Cet été, un accord commercial a été conclu entre les États-Unis et l’Union européenne. La rencontre de Bruxelles avait justement pour objectif de faire un point d’étape sur sa mise en œuvre.
Mais très vite, les discussions ont dévié sur ce sujet brûlant de la régulation numérique. Ce qui devait être une simple réunion technique s’est transformée en véritable bras de fer diplomatique.
L’acier et l’aluminium européens restent soumis à des droits de douane élevés outre-Atlantique. Et tant que la question numérique ne sera pas réglée à la satisfaction américaine, aucune avancée notable n’est à attendre sur ce front.
L’enjeu caché : la souveraineté numérique européenne
Au-delà des chiffres et des menaces à peine voilées, c’est toute la question de la souveraineté numérique qui se pose. L’Europe a fait le choix, ces dernières années, de se doter d’un arsenal réglementaire puissant pour encadrer les géants du numérique.
Ce choix n’est pas anodin. Il répond à une volonté claire de ne plus subir la loi des plateformes américaines et de protéger ses citoyens contre les abus de position dominante. Le DMA, le DSA, le règlement sur les données… autant d’outils qui forment aujourd’hui le socle de cette ambition européenne.
Mais ce projet se heurte désormais à une réalité brutale : les États-Unis sont prêts à utiliser tous les leviers à leur disposition pour le faire plier.
Que pèsent vraiment ces investissements promis ?
Le millier de milliards brandi par Howard Lutnick fait rêver. Mais plusieurs questions se posent. Ces investissements sont-ils réellement conditionnés à un assouplissement des règles ? Ou s’agit-il surtout d’une promesse en l’air destinée à faire plier Bruxelles ?
Dans le domaine de l’intelligence artificielle et des centres de données, les besoins en énergie, en foncier et en sécurité juridique sont immenses. L’Europe dispose d’atouts indéniables : un marché de 450 millions de consommateurs, des infrastructures de qualité, une main-d’œuvre qualifiée.
Mais elle souffre aussi de handicaps : coûts énergétiques élevés, bureaucratie parfois lourde, et maintenant cette pression politique directe venue de Washington.
Vers une guerre commerciale 2.0 ?
Ce bras de fer n’est pas isolé. Il s’inscrit dans une longue série de tensions commerciales entre les deux rives de l’Atlantique. Des taxes sur l’acier à celles sur le numérique, en passant par les subventions aux semi-conducteurs, chaque camp défend farouchement ses intérêts.
La particularité cette fois-ci ? Le numérique est devenu le nerf de la guerre. Celui qui contrôlera les infrastructures de demain contrôlera aussi une large partie de l’économie mondiale.
Et dans ce domaine, l’Europe a choisi de ne plus être simple spectatrice. Quitte à s’attirer les foudres de son principal allié.
Les prochaines étapes de cette négociation à haut risque
Les prochains mois s’annoncent décisifs. L’Union européenne va-t-elle maintenir le cap et défendre bec et ongles sa régulation ? Ou va-t-elle accepter certains aménagements pour préserver ses exportations d’acier et attirer des investissements massifs ?
Une chose est sûre : la pression américaine ne va pas faiblir. Et chaque décision prise à Bruxelles aura des conséquences qui dépasseront largement le cadre commercial pour toucher à l’avenir même du projet européen dans le numérique.
Le vieux continent se trouve aujourd’hui à la croisée des chemins. Entre souveraineté et pragmatisme économique, le choix s’annonce cornélien.
À retenir : Les États-Unis lient explicitement la baisse des taxes sur l’acier européen à un assouplissement des règles numériques. Un millier de milliards d’investissements en IA sont mis dans la balance. L’Europe doit maintenant choisir entre ses ambitions de souveraineté numérique et des gains économiques immédiats.
Une chose est certaine : cette négociation va marquer durablement les relations transatlantiques. Et peut-être redessiner complètement la carte du pouvoir technologique mondial.