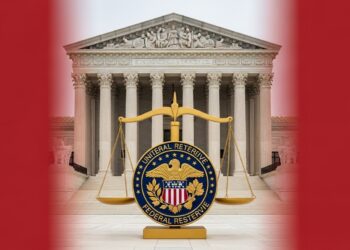Imaginez un monde où des millions de personnes dépendent d’une aide internationale pour survivre, et soudain, cette aide s’effondre. C’est la réalité que l’administration de Donald Trump a instaurée en 2025, avec des coupes massives dans les financements internationaux. Pourtant, dans un revirement inattendu, deux grandes organisations basées à Genève, l’Organisation mondiale du commerce (OMC) et l’Organisation internationale du travail (OIT), ont été retirées de la liste des entités visées par ces réductions. Que signifie ce changement, et quelles sont les répercussions pour les pays les plus vulnérables ? Cet article explore les dessous de cette décision, ses implications pour le développement mondial et les défis à venir.
Un virage radical dans la politique d’aide internationale
Depuis son retour à la présidence en janvier 2025, Donald Trump a marqué un tournant décisif dans la politique étrangère des États-Unis. Son administration a gelé des milliards de dollars destinés à l’aide internationale, arguant que ces dépenses sont souvent inutiles ou mal alignées avec les priorités nationales. Le 29 août 2025, une nouvelle vague de suppressions budgétaires a été annoncée, ciblant environ 5 milliards de dollars de fonds alloués à des programmes internationaux. Cette décision, portée par une volonté de réduire les dépenses publiques, a suscité des débats houleux, tant aux États-Unis qu’à l’échelle mondiale.
Le démantèlement de l’Agence américaine pour le développement international (USAID), absorbée par le département d’État, a été l’un des gestes les plus marquants de cette politique. Cette agence, jadis pilier de l’aide humanitaire mondiale, soutenait des programmes dans près de 120 pays. Sa disparition a laissé un vide immense, mettant en péril des initiatives vitales pour des millions de personnes. Mais dans ce contexte, l’exemption récente de l’OMC et de l’OIT soulève des questions : pourquoi ces deux organisations ont-elles été épargnées, et quelles leçons tirer de cette décision ?
L’OMC et l’OIT échappent aux coupes : une surprise inattendue
L’Organisation mondiale du commerce et l’Organisation internationale du travail, toutes deux basées à Genève, ont confirmé ne plus figurer sur la liste des organisations visées par les coupes budgétaires américaines. Cette annonce, faite le 29 août 2025, a surpris les observateurs, car ces deux entités étaient initialement mentionnées dans un document de la Maison Blanche. Ce revirement pourrait refléter une réévaluation stratégique des priorités de l’administration Trump, mais il reste entouré d’incertitudes.
Nous cherchons à obtenir davantage d’informations sur ce que ce dernier développement signifie pour l’OIT.
Porte-parole de l’OIT
L’OMC, qui joue un rôle clé dans la régulation du commerce mondial, reçoit une contribution significative des États-Unis, représentant 11,37 % de son budget total pour 2025, soit environ 28,5 millions de dollars. De son côté, l’OIT, qui promeut les droits des travailleurs et les normes du travail, dépendait jusqu’à récemment des fonds américains pour 22 % de son financement. La décision de préserver ces contributions, du moins pour l’instant, pourrait indiquer une reconnaissance de leur importance stratégique pour les intérêts économiques et sociaux des États-Unis.
Fait marquant : Les États-Unis restent le principal contributeur au budget de l’OMC, légèrement devant la Chine, avec une part de 11,33 %.
Les impacts des coupes précédentes : un bilan alarmant
Avant ce revirement, les coupes budgétaires américaines ont eu des conséquences dramatiques. La suppression de 83 % des financements de l’USAID a entraîné l’arrêt de milliers de projets à travers le monde. Par exemple, des programmes de santé, d’éducation et de lutte contre la pauvreté dans les pays à faible revenu ont été brutalement interrompus. Une étude publiée en juillet 2025 a estimé que ces réductions pourraient causer plus de 14 millions de décès supplémentaires d’ici 2030, dont un tiers d’enfants de moins de 5 ans.
Pour l’OIT, les premières coupes ont conduit à la fermeture de la majorité des projets financés par les États-Unis. Sur les 229 employés travaillant sur ces initiatives, 190 ont initialement reçu des lettres de licenciement. Heureusement, 92 d’entre eux ont été réaffectés à d’autres programmes, mais cette situation illustre la précarité créée par ces décisions. Les pays en développement, qui dépendent fortement de l’aide internationale, se retrouvent désormais face à des défis colossaux pour maintenir leurs systèmes de santé et leurs infrastructures sociales.
Pourquoi l’OMC et l’OIT ont-elles été épargnées ?
La décision de retirer l’OMC et l’OIT de la liste des coupes pourrait répondre à plusieurs logiques. D’une part, l’OMC joue un rôle crucial dans la facilitation du commerce international, un domaine où les États-Unis cherchent à maintenir leur influence face à des concurrents comme la Chine. Réduire son financement aurait pu affaiblir la position américaine dans les négociations commerciales mondiales. D’autre part, l’OIT, en promouvant des normes de travail équitables, soutient des valeurs qui peuvent être alignées avec les priorités économiques de l’administration Trump, notamment en matière de compétitivité.
Cette exemption pourrait également refléter une pression internationale croissante. De nombreux pays et organisations ont critiqué les coupes américaines, soulignant leurs conséquences humanitaires. En épargnant l’OMC et l’OIT, l’administration pourrait chercher à apaiser ces tensions tout en poursuivant sa politique de réduction des dépenses jugées non essentielles.
| Organisation | Contribution US 2025 | Part du budget total |
|---|---|---|
| OMC | 28,5 millions de dollars | 11,37 % |
| OIT | 22 % du financement | Non précisé |
Un risque de paralysie budgétaire aux États-Unis
La demande de suppression de 4,9 milliards de dollars d’aide internationale, annoncée le 29 août, a également ravivé les tensions au sein du Congrès américain. Les démocrates ont averti que toute tentative de contourner les fonds déjà approuvés par le Congrès pourrait compromettre les négociations visant à éviter une paralysie budgétaire, ou shutdown, d’ici la fin septembre 2025. Ce scénario, qui entraînerait la mise au chômage technique de milliers de fonctionnaires et des perturbations dans les services publics, est un risque majeur pour l’économie américaine.
La Constitution américaine confère au Congrès le pouvoir exclusif d’allouer les fonds publics. Ainsi, pour que ces coupes soient validées, l’administration Trump doit obtenir l’approbation des deux chambres, où les républicains détiennent la majorité. Cependant, le calendrier serré – avec une échéance fixée au 30 septembre – rend cette approbation incertaine, augmentant les risques d’un blocage budgétaire.
Toute tentative de révoquer des fonds alloués sans l’approbation du Congrès est une violation claire de la loi.
Sénatrice républicaine modérée
Les répercussions sur les pays en développement
Les coupes dans l’aide internationale ont déjà des conséquences concrètes pour les pays les plus vulnérables. Les programmes de santé, notamment ceux luttant contre le VIH, le paludisme et la tuberculose, sont particulièrement touchés. Selon l’Organisation mondiale de la santé, la réduction des financements américains pourrait entraîner 15 millions de cas supplémentaires de paludisme et 107 000 décès dès 2025. De même, les initiatives de prévention de la tuberculose dans 27 pays d’Afrique et d’Asie sont en crise, avec des pénuries de médicaments signalées dans neuf pays.
En Afrique, où l’aide internationale joue un rôle crucial, des pays comme le Ghana tentent de s’adapter en augmentant leurs budgets nationaux pour la santé. Cependant, pour beaucoup d’autres, la dépendance aux financements étrangers reste un obstacle majeur à l’autonomie. Les coupes américaines pourraient forcer ces nations à se tourner vers des prêts coûteux, aggravant leur endettement et limitant leurs investissements dans des secteurs clés comme l’éducation ou les infrastructures.
- VIH : Risque de 10 millions de cas supplémentaires et 3 millions de décès d’ici 2030.
- Paludisme : 15 millions de cas et 107 000 décès supplémentaires dès 2025.
- Tuberculose : Effondrement des chaînes de prévention dans 27 pays.
Une opportunité pour repenser l’aide internationale ?
Face à cette crise, certains experts y voient une occasion de repenser le modèle de l’aide internationale. Le chef de l’OMS a appelé les pays en développement à renforcer leur autonomie en augmentant leurs dépenses nationales en santé. Des initiatives comme celle du Ghana, qui a relevé son budget d’assurance maladie de 60 % en 2025, montrent qu’une transition vers plus d’indépendance est possible. Cependant, cette transition exige du temps et des ressources, deux éléments qui font cruellement défaut dans les contextes les plus fragiles.
Par ailleurs, d’autres donateurs internationaux, comme l’Union européenne ou la France, ont également réduit leurs budgets d’aide au développement. L’UE prévoit une diminution de 35 % de ses fonds pour les pays les plus pauvres d’ici 2027, tandis que la France a amputé son aide de 800 millions d’euros en 2024. Cette tendance mondiale complique encore davantage la situation pour les pays dépendants de l’aide extérieure.
Quel avenir pour l’aide internationale ?
La décision de préserver le financement de l’OMC et de l’OIT est un signal positif, mais elle ne compense pas l’ampleur des coupes déjà réalisées. Les organisations internationales, les ONG et les pays bénéficiaires doivent désormais s’adapter à un paysage de financement radicalement transformé. Pour l’OIT, la réaffectation de 92 employés montre une certaine résilience, mais pour combien de temps ? Les contributions américaines pour 2024 et 2025 à ces deux organisations restent en suspens, et des retards de paiement pourraient encore fragiliser leur fonctionnement.
À l’échelle mondiale, les coupes américaines pourraient redessiner les dynamiques de pouvoir. En se retirant partiellement de l’arène humanitaire, les États-Unis laissent un vide que d’autres puissances, comme la Chine, pourraient chercher à combler. Cela pourrait également pousser les pays en développement à diversifier leurs partenariats, mais à quel coût ?
Enjeu clé : La réduction de l’aide internationale pourrait redéfinir les équilibres géopolitiques, avec des implications pour la sécurité mondiale.
Conclusion : un équilibre précaire
Les coupes budgétaires de l’administration Trump dans l’aide internationale marquent un tournant historique, avec des conséquences potentiellement dévastatrices pour les populations vulnérables. Si l’OMC et l’OIT ont été épargnées pour l’instant, l’avenir de l’aide mondiale reste incertain. Entre risques de paralysie budgétaire aux États-Unis et défis humanitaires croissants, le monde observe avec appréhension. Une chose est sûre : repenser l’aide internationale nécessitera une coopération mondiale renforcée et des solutions innovantes pour protéger les plus fragiles.
Quelles seront les prochaines étapes ? La communauté internationale parviendra-t-elle à compenser ce recul ? Les réponses à ces questions détermineront l’avenir de millions de vies.