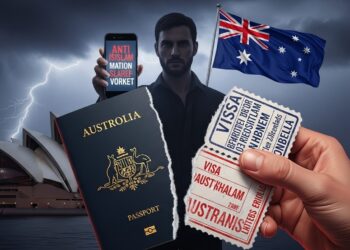Imaginez un instant : deux des leaders les plus puissants du monde, face à face dans une ville portuaire sud-coréenne, prêts à remodeler les relations économiques mondiales. Ce jeudi, la rencontre entre le président américain Donald Trump et son homologue chinois Xi Jinping à Busan pourrait marquer un tournant dans la guerre commerciale qui secoue les deux superpuissances depuis des mois. Alors que les tensions économiques et géopolitiques ont atteint des sommets, cet échange suscite autant d’espoir que d’incertitude. Que peut-on attendre de ce sommet ? Une trêve durable ou une simple pause dans un conflit bien plus profond ?
Un sommet sous haute tension à Busan
La ville de Busan, avec son port animé et son rôle central dans le commerce asiatique, sert de toile de fond à cette rencontre historique. Prévue pour commencer à 11h00 heure locale, la discussion entre Trump et Xi Jinping est entourée d’un optimisme prudent, alimenté par des négociations préalables qui ont abouti à un cadre d’accord. Ce sommet, qui intervient en marge du forum de l’APEC (Coopération économique pour l’Asie-Pacifique), est le premier face-à-face entre les deux leaders depuis 2019. Mais si les enjeux sont clairs, les résultats restent incertains, surtout avec la réputation de Trump pour ses revirements imprévisibles.
Depuis son retour à la Maison Blanche en janvier 2025, Trump a relancé une politique protectionniste agressive, marquée par des tarifs douaniers imposés à de nombreux pays, dont la Chine. Cette stratégie, ancrée dans son slogan America First, a exacerbé les tensions avec Pékin, qui a répondu par des restrictions sur les exportations de terres rares, des matériaux cruciaux pour les industries technologiques et militaires. Ce bras de fer économique a des répercussions mondiales, affectant les chaînes d’approvisionnement et les marchés financiers.
Les enjeux majeurs du sommet
Le sommet de Busan ne se limite pas à une simple poignée de main diplomatique. Les discussions portent sur des sujets brûlants, chacun avec des implications profondes pour les deux nations et au-delà. Voici les principaux points à l’ordre du jour :
- Tarifs douaniers : Trump a imposé des droits de douane sur les importations chinoises, notamment en lien avec le fentanyl, une drogue responsable de nombreuses overdoses aux États-Unis. Une réduction de ces tarifs pourrait être envisagée en échange de concessions chinoises.
- Terres rares : La Chine, qui domine 60 % de la production mondiale de ces minerais essentiels, a restreint leurs exportations en octobre 2025, provoquant l’ire de Trump. Un assouplissement de ces restrictions est au cœur des négociations.
- Agriculture et soja : Les agriculteurs américains, en particulier les producteurs de soja, souffrent de l’arrêt des achats chinois. Un retour de Pékin sur ce marché pourrait apaiser les tensions internes aux États-Unis.
- Fentanyl : Trump accuse la Chine de contribuer à l’épidémie de fentanyl via l’exportation de produits chimiques. Un engagement de Pékin pour limiter ces flux pourrait être un point clé de l’accord.
- TikTok : L’application chinoise, menacée d’interdiction aux États-Unis, pourrait voir son sort scellé lors de ce sommet, avec un possible accord sur sa cession.
Ces sujets, bien que techniques, touchent des millions de vies. Des agriculteurs du Midwest américain aux industriels des hautes technologies, tous scrutent l’issue de cette rencontre. Comme l’a souligné un expert en relations internationales :
Nombreux sont ceux qui voient dans cette rencontre un cessez-le-feu, un apaisement des tensions entre les deux parties.
Tai Wei Lim, expert de l’Asie orientale
Un historique de tensions et de revirements
Trump et Xi Jinping ne sont pas des inconnus l’un pour l’autre. Au cours du premier mandat de Trump, entre 2017 et 2021, ils se sont rencontrés à cinq reprises, notamment lors du sommet du G20 à Osaka en 2019. À l’époque, leurs discussions avaient également porté sur le commerce, mais les résultats étaient restés mitigés, marqués par des promesses non tenues et des escalades tarifaires. Depuis, la rivalité sino-américaine s’est intensifiée, alimentée par des différends sur la technologie, la géopolitique et les droits humains.
En septembre 2025, une lueur d’espoir avait émergé après une conversation téléphonique qualifiée de productive par Trump. Mais les tensions ont rapidement repris avec la décision chinoise de limiter les exportations de terres rares, perçue comme une réponse aux sanctions américaines sur les semi-conducteurs. Trump, fidèle à son style, avait alors menacé de surtaxes massives avant de se montrer plus conciliant, illustrant une fois de plus son approche imprévisible.
| Période | Événement clé | Impact |
|---|---|---|
| 2017-2019 | Rencontres Trump-Xi | Tentatives de trêve commerciale, résultats limités |
| Janvier 2025 | Retour de Trump et tarifs mondiaux | Escalade des tensions économiques |
| Octobre 2025 | Restrictions chinoises sur les terres rares | Menaces de surtaxes américaines |
Les terres rares : une arme stratégique
Les terres rares sont au cœur des discussions, et pour cause : la Chine contrôle environ 60 % de la production mondiale et 90 % des capacités de raffinage de ces minerais indispensables à la fabrication de smartphones, de véhicules électriques et d’équipements militaires. En octobre 2025, Pékin a renforcé ses restrictions sur ces exportations, une décision perçue comme une riposte aux restrictions américaines sur les semi-conducteurs. Cette manœuvre a mis en lumière la dépendance mondiale envers la Chine pour ces ressources stratégiques.
Pour les États-Unis, ces restrictions menacent le grand projet de réindustrialisation porté par Trump, qui vise à relocaliser la production de technologies clés. En échange d’un assouplissement des restrictions chinoises, Washington pourrait réduire les tarifs douaniers, notamment ceux liés à l’épidémie de fentanyl, qui fait des ravages aux États-Unis. Cette drogue, dont les précurseurs chimiques proviennent souvent de Chine, est un sujet politiquement sensible pour Trump, qui en a fait une priorité.
Le soja : un levier pour les agriculteurs américains
Les agriculteurs américains, particulièrement ceux du Midwest, sont parmi les plus affectés par la guerre commerciale. La Chine, qui représentait la moitié des exportations de soja américain en 2024 (environ 24 milliards de dollars), a cessé ses achats en septembre 2025, se tournant vers le Brésil et l’Argentine. Cette décision a mis sous pression les producteurs américains, qui espèrent un retour de Pékin sur le marché.
Selon le secrétaire au Trésor américain, un accord pourrait inclure une reprise substantielle des achats de soja, offrant un soulagement aux agriculteurs et renforçant la position de Trump sur le plan intérieur. Ce point illustre comment les négociations commerciales internationales peuvent avoir des répercussions directes sur des communautés locales, loin des salles de réunion de Busan.
TikTok et fentanyl : des dossiers brûlants
Outre les terres rares et le soja, deux autres sujets dominent l’agenda : TikTok et le fentanyl. L’application chinoise, propriété de ByteDance, est sous le feu des projecteurs aux États-Unis, où elle risque une interdiction si ses propriétaires ne cèdent pas leurs activités américaines. Trump a laissé entendre qu’un accord sur ce dossier pourrait être finalisé à Busan, ce qui serait une victoire symbolique pour son administration.
Quant au fentanyl, Trump a fait de la lutte contre cette drogue une priorité, accusant la Chine de ne pas en faire assez pour limiter l’exportation de produits chimiques utilisés dans sa fabrication. Un engagement clair de Pékin pourrait permettre une réduction des tarifs douaniers, offrant une issue à ce dossier épineux.
Taïwan : la question en filigrane
Si le commerce domine l’agenda, un sujet plus sensible pourrait émerger : Taïwan. La Chine revendique l’île comme partie intégrante de son territoire, tandis que les États-Unis, tout en reconnaissant officiellement Pékin depuis 1979, restent le principal allié de Taipei et son fournisseur d’armes. Trump, interrogé sur ce point, a répondu de manière énigmatique : Taïwan, c’est Taïwan. Cette ambiguïté alimente les spéculations sur d’éventuelles discussions à ce sujet, bien que les analystes estiment qu’aucune concession majeure n’est probable.
L’idée que Trump abandonnerait Taïwan pour un grand bargain avec Pékin est un fantasme des think-tanks de Washington.
Un ancien responsable de la Maison Blanche
Un contexte géopolitique tendu
Le sommet de Busan s’inscrit dans un contexte géopolitique complexe. Trump a critiqué les liens entre la Chine et la Russie, notamment les achats de pétrole russe par Pékin en pleine guerre en Ukraine. De son côté, la Chine cherche à consolider son influence auprès des pays émergents, ce qui agace Washington. Ces tensions stratégiques, combinées aux différends économiques, rendent un accord global peu probable, mais une trêve pourrait apaiser les marchés mondiaux.
La tournée asiatique de Trump, qui l’a conduit en Malaisie, au Japon et en Corée du Sud, a été marquée par des accords commerciaux et des promesses d’investissements massifs. À Busan, il conclut ce périple avec une rencontre qui pourrait redéfinir les relations sino-américaines pour les mois à venir.
Perspectives et incertitudes
Si les négociateurs des deux camps ont posé les bases d’un accord, rien n’est garanti. Trump, connu pour son style imprévisible, pourrait changer de ton au dernier moment, comme il l’a fait par le passé. Xi Jinping, quant à lui, adopte une posture confiante, renforcée par la position dominante de la Chine sur les terres rares et son influence croissante en Asie.
Pour les observateurs, ce sommet pourrait aboutir à des petites victoires : une pause dans l’escalade des tarifs, un engagement sur le soja ou une solution pour TikTok. Mais les différends structurels, qu’ils soient économiques ou géopolitiques, ne disparaîtront pas de sitôt. Comme le résume un analyste :
Ce sommet ne mettra pas fin à la rivalité, mais il marque une nouvelle phase dans les relations sino-américaines.
Un expert en commerce international
En attendant les résultats, le monde retient son souffle. Les décisions prises à Busan pourraient avoir des répercussions sur les prix à la consommation, les emplois et les relations internationales pour les années à venir. Une chose est sûre : cette rencontre entre Trump et Xi Jinping restera un moment clé de 2025, qu’elle aboutisse à une trêve ou à de nouvelles tensions.