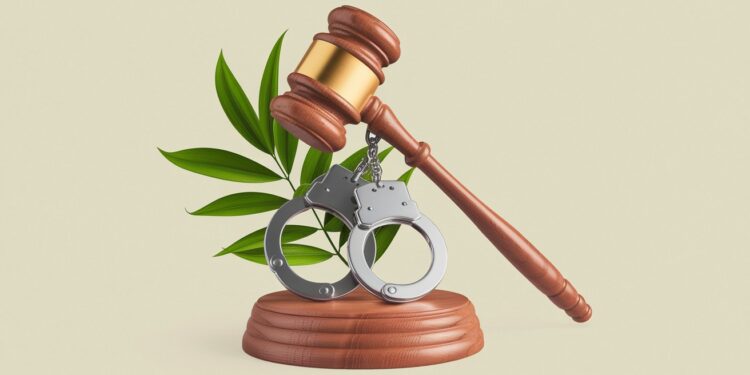Le procès de neuf militants écologistes pour des dégradations commises en décembre dernier sur le site du cimentier Lafarge dans l’Eure vient de s’achever. Quatre d’entre eux ont été condamnés vendredi à des peines allant de 6 à 10 mois de prison avec sursis. Une décision qui ne manque pas de faire réagir dans un contexte de montée des préoccupations environnementales.
Une action coup de poing contre le cimentier Lafarge
Le 10 décembre 2023, une centaine de militants écologistes cagoulés et masqués avaient investi le site industriel de Lafarge à Évreux. Leur objectif : dénoncer les activités polluantes du géant du ciment à travers une opération commando spectaculaire. Sur place, ils avaient provoqué d’importantes dégradations, estimées à plus de 450 000 euros par l’entreprise. Un vigile avait également été brièvement séquestré dans son local.
Neuf militants impliqués dans cette action d’éclat étaient jugés depuis jeudi devant le tribunal correctionnel d’Évreux pour association de malfaiteurs, dégradations et séquestration. Ils encouraient jusqu’à 10 ans de prison, notamment pour la séquestration du vigile, un délit finalement écarté par le tribunal.
Le difficile équilibre entre militantisme et légalité
Pour le procureur Rémi Coutin, il ne s’agit pas « d’écoterroristes » mais de « personnes engagées », dont l’engagement a cependant « franchi les limites de la loi ». Il avait requis une peine « symbolique » de six mois de prison avec sursis.
Ce serait malhonnête de dire que la cause pour laquelle ils militent n’est pas légitime et parfaitement respectable.
Rémi Coutin, procureur
Au final, quatre prévenus ont été condamnés à des peines de 6 à 10 mois de prison avec sursis. Les cinq autres ont été relaxés, dont trois devront néanmoins payer une amende de 400 euros pour refus de prélèvements.
La répression des militants écologistes en question
Pour les avocats de la défense, ce procès pose la question de la criminalisation des militants écologistes. Me Chloé Chalot a ainsi dénoncé un dossier bâti sur de « très nombreuses irrégularités de procédure » et des preuves fragiles, affirmant qu’on était « que dans le registre de la suspicion ».
Plus largement, ce procès illustre la tension grandissante entre la montée de l’urgence climatique dans l’opinion et une certaine fermeté judiciaire face aux actions coup de poing des activistes. Un équilibre délicat dans un contexte de mobilisation croissante de la jeunesse pour le climat.
Lafarge, un groupe cimentier régulièrement ciblé
Les militants visaient spécifiquement le groupe Lafarge, numéro un mondial des matériaux de construction. Ce géant français est régulièrement critiqué par les ONG environnementales pour son impact carbone important. Le secteur du ciment est en effet l’un des plus émetteurs de CO2 au monde.
Ces dernières années, Lafarge a fait l’objet de plusieurs actions de désobéissance civile de la part de militants écologistes :
- Occupation de sites en France et en Europe
- Blocage et dégradation de cimenteries
- Actions contre les carrières et les infrastructures du groupe
L’entreprise affirme être engagée dans une démarche de décarbonation, mais ces efforts sont jugés très insuffisants par les ONG. Avec la pression croissante sur l’industrie lourde pour réduire son empreinte environnementale, Lafarge risque de rester une cible privilégiée des activistes.
Quel avenir pour le militantisme écologiste ?
Ce procès pose la question des limites de la désobéissance civile face à l’urgence climatique. Si la lutte contre le réchauffement fait désormais consensus, les moyens d’actions des militants restent source de vifs débats. Entre des activistes qui se radicalisent et une réponse sécuritaire qui se durcit, la voie d’un dialogue apaisé semble étroite.
Pourtant, l’accélération du dérèglement climatique pousse de plus en plus de citoyens, notamment les jeunes, à un engagement fort. Les marches pour le climat ont rassemblé ces dernières années des millions de personnes à travers le monde. Un mouvement qui ne risque pas de faiblir et qui continuera à interpeller les pouvoirs publics et les grands groupes comme Lafarge sur leur responsabilité environnementale et sociale.
Dans ce contexte, la justice se retrouve en première ligne. Entre nécessaire sanction des délits et compréhension des motivations des militants, l’équilibre est plus que jamais subtil à trouver. L’avenir nous dira si la voie d’un dialogue constructif entre activistes, entreprises et institutions est possible. Une chose est sûre : la question écologique est devenue centrale et elle continuera à redéfinir nos modes d’actions et nos cadres juridiques dans les années à venir.