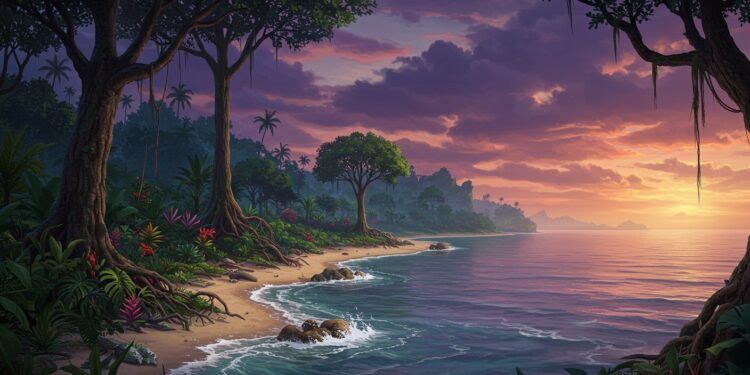Imaginez un instant : un lever de soleil éclatant sur les Caraïbes panaméennes, tandis que la nuit enveloppe encore les îles Fidji, à des milliers de kilomètres de là. Pourtant, cette semaine, ces deux mondes éloignés se sont rejoints au cœur du Brésil, portés par une cause commune qui transcende les océans. Des leaders indigènes, venus des confins du Pacifique et des Amériques, se sont rassemblés pour un cri d’alarme face à une menace invisible mais implacable : le réchauffement climatique. À quelques mois de la COP30, cette union inattendue pourrait bien changer la donne.
Une Alliance Historique pour la Planète
Chaque année, le rassemblement Terre libre au Brésil donne la parole aux peuples autochtones d’Amérique. Mais en 2025, l’événement prend une ampleur inédite. Des délégations d’Australie, de Papouasie-Nouvelle-Guinée, des Samoa et des Fidji ont traversé le globe pour se joindre à leurs homologues sud-américains. Pourquoi ce déplacement massif ? La réponse tient en un mot : urgence. Avec la conférence de l’ONU sur le climat, prévue du 10 au 21 novembre à Belém, au nord du pays, les enjeux n’ont jamais été aussi élevés.
Un voyage au bout du monde
Pour certains, rejoindre Brasilia a été une véritable épopée. Prenez l’exemple d’un leader du peuple iTaukei, originaire des Fidji. Parti de chez lui un vendredi, il n’a posé le pied au Brésil que le dimanche, après trois escales et des heures de vol harassantes. « C’était épuisant, mais nécessaire », confie-t-il à une source proche. À 39 ans, cet homme au charisme naturel incarne la détermination de ceux qui refusent de voir leur terre engloutie par les eaux ou ravagée par l’exploitation pétrolière.
Nous vivons dans les îles, nous menons le même combat.
– Un leader indigène des Caraïbes panaméennes
Cette phrase résonne comme un écho entre les archipels. À 11 000 kilomètres de distance, les défis se ressemblent : montée des eaux, érosion des terres, disparition des ressources. Dans le nord-est du Panama, une île entière a dû être évacuée l’an dernier, forçant plus de 1 200 habitants à abandonner leurs foyers. Un destin que les Fidjiens connaissent bien, eux qui voient l’eau salée envahir leurs cultures année après année.
La montée des eaux, un ennemi commun
Le réchauffement climatique n’épargne personne, mais il frappe plus durement ceux qui vivent au plus près de la nature. Dans le Pacifique, une jeune femme de 37 ans, membre d’une délégation fidjienne, raconte comment l’océan grignote peu à peu les terres agricoles. « L’eau salée entre là où nous plantons notre nourriture », explique-t-elle avec une pointe d’amertume. Ce phénomène, lié à la fonte des glaces et à l’élévation du niveau des mers, menace directement la survie de ces communautés.
Du côté des Caraïbes, le tableau est tout aussi sombre. Dans un archipel du Panama, devenu célèbre grâce à une série espagnole bien connue, les habitants assistent impuissants à la submersion de leurs îles. La montée des eaux n’est plus une hypothèse lointaine : elle est là, palpable, et elle redessine les cartes des territoires ancestraux.
- 1 200 personnes évacuées dans le Panama en 2024.
- Des cultures inondées par l’eau salée aux Fidji.
- Une menace mondiale qui touche d’abord les plus vulnérables.
Un message politique fort
Ce rassemblement ne se limite pas à un cri de désespoir. Jeudi, des milliers d’autochtones marcheront jusqu’à la place des Trois-Pouvoirs, au cœur de la capitale brésilienne, pour interpeller les dirigeants. Leur revendication ? Que la présidence de la COP30, confiée au Brésil, prenne des mesures concrètes, notamment en s’opposant aux nouveaux projets pétroliers près de l’embouchure de l’Amazone. Une exigence qui fait écho à la décision prise lors de la COP28 d’abandonner progressivement les énergies fossiles.
Mais les attentes vont plus loin. Ces leaders exigent une place à la table des négociations, au même titre que les chefs d’État. « Nous sommes la Terre », clame une représentante australienne du peuple Yuin, dénonçant le *fracking* et l’exploitation minière qui « rendent nos pays malades ». Une position radicale, mais partagée par l’ensemble des participants.
Les gardiens de la nature
Les experts s’accordent à dire que les communautés autochtones jouent un rôle crucial dans la lutte contre le changement climatique. En Amazonie, elles freinent la déforestation, protégeant ainsi l’un des poumons verts de la planète. Dans le Pacifique, elles préservent des écosystèmes fragiles face à l’avidité industrielle. Leur savoir ancestral, souvent ignoré, pourrait pourtant inspirer des solutions globales.
| Région | Menace principale | Action |
| Pacifique | Montée des eaux | Protection des terres |
| Amazonie | Déforestation | Résistance aux projets pétroliers |
| Caraïbes | Submersion | Évacuation et sensibilisation |
Ce tableau illustre une réalité : chaque région a ses combats, mais tous convergent vers un même objectif. Ces peuples ne se contentent pas de subir ; ils agissent, souvent au prix de sacrifices immenses.
Une solidarité transcontinentale
Pour un coordinateur de l’Association des peuples indigènes du Brésil, cette rencontre marque le début d’une collaboration durable. Avec l’Australie et plusieurs îles du Pacifique candidates pour accueillir la COP31 en 2026, l’idée est de construire une continuité dans les revendications environnementales. « Nous voulons peser d’une année sur l’autre », explique cet avocat de formation, soulignant l’importance d’une voix unifiée.
Cette solidarité rappelle d’autres événements culturels, comme un grand festival du Pacifique tenu à Hawaï l’an dernier. Mais ici, l’accent est mis sur l’action politique plutôt que sur la célébration. « Chez nous, on montre nos valeurs ; ici, on lutte pour elles », résume un leader fidjien.
Un avenir incertain
À quelques mois de la COP30, les regards sont tournés vers le Brésil. La présidence de la conférence esquive pour l’instant les sujets brûlants, comme l’exploitation pétrolière, qui ont divisé les éditions précédentes. Mais les autochtones, eux, ne comptent pas se taire. Leur présence massive à Brasilia envoie un message clair : ils ne laisseront pas leur avenir se décider sans eux.
Entre espoirs et défis, cette alliance historique pourrait bien redéfinir les priorités mondiales. Reste à savoir si les puissants sauront écouter ceux qui, depuis des siècles, veillent sur la Terre. Une chose est sûre : leur combat ne fait que commencer.
À retenir : Une union inédite entre indigènes d’Amérique et d’Océanie, un cri contre les énergies fossiles, et une COP30 qui s’annonce décisive.