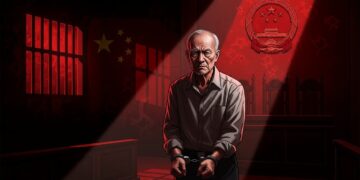Imaginez un monde où chaque vidéo que vous regardez sur Netflix, chaque chanson streamée sur Spotify ou chaque fichier envoyé par e-mail pourrait être taxé à la frontière comme un simple t-shirt importé de Chine. Impensable ? C’est pourtant ce qui pourrait arriver dès mars 2026 si l’Organisation mondiale du commerce ne parvient pas à un accord.
Depuis 1998, un gentlemen’s agreement tacite protège les transmissions électroniques de tout droit de douane. Ce moratoire, renouvelé tous les deux ou quatre ans, est devenu le pilier invisible de l’économie numérique mondiale. Et aujourd’hui, les États-Unis veulent le transformer en règle définitive et irréversible.
Une proposition américaine qui change la donne
Le 25 novembre dernier, Washington a officiellement déposé un projet de décision à l’OMC. Objectif : faire adopter, lors de la prochaine conférence ministérielle prévue du 26 au 29 mars 2026 au Cameroun, une exonération permanente des droits de douane sur les transmissions électroniques.
Le texte est clair : la pratique actuelle qui consiste à ne pas imposer de droits de douane « a joué un rôle important dans le développement de l’économie numérique » et « favorise la stabilité et la prévisibilité du système commercial ». Les États-Unis ne veulent plus de renouvellement tous les deux ans. Ils veulent une règle gravée dans le marbre.
Vingt-sept ans de moratoire provisoire
Retour en 1998. À l’époque, internet balbutie encore. Les membres de l’OMC, alors GATT, décident de ne pas appliquer de droits de douane aux « transmissions électroniques ». Personne ne sait vraiment ce que recouvre exactement cette notion, mais tout le monde s’accorde sur un point : taxer les données risquerait de tuer dans l’œuf la révolution numérique qui s’annonce.
Depuis, ce moratoire est renouvelé à chaque conférence ministérielle. Un rituel presque automatique… jusqu’à récemment.
Abou Dhabi 2024 : le premier vrai accroc
L’année dernière, lors de la conférence d’Abou Dhabi, l’ambiance était électrique. L’Inde, soutenue par l’Afrique du Sud, a failli faire capoter l’ensemble de la réunion en menaçant de veto. New Delhi a fini par céder… mais seulement pour deux ans maximum. Un compromis arraché dans la douleur qui expire donc en mars 2026.
Pourquoi cette résistance soudaine ? Parce que la transformation numérique a changé d’échelle. Ce qui représentait quelques mégaoctets en 1998 pèse aujourd’hui des centaines de zettaoctets. Et chaque octet qui traverse les frontières sans taxe représente, pour certains pays, un manque à gagner fiscal colossal.
Le calcul indien qui fait peur
L’Inde et l’Afrique du Sud avancent des chiffres impressionnants. Selon certaines études internes citées lors des négociations, le manque à gagner douanier pourrait atteindre plusieurs dizaines de milliards de dollars par an pour les grands pays émergents d’ici la fin de la décennie.
Pour ces nations, le moratoire n’est plus un simple accord technique : c’est une perte de souveraineté fiscale sur leur propre espace numérique.
« Le rythme rapide de la transformation numérique ne fait qu’accroître l’ampleur du problème »
Cette phrase, répétée comme un mantra par les délégations indienne et sud-africaine, résume leur position. Elles ne rejettent pas le commerce électronique. Elles veulent simplement avoir le droit, comme pour tout autre bien ou service, d’appliquer des droits de douane si elles le jugent nécessaire.
Pourquoi les États-Unis tiennent tant à cette permanence
Pour Washington, la réponse est évidente : la prévisibilité. Les géants du numérique américains – Google, Amazon, Microsoft, Meta, Apple – ont bâti leur modèle économique sur l’idée que les données circulent librement. Toute menace de taxation, même théorique, créerait une incertitude juridique majeure.
Une taxe indienne sur les données pourrait ainsi se répercuter sur le prix de YouTube en Europe, ou une taxe indonésienne sur les flux cloud pourrait renchérir Azure pour une PME française. L’effet domino serait immédiat.
Au-delà des intérêts privés, les États-Unis défendent aussi une vision philosophique : internet doit rester un espace de libre circulation. Taxer les transmissions électroniques reviendrait, selon eux, à ériger des murs là où il ne devrait y avoir que des ponts.
Les scénarios possibles pour le Cameroun 2026
Trois issues se dessinent pour la conférence de mars prochain :
- Le scénario américain : adoption d’un moratoire permanent par consensus.
- Le scénario du compromis : nouveau renouvellement temporaire (2 à 4 ans) avec peut-être des clarifications sur ce qui est taxable ou non.
- Le scénario du chaos : absence de consensus et expiration pure et simple du moratoire au 31 mars 2026.
Ce dernier cas serait une première historique. Et ses conséquences sont difficiles à mesurer tant le sujet est nouveau.
Que se passerait-il si le moratoire disparaît ?
Juridiquement, chaque pays retrouverait sa pleine souveraineté pour taxer les transmissions électroniques comme il l’entend. Certains pourraient choisir le taux zéro. D’autres, comme l’Inde ou l’Indonésie qui ont déjà des projets en ce sens, pourraient appliquer des taxes significatives.
Techniquement, la mise en œuvre poserait des problèmes colossaux : comment identifier la nature d’un paquet de données ? Comment déterminer son origine et sa destination exacte ? Comment éviter la double taxation ?
Les experts parlent déjà d’un « splinter-net » fiscal : un internet où chaque pays impose ses propres péages numériques.
Les pays européens dans tout ça
L’Union européenne, traditionnellement alignée sur les positions américaines en matière de commerce numérique, soutient également la pérennisation du moratoire. Mais elle le fait avec une certaine prudence : Bruxelles a elle-même mis en place la taxe GAFA et ne veut pas apparaître comme donnant un chèque en blanc aux géants américains.
La position européenne pourrait donc être décisive pour trouver un compromis acceptable par tous.
Vers une redéfinition de ce qu’est une « marchandise »
Au-delà du moratoire lui-même, c’est toute la définition du commerce international qui est en jeu. Les transmissions électroniques sont-elles des biens, des services, ou une troisième catégorie ? L’OMC, créée en 1995, n’a jamais vraiment tranché cette question existentielle.
La bataille de 2026 pourrait donc déboucher sur une refonte complète des règles du commerce mondial pour le XXIe siècle.
En attendant, une chose est sûre : le compte à rebours est lancé. Dans moins de quatre mois, au Cameroun, 164 pays devront décider s’ils veulent continuer à faire d’internet une zone franche… ou s’ils préfèrent reprendre la main sur leurs frontières numériques.
Le monde entier retient son souffle.