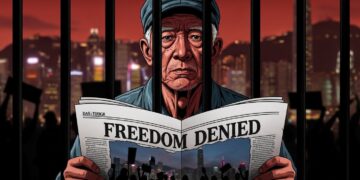Ils ont tout laissé derrière eux : leur maison, leur hôpital, parfois une partie de leur famille. Pourtant, dès leur arrivée dans le camp d’Al-Dabbah, au nord du Soudan, ils ont repris le stéthoscope. Médecins, pharmaciens, infirmiers déplacés du Darfour soignent aujourd’hui ceux qui, comme eux, ont fui la violence. Sous des tentes bleues, avec trois fois rien, ils tentent de maintenir en vie une population épuisée par l’exode.
Quand les soignants deviennent eux-mêmes réfugiés
Le camp s’étend sur quatorze hectares, à quelques kilomètres du Nil. Financé par un homme d’affaires soudanais, il offre un toit de toile à des centaines de familles. Lits de camp, nattes en plastique, cuisines collectives où l’on prépare l’assida à la chaîne : la vie s’organise tant bien que mal. Mais très vite, une évidence s’impose : sans soins, beaucoup ne survivront pas au trajet ni aux maladies qui les guettent.
Alors ceux qui savent soigner se mettent au travail. Ilham Mohamed, pharmacienne originaire d’El-Facher, explique simplement : « Nous venons tous du même endroit. Nous les comprenons et ils nous comprennent. » Cette proximité, presque fraternelle, change tout. Les patients ne sont pas des numéros. Ce sont des voisins d’hier.
Cinq tentes bleues pour tout un hôpital
Cinq tentes. C’est tout ce qui reste du système de santé pour des milliers de personnes. L’une fait office de pharmacie, une autre de laboratoire rudimentaire, les trois dernières accueillent consultations et hospitalisations de courte durée. Des chaises en plastique tiennent lieu de mobilier. Quand il en manque, on s’assoit par terre.
Des ambulances venues de la ville d’Al-Dabbah, à vingt kilomètres, servent de cliniques mobiles. Elles sillonnent les pistes poussiéreuses pour atteindre les nouveaux arrivants encore sur la route. Car beaucoup continuent d’arriver, à pied, après des jours de marche.
« Nous faisons tout pour répondre aux besoins médicaux, mais les ressources sont insuffisantes »
Ahmed Al-Tijani, volontaire auprès de la clinique mobile
Les pathologies les plus fréquentes sont celles de la misère et de l’épuisement : infections pulmonaires, diarrhées sévères, maladies de peau, conjonctivites. Les enfants toussent sans discontinuer. Les adultes, déshydratés, s’effondrent parfois avant même d’atteindre la tente.
Accoucher sur la route de l’exil
Plus de cent cinquante femmes enceintes ou allaitantes ont été prises en charge depuis l’ouverture du camp. Beaucoup ont accouché en chemin, au bord d’une piste, sans rien d’autre qu’un bout de tissu pour protéger le nouveau-né du soleil brûlant.
Fatima Abdelrahman, responsable de la santé reproductive sur place, raconte ces naissances improvisées avec une voix qui tremble encore. Certaines mères ont marché plusieurs jours en travail, refusant de s’arrêter de peur d’être rattrapées. Quand elles arrivent enfin, elles sont au bord de l’évanouissement.
Dans la tente dédiée, on fait ce qu’on peut. Pas de monitoring, pas d’analgésiques puissants, parfois même pas d’eau propre en quantité suffisante. Pourtant, presque tous les bébés sont nés vivants. Un petit miracle répété chaque semaine.
El-Facher tombée : la fin d’un siège de dix-huit mois
Fin octobre, après dix-huit mois de siège, El-Facher est tombée aux mains des Forces de soutien rapide (FSR). Plus de cent mille personnes ont pris la route dans les jours qui ont suivi. Parmi elles, une soixantaine de soignants, dont la docteure Ikhlass Abdallah.
Jusqu’au dernier moment, elle a tenu la maternité de l’hôpital saoudien, le seul établissement encore debout dans la ville. Les bombardements étaient quotidiens. Les drones survolaient les toits. Une nuit, l’un d’eux s’est écrasé sur le bâtiment.
« Nous avons accouru… mais il n’y avait plus personne à secourir. De nombreux corps étaient méconnaissables. Les gens étaient déchiquetés. Ce que nous avons vu semblait irréel, un cauchemar sorti d’un film. »
Docteure Ikhlass Abdallah
Quatre attaques en un mois sur cette seule maternité. Plus de quatre cent soixante patients et soignants tués dans cet hôpital selon l’Organisation mondiale de la santé. Et ce n’était qu’un établissement parmi tant d’autres ciblés depuis avril 2023.
Soigner en cachette sous la menace des paramilitaires
Sur la route de l’exode, être identifié comme médecin était une condamnation. Les FSR traquaient les blouses blanches. Soigner un blessé pouvait valoir la mort, la prison ou une rançon exorbitante.
La docteure Abdallah se souvient avoir dû cacher bandages et médicaments dans des sacs de farine. Pansements faits à la sauvette, dans l’ombre d’un arbre ou derrière un muret. Si les paramilitaires découvraient un blessé soigné, ils le frappaient à nouveau, plus fort, pour l’exemple.
Plus de mille deux cents soignants ont été tués depuis le début de la guerre, selon un bilan de l’OMS. Deux cent quatre-vingt-cinq attaques documentées contre des structures médicales. Des chiffres qui donnent le vertige.
Un dévouement qui dépasse l’épuisement
Dans le camp d’Al-Dabbah, les journées commencent avant l’aube et finissent tard dans la nuit. Les soignants dorment parfois trois ou quatre heures, jamais plus. Pourtant, personne ne se plaint vraiment.
« Nous ne sommes pas en bon état, mais nous sommes obligés de l’être », résume la docteure Abdallah. Le regard vide de fatigue, elle ajoute qu’on n’a pas le choix quand des enfants continuent d’arriver avec 40 de fièvre.
Cette abnégation touche jusqu’aux volontaires internationaux. Ahmed Al-Tijani, qui travaille avec l’Organisation internationale pour les migrations, répète qu’il n’a jamais vu un tel niveau de solidarité entre victimes et soignants. Ils partagent la même peur, les mêmes souvenirs, la même colère sourde.
Un système de santé en ruines
La guerre au Soudan a duré plus de deux ans maintenant. Elle a fait des dizaines de milliers de morts et déplacé des millions de personnes. Le système de santé, déjà fragile avant le conflit, s’est totalement effondré.
Dans les zones contrôlées par l’armée, quelques hôpitaux fonctionnent encore à moitié. Ailleurs, plus rien. Les médicaments manquent, l’électricité est rare, les routes sont coupées. Les maladies autrefois maîtrisées – paludisme, cholera, rougeole – reviennent en force.
Le patron des affaires humanitaires de l’ONU, en visite récente sur le terrain, a parlé d’une « ampleur des besoins énorme ». Il a appelé à reconstruire un système de santé digne de ce nom, en plus de répondre aux besoins élémentaires : nourriture, eau, abri, éducation.
Et demain ?
Dans la tente pharmacie, Ilham Mohamed range les dernières boîtes d’antibiotiques. Elles ne suffiront pas pour la semaine. Elle hausse les épaules avec un sourire las : « On fait avec ce qu’on a. On a l’habitude maintenant. »
Autour d’elle, les enfants jouent entre les tentes. Certains rient. C’est peut-être le seul vrai médicament dont personne ne parle : cette capacité, malgré tout, à continuer de vivre. Les soignants, eux, savent que leur combat ne fait que commencer. Tant qu’il y aura des arrivants, ils seront là, sous leurs tentes bleues, à panser les corps et, parfois, à sauver ce qui reste d’espoir.
Ils n’ont plus d’hôpital, plus de maison, souvent plus de famille. Pourtant, ils refusent d’abandonner. Ces médecins et infirmiers déplacés incarnent une forme de résistance silencieuse et obstinée face à l’horreur. Leur histoire mérite d’être connue, relayée, soutenue.
Le camp d’Al-Dabbah n’est qu’un point sur la carte immense de la souffrance soudanaise. Mais dans ce point, des femmes et des hommes continuent de croire qu’un stéthoscope, même sans électricité, peut encore faire la différence. Et tant qu’ils tiendront, il restera une raison d’espérer.