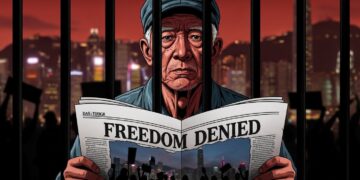Imaginez-vous réveillé chaque matin par la menace d’un porte-avions nucléaire stationné à quelques centaines de kilomètres de vos côtes. Pour des millions de Vénézuéliens, ce n’est plus une fiction. Nicolas Maduro vient de déclarer que son pays subit, depuis dix-sept semaines consécutives, une véritable « guerre psychologique » orchestrée par les États-Unis. Ces mots, prononcés lors du 105e anniversaire de l’aviation militaire, ont résonné comme un appel à la résistance nationale.
Une escalade qui dure depuis quatre mois
Depuis le printemps, la mer des Caraïbes est devenue le théâtre d’un impressionnant déploiement naval américain. Le plus grand porte-avions du monde, accompagné d’une flottille complète de navires de guerre et d’avions de chasse, croise officiellement dans le cadre d’opérations antidrogue. Mais à Caracas, personne n’est dupe : l’objectif réel serait de faire plier le gouvernement de Nicolas Maduro.
Le président vénézuélien n’a pas mâché ses mots. « Des forces étrangères impérialistes menacent continuellement de perturber la paix », a-t-il martelé dans un message enregistré diffusé aux militaires. Il a décrit ces dix-sept semaines comme une campagne de pressions « immorales » qui, loin d’effrayer la population, ont au contraire réveillé « une force fabuleuse de résistance ».
Le porte-avions, symbole d’une menace permanente
Le joyau de la marine américaine n’est pas venu seul. Des destroyers, des croiseurs lance-missiles et des escadrons de chasseurs l’accompagnent. Officiellement, ces moyens colossaux visent les narcotrafiquants. En réalité, les manœuvres se concentrent à proximité immédiate des eaux territoriales vénézuéliennes.
Ce n’est pas la première fois que Washington brandit la carte militaire. Mais le niveau actuel de déploiement n’a pratiquement aucun précédent récent dans la région. Les survols réguliers, les exercices à balles réelles et les communications radio interceptées entretiennent un climat de tension permanente.
« Depuis 17 semaines, des forces étrangères impérialistes menacent continuellement de perturber la paix de la mer des Caraïbes, de l’Amérique du Sud et du Venezuela, sous des prétextes fallacieux et extravagants. »
Nicolas Maduro, président du Venezuela
Des voisins impliqués malgré eux
Le dispositif américain ne serait pas complet sans la coopération de plusieurs pays de la région. La République dominicaine a récemment autorisé l’usage de son principal aéroport international et d’une base aérienne par l’armée américaine. Un peu plus au sud, Trinité-et-Tobago, situé à seulement quelques kilomètres des côtes vénézuéliennes, a multiplié les exercices conjoints ces dernières semaines.
Le ministre vénézuélien de la Défense, Vladimir Padrino López, n’a pas hésité à qualifier ces gouvernements de « serviles ». Pour lui, accepter la présence militaire américaine revient à transformer les Caraïbes en « mer fermée » au service des intérêts de Washington.
Cette coopération régionale renforce le sentiment d’encerclement à Caracas. Chaque nouvel accord bilatéral est perçu comme une pièce supplémentaire dans l’étau qui se resserre autour du pays.
Le Cartel des Soleils, prétexte ou réalité ?
Washington a franchi un cap supplémentaire en désignant officiellement le prétendu Cartel des Soleils comme organisation terroriste. Ce réseau, que les États-Unis accusent d’être piloté depuis les plus hautes sphères du pouvoir vénézuélien, serait responsable d’un trafic massif de drogue vers l’Amérique du Nord.
Le département de la Justice américain a même porté à 50 millions de dollars la prime pour toute information permettant la capture de Nicolas Maduro lui-même. Une somme astronomique qui place le président au même niveau que les criminels les plus recherchés de la planète.
Cependant, de nombreux experts restent prudents. L’existence même d’un cartel structuré nommé Cartel des Soleils fait débat. Plusieurs analystes préfèrent parler de réseaux de corruption au sein de l’appareil d’État, tolérant voire profitant du narcotrafic, plutôt que d’une organisation hiérarchisée comparable aux cartels colombiens ou mexicains.
Frappes aériennes et victimes collatérales
Dans le cadre de ces opérations antidrogue renforcées, les forces américaines ont procédé à une vingtaine de frappes aériennes contre des embarcations suspectes. Le bilan officiel fait état d’au moins 83 morts. Caracas dénonce des exécutions extrajudiciaires et affirme que parmi les victimes figurent de simples pêcheurs.
Ces actions, menées parfois à proximité des eaux vénézuéliennes, sont vécues comme des provocations directes. Chaque explosion retentit comme un avertissement : les États-Unis sont prêts à aller très loin.
La thèse vénézuélienne : le pétrole au cœur du conflit
Pour le gouvernement bolivarien, l’explication est limpide. Derrière le discours moral sur la drogue et la démocratie se cache une volonté purement économique : s’emparer des plus grandes réserves pétrolières prouvées de la planète. Le Venezuela détient en effet plus de 300 milliards de barils extractibles, un trésor que les sanctions ont rendu inaccessibles aux compagnies américaines.
Cette lecture géopolitique classique resurgit à chaque pic de tension. Le déploiement militaire actuel serait donc moins une opération antidrogue qu’une démonstration de force destinée à préparer le terrain à un éventuel changement de régime.
L’armée vénézuélienne appelée à l’imperturbabilité
Au milieu de cette tempête, Nicolas Maduro s’adresse directement aux forces armées. Il leur demande de rester « imperturbables » et « en alerte maximale ». Dans un contexte où des rumeurs de coup d’État circulent régulièrement, la loyauté de l’institution militaire reste le pilier du pouvoir chaviste.
Le message est clair : face à la pression extérieure, l’unité nationale doit être absolue. Les célébrations du 105e anniversaire de l’aviation militaire ont d’ailleurs été l’occasion de parades impressionnantes et de démonstrations de nouveaux équipements, russes pour la plupart.
Jusqu’où ira cette guerre froide caribéenne ?
La situation actuelle présente tous les ingrédients d’une crise majeure. D’un côté, un président américain qui alterne menaces ouvertes et offres de dialogue. De l’autre, un dirigeant vénézuélien qui refuse toute concession et mobilise le sentiment anti-impérialiste.
Les autorisations données à la CIA pour mener des actions clandestines sur le sol vénézuélien ajoutent une dimension particulièrement inquiétante. Dans ce contexte, chaque semaine supplémentaire de déploiement militaire fait craindre l’incident de trop.
La mer des Caraïbes, jadis synonyme de plages paradisiaques, est devenue un échiquier géopolitique où se joue bien plus que le sort d’un seul pays. C’est toute la doctrine d’ingérence américaine en Amérique latine qui resurgit, vingt ans après les heures chaudes de la guerre froide.
Et pendant ce temps, la population vénézuélienne continue de vivre au rythme des pénuries, des coupures d’électricité et désormais des sirènes d’alerte militaires. Dix-sept semaines de guerre psychologique, dit Maduro. Beaucoup craignent que les suivantes ne soient plus chaudes encore.
À retenir : Le Venezuela vit sous une pression militaire et psychologique continue depuis plus de quatre mois. Le déploiement américain dans les Caraïbes, les primes millionnaires et les accusations de narcoterrorisme forment un cocktail explosif dont l’issue reste totalement incertaine.
Une chose est sûre : la crise vénézuélienne est entrée dans une phase particulièrement dangereuse. Et le monde entier retient son souffle.