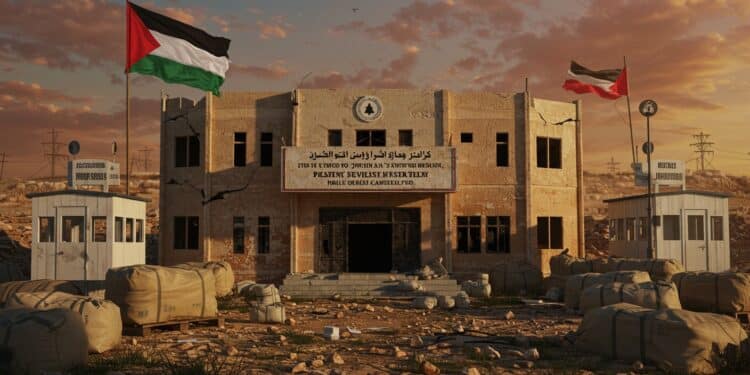Comment une administration peut-elle fonctionner avec seulement un tiers de son budget ? C’est la question brûlante qui se pose aujourd’hui en Cisjordanie, où l’Autorité palestinienne fait face à une crise financière sans précédent. Alors que les écoles réduisent leurs horaires et que les hôpitaux peinent à maintenir les urgences, des promesses de financements étrangers, annoncées en marge de l’Assemblée générale des Nations unies, offrent une lueur d’espoir. Mais ces aides, bien que bienvenues, sont-elles suffisantes pour contrer les défis structurels et politiques qui asphyxient l’économie palestinienne ? Plongeons dans les méandres de cette situation complexe.
Une Crise Financière aux Racines Profondes
La situation financière de l’Autorité palestinienne, basée à Ramallah, est alarmante. Depuis des décennies, cette entité, qui administre une partie de la Cisjordanie occupée par Israël depuis 1967, lutte pour maintenir ses services publics. Mais la crise s’est aggravée avec la guerre à Gaza et les décisions politiques israéliennes, notamment la rétention des recettes fiscales qui représentent une part essentielle du budget palestinien.
En effet, environ 68 % des revenus de l’Autorité proviennent des taxes collectées par Israël au nom des Palestiniens, en vertu du Protocole de Paris signé en 1994. Ce protocole confère à Israël un contrôle exclusif sur les frontières des territoires palestiniens, y compris sur les droits d’importation et la TVA. Cependant, ces fonds, vitaux pour le fonctionnement des institutions, sont actuellement gelés, plongeant l’Autorité dans une situation critique.
« Qui peut continuer à travailler en perdant 60 % de ses revenus ? Quel pays peut continuer à offrir des services ? »
Porte-parole de l’Autorité palestinienne
Des Promesses d’Aide Internationale
Face à cette crise, des annonces encourageantes ont émergé lors de l’Assemblée générale des Nations unies à New York. Des pays donateurs, parmi lesquels l’Arabie saoudite, l’Allemagne et l’Espagne, ont promis un total de 170 millions de dollars pour soutenir le budget de l’Autorité palestinienne. Ces fonds sont destinés à maintenir à flot des services essentiels comme l’éducation, la santé et les aides sociales.
Malgré cette bouffée d’oxygène, l’Autorité avait requis 400 millions de dollars par mois pendant six mois pour stabiliser ses finances. Les montants promis, bien qu’importants, restent donc en deçà des besoins réels. De plus, le porte-parole du Premier ministre palestinien a exprimé des doutes quant à la pérennité de ces aides, soulignant l’incertitude entourant leur renouvellement.
Chiffre clé : Les 170 millions de dollars promis représentent moins de la moitié des besoins mensuels estimés par l’Autorité palestinienne.
L’Impact sur les Services Publics
La crise financière a des répercussions directes sur la vie quotidienne des Palestiniens. En Cisjordanie, les écoles publiques, faute de fonds, ont ouvert avec retard cette année et ne fonctionnent que trois jours par semaine. Cette réduction drastique des horaires scolaires compromet l’éducation des jeunes, un secteur déjà fragilisé par des années de restrictions.
Dans le domaine de la santé, la situation est tout aussi préoccupante. Les hôpitaux, confrontés à une pénurie de fonds, limitent leurs interventions aux cas d’urgence et aux opérations vitales. Les stocks de médicaments s’épuisent, et les patients souffrant de maladies chroniques peinent à accéder aux traitements nécessaires.
Pour illustrer l’ampleur du problème, voici un aperçu des impacts majeurs :
- Éducation : Écoles ouvertes trois jours par semaine, retard dans la rentrée scolaire.
- Santé : Réduction des services médicaux au minimum, pénurie de médicaments.
- Aides sociales : Non-versement des aides financières depuis plus de deux mois.
Une Pauvreté en Forte Hausse
La crise économique ne se limite pas aux institutions. Elle touche de plein fouet la population palestinienne. Depuis le début de la guerre à Gaza, le nombre de Palestiniens vivant dans la pauvreté a bondi de plus de 150 %. Cette explosion de la précarité est aggravée par la suspension des aides financières, qui n’ont pas été distribuées depuis plus de deux mois.
À cela s’ajoute une restriction croissante des opportunités économiques. La multiplication des postes de contrôle israéliens en Cisjordanie limite les déplacements et l’accès au travail. De plus, la réduction des permis de travail pour les Palestiniens souhaitant travailler en Israël a drastiquement réduit les revenus de nombreuses familles.
| Facteur | Impact |
|---|---|
| Postes de contrôle | Limitation des déplacements et des opportunités économiques |
| Réduction des permis de travail | Chute des revenus des ménages |
| Suspension des aides | Augmentation de la pauvreté de 150 % |
Le Rôle du Protocole de Paris
Au cœur de cette crise se trouve le Protocole de Paris, un accord économique signé en 1994 dans le cadre des accords d’Oslo. Ce protocole confie à Israël la collecte des taxes douanières et de la TVA pour le compte de l’Autorité palestinienne. En théorie, ces fonds doivent être reversés pour financer les services publics palestiniens. En pratique, Israël utilise ce levier pour exercer une pression économique.
Depuis quatre mois, le ministre israélien des Finances, Bezalel Smotrich, a suspendu tous les paiements à l’Autorité palestinienne. Cette décision, qualifiée d’étranglement économique, vise, selon ses propres mots, à empêcher la création d’un État palestinien. Israël justifie cette rétention en affirmant qu’une partie des fonds sert à payer des services, comme l’électricité, fournis aux Palestiniens. Cependant, cette mesure a des conséquences dévastatrices sur l’économie et la société palestiniennes.
« La rétention des fonds est un outil pour asphyxier l’Autorité palestinienne et empêcher toute avancée vers un État palestinien. »
Ministre israélien des Finances
Un Contexte Politique Explosif
La crise financière s’inscrit dans un contexte politique tendu. La reconnaissance récente de l’État de Palestine par plusieurs capitales occidentales, dont Paris et Londres, a ravivé les tensions avec Israël. Cette reconnaissance, bien que symbolique, renforce la légitimité internationale de l’Autorité palestinienne, mais elle ne résout pas les défis économiques immédiats.
En parallèle, la guerre à Gaza a exacerbé les tensions régionales. Les restrictions imposées par Israël, combinées à la violence et à l’instabilité, ont amplifié les difficultés économiques. Les Palestiniens se retrouvent pris en étau entre une administration en manque de fonds et des contraintes imposées par l’occupation.
Vers une Issue Durable ?
Les promesses de financement étranger, bien que cruciales, ne constituent qu’une solution temporaire. Pour sortir de cette crise, des réformes structurelles et une renégociation des accords économiques, comme le Protocole de Paris, semblent indispensables. Une plus grande autonomie financière pour l’Autorité palestinienne permettrait de réduire sa dépendance aux fonds collectés par Israël.
En attendant, la population palestinienne continue de payer le prix fort. La réduction des services publics, l’explosion de la pauvreté et les restrictions de mouvement créent un cercle vicieux difficile à briser. Les efforts internationaux, bien qu’importants, doivent s’inscrire dans une stratégie à long terme pour garantir la stabilité économique et sociale.
En résumé : La crise financière de l’Autorité palestinienne, aggravée par la rétention des fonds par Israël, menace les services publics et accentue la pauvreté. Les aides internationales offrent un répit, mais une solution durable reste à trouver.
La situation en Cisjordanie illustre les défis complexes auxquels sont confrontés les Palestiniens, entre pressions économiques, restrictions politiques et instabilité régionale. Les promesses de financement étranger, bien qu’encourageantes, ne suffisent pas à répondre aux besoins criants de la population. Alors, comment l’Autorité palestinienne peut-elle sortir de cette spirale ? La réponse réside peut-être dans une mobilisation internationale plus soutenue et une remise en question des mécanismes économiques actuels.