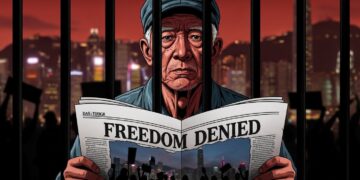Le 25 juin 2025, les rues du Kenya se sont embrasées. Des milliers de citoyens, portés par un élan de contestation, ont commémoré un mouvement citoyen historique qui, un an plus tôt, avait secoué le pays. Mais ce jour-là, la réponse des autorités a pris une tournure dramatique : 37 personnes ont été arrêtées, accusées de terrorisme. Que s’est-il passé pour que des manifestations pacifiques dérivent vers de telles accusations ? Plongeons dans les méandres de cette crise qui révèle les tensions profondes d’une nation en quête de justice.
Une Commémoration Sous Haute Tension
Le 25 juin 2025, des Kenyans se sont réunis pour rendre hommage à un mouvement citoyen né en 2024, déclenché par une loi budgétaire controversée. Ce texte, perçu comme oppressif par une jeunesse en colère, avait alors mobilisé des foules dans tout le pays. Un an plus tard, la commémoration de cet élan populaire s’est heurtée à une répression brutale. La police a arrêté 485 personnes en quelques jours, invoquant des chefs d’accusation graves comme le meurtre, le viol, et, plus surprenant encore, le terrorisme.
Parmi ces arrestations, 37 individus ont été ciblés pour des poursuites spécifiques. Selon la direction des poursuites pénales, ces personnes auraient participé à des actes de destruction de biens publics, qualifiés d’actes terroristes. Cette accusation, lourde de conséquences, soulève une question : les manifestations, expression d’un mécontentement populaire, sont-elles en train d’être criminalisées ?
Des Accusations de Terrorisme : Une Escalade Inquiétante
La direction des poursuites pénales a officiellement annoncé que les 37 suspects seraient jugés pour terrorisme devant le tribunal de Kahawa, en périphérie de Nairobi. Ces accusations reposent sur des actes présumés de dégradation de bâtiments publics lors des manifestations. Cependant, les autorités insistent : il ne s’agit pas de cibler des manifestants pacifiques, mais des individus ayant commis des actes criminels graves.
Ces poursuites ne visent pas des manifestants, mais des individus suspectés d’avoir choisi de s’engager dans des actes de terrorisme et de destruction.
Direction des poursuites pénales
Les suspects resteront en détention jusqu’au 10 juillet 2025, date à laquelle le tribunal examinera leur requête contestant ces accusations. Cette situation met en lumière une fracture : d’un côté, des citoyens revendiquant leurs droits, de l’autre, un État qui brandit l’arme du terrorisme pour réprimer. Mais où se situe la vérité ?
Un Contexte de Répression Policière
Depuis juin 2024, le Kenya est secoué par une vague de manifestations sans précédent. Ce qui a commencé comme une révolte contre une loi budgétaire a évolué en un mouvement pro-démocratie, porté par une jeunesse avide de changement. Mais cette mobilisation a un coût : près de 100 morts, selon les estimations, et des centaines de blessés. Les organisations de défense des droits humains pointent du doigt la répression policière comme principale responsable de ces violences.
Les forces de l’ordre sont accusées d’avoir recours à une force excessive, y compris l’usage d’armes létales. Des témoignages rapportent des tirs à balles réelles sur des manifestants non armés, ainsi que des disparitions forcées. La Commission nationale des droits humains (KNCHR) a recensé au moins dix morts lors des manifestations du 7 juillet 2025, organisées en hommage au mouvement pro-démocratie des années 1990.
Les chiffres clés des manifestations au Kenya :
- 485 arrestations après le 25 juin 2025
- 37 personnes poursuivies pour terrorisme
- 100 morts depuis le début des manifestations en 2024
- 10 morts lors des manifestations du 7 juillet 2025
Une Instrumentalisation Politique ?
Face à cette vague de contestation, le gouvernement kenyan a adopté une rhétorique musclée. Après les événements du 25 juin, les autorités ont affirmé avoir déjoué un coup d’État. Cette déclaration a suscité l’indignation des manifestants, qui accusent l’exécutif d’avoir infiltré leurs rangs avec des hommes armés pour discréditer leur mouvement. Cette théorie, bien que difficile à prouver, alimente la méfiance envers les institutions.
Les organisations internationales, comme l’ONU, ont exprimé leur inquiétude face à la situation. Une porte-parole du Haut-Commissariat aux droits de l’homme a rappelé que le recours à la force létale par les forces de l’ordre doit être strictement limité à des cas de menace imminente pour la vie. Pourtant, les rapports de violence continuent de s’accumuler, mettant en lumière un usage disproportionné de la force.
Selon le droit international, les forces de l’ordre ne doivent recourir à la force létale que lorsque cela est strictement nécessaire pour protéger des vies contre une menace imminente.
Ravina Shamdasani, porte-parole de l’ONU
La Jeunesse au Cœur du Mouvement
Ce qui rend ce mouvement unique, c’est l’implication massive de la jeunesse kenyane. Frustrée par des années de corruption, d’inégalités croissantes et de promesses non tenues, cette génération utilise les réseaux sociaux pour s’organiser et amplifier son message. Les hashtags et les vidéos des manifestations ont inondé les plateformes, donnant une visibilité internationale à leur combat.
Mais cette mobilisation n’est pas sans risques. Les accusations de terrorisme, les arrestations massives et les violences policières envoient un message clair : toute forme de dissidence sera sévèrement réprimée. Pourtant, loin de se décourager, les jeunes continuent de descendre dans la rue, déterminés à faire entendre leur voix.
Un Défi pour la Démocratie Kenyane
La situation au Kenya pose une question fondamentale : comment concilier le droit de manifester avec la nécessité de maintenir l’ordre public ? Les accusations de terrorisme contre les manifestants risquent de creuser un fossé encore plus grand entre le peuple et ses dirigeants. Dans un pays où la démocratie est encore fragile, ces tensions pourraient avoir des répercussions durables.
Les organisations de défense des droits humains appellent à des enquêtes indépendantes pour faire la lumière sur les violences et les disparitions. Elles demandent également que les responsables soient tenus pour compte, qu’il s’agisse des forces de l’ordre ou des individus ayant commis des actes criminels lors des manifestations.
| Événement | Conséquences |
|---|---|
| Manifestations de juin 2024 | Près de 100 morts, mouvement citoyen émergent |
| Arrestations du 25 juin 2025 | 485 arrestations, 37 accusés de terrorisme |
| Manifestations du 7 juillet 2025 | Au moins 10 morts, selon la KNCHR |
Vers une Résolution ou une Escalade ?
Alors que le Kenya traverse une période de turbulences, la communauté internationale observe avec attention. Les Nations Unies, les ONG et les défenseurs des droits humains appellent à un dialogue inclusif pour apaiser les tensions. Mais pour l’instant, les positions semblent figées : les manifestants exigent justice et réformes, tandis que le gouvernement durcit le ton.
Le 10 juillet 2025 marquera une étape cruciale avec l’audience des 37 accusés. Leur sort pourrait influencer l’avenir du mouvement citoyen. Une condamnation pour terrorisme pourrait décourager les manifestations, mais elle risque aussi d’attiser la colère d’une population déjà à bout de patience.
En attendant, les rues du Kenya restent le théâtre d’un bras de fer entre un peuple en quête de changement et un État déterminé à maintenir son autorité. L’issue de ce conflit reste incertaine, mais une chose est sûre : la jeunesse kenyane, avec sa résilience et sa détermination, continuera de façonner l’avenir du pays.
Ce qu’il faut retenir :
- Les manifestations de 2024 ont donné naissance à un mouvement citoyen puissant.
- La répression policière a causé des dizaines de morts et des centaines d’arrestations.
- Les accusations de terrorisme contre 37 manifestants soulèvent des inquiétudes.
- La jeunesse kenyane reste au cœur de la contestation, malgré les risques.
Le Kenya se trouve à un tournant. Entre répression et aspiration à la démocratie, le pays doit trouver un équilibre pour éviter une escalade des violences. La voix des citoyens, portée par une jeunesse courageuse, résonne plus fort que jamais. Mais jusqu’où ira ce combat pour la justice ?