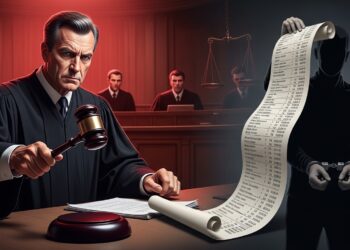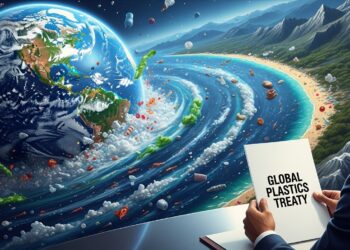Comment rendre justice face à des accusations aussi graves que celles d’un génocide ? Dans un monde où les conflits semblent parfois insolubles, une ancienne juge sud-africaine, figure emblématique de la lutte pour les droits humains, continue de croire en un avenir où les responsables devront répondre de leurs actes. À 83 ans, cette experte des tribunaux internationaux dirige une commission d’enquête indépendante mandatée par l’ONU pour examiner les violations des droits humains dans les territoires palestiniens et en Israël. Son dernier rapport, explosif, accuse les autorités israéliennes de commettre un génocide à Gaza, un terme qui résonne avec une gravité particulière dans l’histoire des crimes contre l’humanité.
Un Rapport Accusateur au Cœur du Conflit
Depuis sa création en 2021, la commission d’enquête indépendante s’est donnée pour mission d’explorer les atteintes aux droits humains dans un contexte de violence croissante. Le rapport publié récemment ne mâche pas ses mots : il conclut que les actions d’Israël à Gaza, depuis l’attaque du Hamas le 7 octobre 2023, s’apparentent à un génocide. Des figures politiques de premier plan, dont le président israélien et le Premier ministre, sont pointées du doigt pour avoir, selon les enquêteurs, incité à de tels actes. Ces accusations, rejetées avec véhémence par Israël, qui les qualifie de biaisées et mensongères, placent la commission sous les feux des projecteurs.
La justice est lente, mais comme l’a dit Nelson Mandela, cela semble toujours impossible, jusqu’à ce qu’on le fasse.
Ancienne juge sud-africaine
Pourtant, la présidente de la commission reste optimiste. Forte de son expérience, elle compare la situation actuelle à celle de l’apartheid en Afrique du Sud, un régime qu’elle n’aurait jamais cru voir s’effondrer de son vivant. Cette conviction, ancrée dans une carrière dédiée à la défense des opprimés, nourrit son espoir que les responsables israéliens pourraient un jour être traduits en justice.
Un Parcours d’Exception au Service de la Justice
La présidente, une juriste d’origine indienne, a marqué l’histoire par son engagement. Née sous le régime oppressif de l’apartheid, elle a d’abord défendu des activistes anti-apartheid avant de devenir juge, puis de siéger dans des instances internationales prestigieuses. De 2008 à 2014, elle a occupé le poste de Haute-Commissaire aux droits de l’homme à l’ONU, affrontant des dossiers complexes avec une détermination sans faille. Son passage au Tribunal pénal international pour le Rwanda et à la Cour pénale internationale (CPI) a renforcé sa réputation de femme de conviction.
Son rôle actuel, à la tête de la commission d’enquête, est peut-être le plus ardu de sa carrière. Enquêter sur les violations des droits humains dans un conflit aussi polarisé exige un courage rare, surtout face aux critiques virulentes. Accusée d’antisémitisme par certains, elle dénonce les campagnes de dénigrement, notamment celles appelant à des sanctions contre elle, similaires à celles imposées par les États-Unis à d’autres acteurs de la justice internationale.
Les Défis de la Justice Internationale
La mission de la commission ne se limite pas à pointer du doigt des responsabilités. Elle doit également naviguer dans un système judiciaire international complexe. La CPI, par exemple, a déjà émis des mandats d’arrêt contre des dirigeants israéliens, mais leur mise en œuvre reste un défi. Sans forces de police propres, la Cour dépend des États pour arrêter les suspects, une réalité qui limite son efficacité.
Pourtant, la présidente refuse de céder au pessimisme. Elle rappelle que des avancées historiques, comme la fin de l’apartheid, semblaient autrefois inconcevables. Cette perspective nourrit son espoir que la justice internationale, bien que lente, finira par prévaloir.
Les parallèles entre les conflits passés et présents sont frappants. Les méthodes utilisées pour déshumaniser les victimes rappellent des tragédies historiques.
Témoigner de l’Indicible : le Poids des Preuves
Le travail de la commission est aussi émotionnellement éprouvant. Les enquêteurs visionnent des vidéos insoutenables, documentant des violences extrêmes, y compris des agressions sexuelles et des humiliations infligées par des militaires. Ces images, souvent publiées par les soldats eux-mêmes sur les réseaux sociaux, constituent une part importante des preuves recueillies. La présidente confie que ce processus est traumatisant pour son équipe, mais elle insiste sur l’importance de ces témoignages pour établir la vérité.
Elle établit un parallèle troublant avec le génocide rwandais, où les victimes tutsies étaient déshumanisées, qualifiées de cafards. À Gaza, des discours similaires, comparant les Palestiniens à des animaux, servent, selon elle, à justifier des actes de violence. Cette rhétorique, qui nie l’humanité de l’autre, est un signe alarmant des dynamiques à l’œuvre dans le conflit.
Des Obstacles Structurels et Financiers
Malgré ses efforts, la commission fait face à des contraintes majeures. Le manque de financement limite sa capacité à enquêter sur des questions cruciales, comme la possible complicité d’États fournissant des armes à Israël. Ce défi, combiné à la complexité politique du conflit, rend la tâche de la commission d’autant plus difficile.
La présidente, qui quittera ses fonctions le 3 novembre 2025 en raison de son âge et de problèmes de santé, laisse derrière elle un héritage de persévérance. Avant son départ, elle présentera un dernier rapport à l’Assemblée générale de l’ONU, un moment clé pour faire entendre la voix de sa commission.
Un Héritage pour l’Avenir
Le travail de la commission ne s’arrête pas avec le départ de sa présidente. Les enquêtes futures se pencheront sur d’autres acteurs impliqués dans le conflit, avec l’espoir de documenter davantage de preuves et de pousser vers une accountability accrue. Les défis sont nombreux, mais l’histoire montre que la justice, bien que lente, peut triompher.
Pour résumer les points clés de cette enquête :
- Accusations de génocide contre les autorités israéliennes.
- Mandats d’arrêt émis par la CPI, mais mise en œuvre difficile.
- Parallèles historiques avec l’apartheid et le génocide rwandais.
- Preuves accablantes, souvent issues des réseaux sociaux.
- Manque de financement limitant les investigations.
Le combat pour la justice à Gaza est loin d’être terminé. Mais, comme le rappelle la présidente, l’impossible peut devenir réalité. Son parcours, marqué par la lutte contre l’injustice, inspire une réflexion : jusqu’où sommes-nous prêts à aller pour défendre les droits humains ?