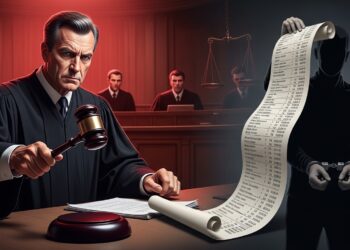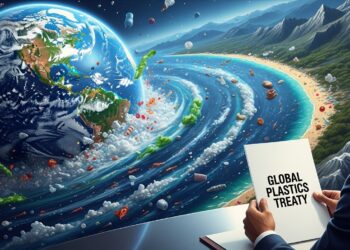Dans une petite église de Kramatorsk, ville de l’est de l’Ukraine marquée par la guerre, un prêtre s’adresse à ses fidèles avec ferveur. Ses mots résonnent dans la nef étroite, dénonçant les « fausses églises » et les influences étrangères. À seulement quelques kilomètres, le front entre l’Ukraine et la Russie fait trembler la terre. Mais ici, un autre combat se joue, plus discret mais tout aussi profond : une guerre religieuse qui divise les cœurs et les esprits. Dans cette région du Donbass, la foi est devenue un champ de bataille, où l’Église orthodoxe ukrainienne indépendante, née en 2018, s’oppose à celle affiliée au patriarcat de Moscou. Ce conflit spirituel, loin d’être anodin, reflète les tensions politiques et culturelles d’un pays en quête d’identité.
Une Foi Déchirée par la Guerre
Depuis l’invasion russe de 2022, l’Ukraine traverse une crise identitaire majeure. La religion, pilier central de la société ukrainienne, n’échappe pas à cette fracture. L’Église orthodoxe, qui compte des millions de fidèles dans ce pays, est au cœur d’un débat brûlant. D’un côté, l’Église indépendante, créée pour rompre avec des siècles de domination religieuse russe. De l’autre, l’Église liée au patriarcat de Moscou, perçue par beaucoup comme un instrument de l’influence du Kremlin. Cette rivalité n’est pas seulement spirituelle : elle touche à la souveraineté nationale et à la loyauté des citoyens.
À Kramatorsk, ville industrielle du Donbass, ce schisme religieux est particulièrement visible. Autrefois peuplée de 147 000 habitants, la ville s’est vidée avec le conflit, mais les églises, elles, restent des lieux de rassemblement. Pourtant, les bancs de l’Église indépendante, dirigée par des prêtres comme Oleksandre Tkatchouk, sont souvent clairsemés. À l’inverse, la cathédrale affiliée à Moscou attire encore les foules, en particulier les personnes âgées, attachées à une tradition ancrée dans leur mémoire collective.
L’Église Indépendante : Un Symbole de Résistance
L’Église orthodoxe ukrainienne indépendante, reconnue par certaines Églises orthodoxes mondiales, incarne pour beaucoup un acte de défiance face à la Russie. Fondée en 2018 après la fusion de deux branches dissidentes, elle a mis fin à 332 ans de tutelle religieuse de Moscou. Cette rupture, saluée comme une victoire pour l’indépendance nationale, a été accélérée par l’invasion de 2022. Selon une étude récente, 56 % des Ukrainiens se disent aujourd’hui fidèles à cette Église, contre seulement 34 % en 2020.
« Ce n’est que le FSB sous le couvert de l’église », affirme Oleksandre Tkatchouk, prêtre de Kramatorsk, en pointant du doigt l’Église liée à Moscou.
Oleksandre, avec son style progressiste, incarne cette nouvelle vague. Glabre, en tee-shirt, il détonne parmi les prêtres orthodoxes traditionnels. Il envisage même d’installer des bancs dans son église, une pratique inspirée des catholiques, pour rompre avec l’austérité des offices où les fidèles restent debout pendant des heures. Sous la direction d’Epiphaniï, chef de l’Église indépendante, ce courant moderniste cherche à s’adapter aux attentes d’une société en mutation.
L’Église de Moscou : Une Forteresse de Tradition
Face à l’Église indépendante, celle affiliée au patriarcat de Moscou conserve une forte emprise, surtout dans les régions russophones comme le Donbass. À Kramatorsk, sa grande cathédrale, avec ses dômes dorés et ses chants envoûtants, attire des fidèles, souvent âgés, qui y trouvent un refuge dans leurs souvenirs d’une époque soviétique idéalisée. Ces paroissiens, dont beaucoup ont travaillé dans les mines de charbon, restent attachés à une liturgie immuable, perçue comme un rempart contre le changement.
Pourtant, cette Église est sous le feu des critiques. Accusée de propager l’influence russe, elle fait l’objet d’une surveillance accrue de la part des autorités ukrainiennes. Depuis 2022, 180 prêtres de cette confession ont été visés par des poursuites judiciaires, souvent pour suspicion d’espionnage au profit de Moscou. Le métropolite Onoufriï, chef de cette Église, a même vu sa citoyenneté ukrainienne révoquée par le président Volodymyr Zelensky, une décision symbolique d’une rupture profonde.
Fait marquant : En septembre 2025, l’Ukraine a lancé des démarches judiciaires pour interdire l’Église affiliée à Moscou si elle ne coupe pas définitivement ses liens avec le patriarcat russe.
Un Conflit aux Racines Profondes
Ce schisme religieux ne date pas d’aujourd’hui. Après l’indépendance de l’Ukraine en 1991, l’orthodoxie ukrainienne s’est scindée en plusieurs branches, reflétant les tensions entre une identité nationale émergente et l’héritage russe. L’Église liée à Moscou, longtemps dominante, a vu son influence s’éroder au fil des ans, particulièrement après l’annexion de la Crimée en 2014 et l’invasion de 2022. Le patriarcat de Moscou, qui a qualifié l’invasion de « guerre sainte », est devenu un symbole de l’ennemi pour beaucoup d’Ukrainiens.
Pour Mykola, un fidèle de l’Église indépendante dont le village a été détruit par les bombardements russes, la solution est radicale : fermer toutes les églises liées à Moscou. Cette position, partagée par une partie de la population, illustre l’ampleur du ressentiment. Pourtant, pour d’autres, comme les fidèles de la cathédrale de Kramatorsk, la foi transcende les querelles politiques. « Plus on interdit quelque chose, plus les gens le veulent », confie Serguiï Kapitonenko, prêtre de l’Église de Moscou, dénonçant ce qu’il qualifie de persécution.
Entre Tradition et Modernité
Ce conflit religieux est aussi une bataille d’idées. D’un côté, l’Église indépendante prône une approche moderne, ouverte aux réformes, comme l’introduction de bancs ou une liturgie plus accessible. De l’autre, l’Église de Moscou s’accroche à une tradition millénaire, rejetant toute concession au libéralisme. Serguiï Kapitonenko, par exemple, refuse de rejoindre l’Église ukrainienne, qu’il juge trop progressiste. « Nous restons fidèles à l’enseignement reçu il y a 2 000 ans », affirme-t-il.
Pourtant, pour les fidèles, les différences sont minces. Roman Salnykov, un étudiant de 22 ans, confie avoir fréquenté les deux Églises sans y voir de distinction majeure. « Les rites sont les mêmes, les saints identiques », explique-t-il. Pour lui, l’attachement à l’Église de Moscou relève souvent de l’habitude, surtout chez les générations plus âgées. Cette observation met en lumière une réalité complexe : si la foi unit, les prêtres et leurs discours divisent.
La Religion, Miroir de la Société
Dans un pays où 70 % de la population se revendique orthodoxe, l’Église reste une force influente. Ce conflit religieux n’est pas qu’une querelle de clocher : il reflète les luttes pour l’identité, la souveraineté et l’avenir de l’Ukraine. Chaque camp utilise la foi comme un levier politique, que ce soit pour affirmer l’indépendance nationale ou pour maintenir une influence culturelle russe.
Les autorités ukrainiennes, en ciblant l’Église de Moscou, cherchent à éradiquer ce qu’elles perçoivent comme une cinquième colonne. Mais cette stratégie n’est pas sans risque. En interdisant une institution ancrée dans la vie de nombreux fidèles, Kiev pourrait alimenter un sentiment de persécution et renforcer l’attachement de certains à cette Église. Comme le souligne Serguiï Kapitonenko, les interdictions peuvent avoir l’effet inverse, attisant le désir de résistance.
| Église | Position | Soutien populaire (2023) |
|---|---|---|
| Église indépendante | Symbole d’indépendance nationale, réformes modernes | 56 % |
| Église de Moscou | Tradition orthodoxe, lien avec la Russie | 6 % |
Un Avenir Incertain
À Kramatorsk, comme ailleurs en Ukraine, la religion reste un terrain miné. Les fidèles, pris entre leur foi et les tensions politiques, doivent naviguer dans un paysage complexe. L’Église indépendante, portée par un élan patriotique, gagne du terrain, mais elle peine à conquérir les cœurs dans des régions comme le Donbass, où la tradition et la nostalgie soviétique restent fortes.
Le gouvernement ukrainien, en durcissant sa position contre l’Église de Moscou, joue une carte risquée. Une interdiction totale pourrait radicaliser une partie de la population, tandis qu’une coexistence forcée maintiendrait une influence russe jugée inacceptable par beaucoup. Dans ce contexte, la foi, censée rassembler, devient paradoxalement un vecteur de division.
Pour les habitants de Kramatorsk, le choix d’une église est bien plus qu’une question spirituelle. C’est un acte d’allégeance, un positionnement dans un conflit qui dépasse les frontières de l’Ukraine. Alors que les cloches des cathédrales continuent de sonner, elles résonnent comme un écho des luttes d’un peuple en quête de paix et d’identité.