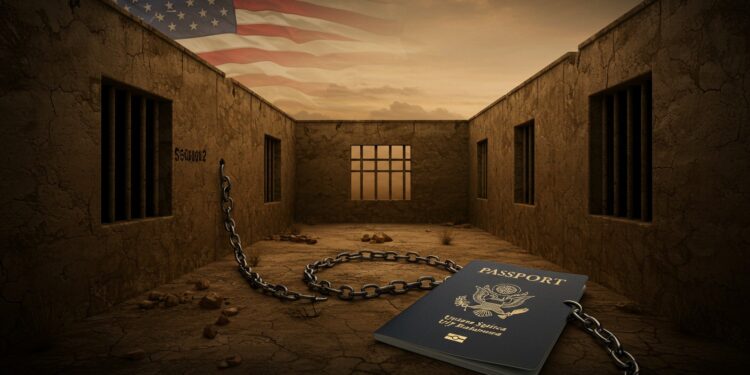Imaginez-vous arraché à votre vie, à votre famille, à tout ce que vous connaissez, pour être envoyé dans un pays dont vous n’avez jamais entendu parler, à 13 000 kilomètres de chez vous. C’est l’histoire bouleversante de cinq hommes, expulsés des États-Unis vers l’Eswatini, une petite nation africaine enclavée entre l’Afrique du Sud et le Mozambique. Ce récit, mêlant politique migratoire obscure et drame humain, soulève des questions brûlantes sur la justice et les droits humains. Comment un pays si lointain est-il devenu une destination pour les expulsés américains ? Plongeons dans cette affaire troublante.
Une Déportation Inattendue vers l’Inconnu
En juillet dernier, cinq hommes, originaires de Cuba, de Jamaïque, du Laos, du Vietnam et du Yémen, ont été expulsés des États-Unis vers l’Eswatini. Parmi eux, Roberto Mosquera, un Cubain de 58 ans, arrêté lors d’un contrôle de routine en Floride. Sa famille, sans nouvelles, croyait qu’il avait été renvoyé à Cuba, son pays natal qu’il avait quitté à l’âge de 13 ans. Mais une publication sur un réseau social a révélé une vérité bien plus choquante : il se trouvait en Eswatini, un pays méconnu, à des milliers de kilomètres de tout ce qu’il connaissait.
Cette expulsion n’est pas un cas isolé. Elle s’inscrit dans une politique migratoire controversée menée par les autorités américaines, qui envoient des migrants vers des « pays tiers » comme l’Eswatini, le Ghana ou le Rwanda. Ces accords, souvent opaques, soulèvent des critiques acerbes de la part des défenseurs des droits humains. Mais qu’est-ce qui motive ces décisions, et quelles en sont les conséquences pour les expulsés ?
Un Accord Controversé avec l’Eswatini
L’Eswatini, une monarchie absolue dirigée par le roi Mswati III, a conclu un accord avec les États-Unis pour accueillir jusqu’à 160 migrants expulsés en échange de 5,1 millions de dollars. Cet argent, selon les termes de l’accord, doit servir à renforcer la gestion des frontières et de l’immigration dans ce petit pays de 1,2 million d’habitants. Mais cet arrangement financier soulève des questions éthiques : peut-on monnayer l’accueil de personnes déracinées, souvent contre leur volonté ?
C’est comme de la traite moderne d’êtres humains, par des voies officielles.
Tin Thanh Nguyen, avocat basé aux États-Unis
Les expulsés, comme Roberto Mosquera, n’ont été informés de leur destination qu’une fois à bord de l’avion. Aucun d’eux n’a signé de document consentant à cette déportation, selon leurs avocats. Cette opacité renforce le sentiment d’injustice et d’arbitraire qui entoure ces expulsions.
Des Hommes dans un « Trou Noir Légal »
À leur arrivée en Eswatini, les cinq hommes ont été incarcérés dans une prison de haute sécurité près de Mbabane, la capitale. Ce centre correctionnel, connu pour détenir des prisonniers politiques, est un outil de répression du régime monarchique. Les conditions y sont rudes : pas d’accès à un avocat, des appels vidéo limités à quelques minutes par semaine, sous la surveillance de gardiens armés. Les familles décrivent une situation inhumaine, où leurs proches sont plongés dans un « trou noir légal ».
Les avocats des expulsés, comme Tin Thanh Nguyen, dénoncent l’absence de procédure légale. Les hommes n’ont pas été informés de leurs droits et se voient refuser tout contact avec des avocats locaux. Sibusiso Nhlabatsi, un avocat eswatinien, a tenté de leur rendre visite, mais les autorités pénitentiaires ont prétendu que les détenus refusaient de le voir – une affirmation contredite par les familles.
Fait marquant : Un avocat eswatinien a obtenu une décision judiciaire pour représenter les expulsés, mais le gouvernement a immédiatement fait appel, bloquant l’accès à une défense légale.
Qui Sont les Expulsés ?
Les autorités américaines qualifient ces hommes de « criminels dangereux », coupables de crimes graves comme le meurtre ou le viol d’enfant. Pourtant, leurs familles et avocats affirment qu’ils ont purgé leurs peines et vivaient légalement aux États-Unis depuis des années. Prenons l’exemple de Roberto Mosquera. Condamné en 1989 pour tentative de meurtre, il a été libéré en 1996 après neuf ans de prison. Depuis, il s’était reconstruit une vie : marié, père de quatre filles, employé dans une entreprise de plomberie, il donnait même des conférences contre la violence des gangs.
Une proche de Roberto, anonyme par peur des représailles, raconte :
Il n’a rien d’un monstre ou d’un prisonnier barbare comme ils le disent. Il a changé de vie.
Ada, proche de Roberto Mosquera
Malgré cela, une condamnation datant de plus de 30 ans a suffi à justifier son expulsion, son droit de séjour aux États-Unis ayant été révoqué. Cuba, son pays d’origine, refuse souvent de reprendre ses ressortissants, ce qui a conduit à son envoi en Eswatini.
Une Politique Migratoire Critiquée
Ces expulsions s’inscrivent dans une politique plus large, initiée sous l’administration Trump, visant à renvoyer les sans-papiers vers des pays tiers. Des destinations comme le Ghana, le Rwanda ou le Soudan du Sud ont également été utilisées. Ces accords, souvent conclus dans l’ombre, sont critiqués pour leur manque de transparence et leurs conséquences humaines. Les groupes de défense des droits humains dénoncent une forme de « traite moderne », où des individus sont déplacés comme des pions dans des transactions internationales.
Pour mieux comprendre l’ampleur de cette politique, voici quelques points clés :
- Les expulsés sont souvent des personnes ayant purgé leurs peines.
- Ils sont envoyés dans des pays sans lien avec leur histoire ou culture.
- Les accords financiers incitent des nations pauvres à accepter ces migrants.
- Les conditions de détention dans les pays d’accueil sont souvent inhumaines.
Un Système Judiciaire Bloqué en Eswatini
En Eswatini, les expulsés se heurtent à un système judiciaire verrouillé par le pouvoir monarchique. Le roi Mswati III, au pouvoir depuis 39 ans, est connu pour réprimer toute opposition. Les avocats locaux, comme Sibusiso Nhlabatsi, peinent à accéder aux détenus. Même lorsqu’une décision judiciaire leur donne raison, le gouvernement fait appel pour retarder les démarches. Cette situation laisse les expulsés dans un vide juridique, sans accès à une défense équitable.
Alma David, une avocate basée aux États-Unis, rapporte :
Le directeur de la prison m’a dit : « Ce n’est pas comme aux États-Unis. »
Alma David, avocate des expulsés
Cette phrase illustre le fossé entre les normes juridiques internationales et les réalités en Eswatini, où le pouvoir du roi prédomine sur toute forme de justice.
Un Impact Humain Dévastateur
Pour les familles des expulsés, l’angoisse est constante. Roberto Mosquera, par exemple, est apparu amaigri et affaibli lors d’un appel vidéo récent. Sa proche, Ada, décrit une situation insoutenable :
C’est une condamnation à mort. On en souffre tous.
Ada, proche de Roberto Mosquera
Les autres expulsés, originaires du Vietnam, du Laos ou du Yémen, vivent des conditions similaires. Leurs familles, souvent basées aux États-Unis, n’ont que des bribes d’informations, souvent découvertes par hasard sur les réseaux sociaux. Cette incertitude ajoute une couche de cruauté à une situation déjà dramatique.
Un Cas Particulier : Le Retour d’Orville Etoria
Seul Orville Etoria, un Jamaïcain de 62 ans, a été rapatrié dans son pays d’origine en septembre. Après avoir purgé une peine pour meurtre aux États-Unis, il vivait à New York lorsqu’il a été arrêté et envoyé en Eswatini. Son avocate, Mia Unger, explique :
Ils l’ont envoyé faire la moitié du tour du monde dans un pays inconnu, emprisonné sans charge.
Mia Unger, avocate d’Orville Etoria
Ce cas met en lumière une question cruciale : pourquoi envoyer quelqu’un dans un pays tiers alors que son pays d’origine, la Jamaïque, était prêt à l’accueillir ? Cette décision semble refléter une volonté d’éloigner à tout prix les migrants, même au détriment de la logique ou de l’humanité.
Vers un Changement de Politique ?
L’Eswatini a récemment annoncé vouloir rapatrier tous les expulsés dans leurs pays d’origine. Cependant, pour l’instant, seul Orville Etoria a bénéficié de cette mesure. Les autres restent coincés, sans perspective claire de retour. Les défenseurs des droits humains appellent à une révision complète de ces accords, plaidant pour plus de transparence et de respect des droits fondamentaux.
En attendant, les familles continuent de se battre. Elles s’appuient sur les réseaux sociaux pour retrouver leurs proches et sur des avocats dévoués pour faire entendre leur voix. Mais face à un système aussi opaque, leurs chances de succès restent minces.
| Pays d’origine | Nombre d’expulsés | Situation actuelle |
|---|---|---|
| Cuba | 1 | Détenu en Eswatini |
| Jamaïque | 1 | Rapatrié |
| Vietnam | 2 | Détenus en Eswatini |
| Laos | 1 | Détenu en Eswatini |
| Yémen | 1 | Détenu en Eswatini |
Ce tableau illustre la diversité des origines des expulsés et leur situation actuelle, soulignant l’urgence d’une action internationale pour résoudre ce drame humain.
Un Appel à la Justice
L’histoire des expulsés vers l’Eswatini est plus qu’un fait divers : elle révèle les failles d’un système migratoire qui privilégie l’efficacité au détriment de l’humanité. Les familles, les avocats et les défenseurs des droits humains continuent de se mobiliser pour faire la lumière sur ces pratiques. Mais sans une pression internationale accrue, ces hommes risquent de rester oubliés dans une prison lointaine, loin de tout ce qu’ils ont connu.
En fin de compte, cette affaire pose une question fondamentale : jusqu’où un pays peut-il aller pour gérer son immigration, et à quel prix ? Les réponses, pour l’instant, restent suspendues, tout comme la vie de ces hommes, coincés dans un pays qui leur est étranger.