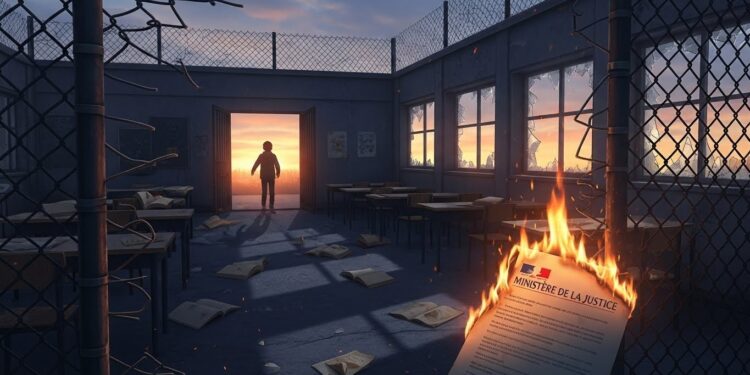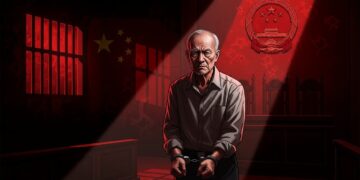Imaginez une structure censée être le dernier rempart avant la prison pour les mineurs les plus durs. Des murs, des caméras, un encadrement renforcé. Et pourtant, un jeune sur cinq parvient à s’enfuir comme on quitte un simple foyer ouvert. C’est la réalité brutale que Gérald Darmanin a mise en lumière ce mercredi matin en annonçant purement et simplement la fin des centres éducatifs fermés publics.
Une mesure « ni fermée, ni éducative » : les mots qui tuent
Le verdict est tombé sans appel. Devant les agents de la Protection judiciaire de la jeunesse et les magistrats, le ministre de la Justice n’a pas mâché ses mots : les CEF « n’ont pas démontré leur efficacité depuis leur création » en 2002. Pire, ils ne sont, selon lui, ni fermés ni éducatifs. Une phrase qui résume vingt-trois ans d’illusion collective.
Créés sous le gouvernement Jospin puis renforcés sous Sarkozy, ces établissements devaient incarner la réponse pénale « dure mais humaine » à la délinquance juvénile grave. Le principe était simple : prendre douze adolescents multirécidivistes, les placer sous haute surveillance et leur imposer un programme éducatif intense avant qu’ils ne basculent définitivement dans la criminalité adulte. Sur le papier, c’était parfait.
Des chiffres qui accablent
Dans la réalité, les chiffres parlent d’eux-mêmes. Entre 15 et 20 % de fugues, exactement comme dans les foyers classiques. À quoi bon investir des millions si le taux d’évasion est identique à celui d’une structure ouverte ? Et que dire du temps scolaire ? À peine huit heures par semaine. Moins qu’un collégien lambda en période de vacances.
Le coût, lui, donne le vertige. Chaque place en CEF revient 25 % plus cher qu’un hébergement traditionnel. Pour quel résultat ? Des jeunes qui fuguent, qui recommencent, et parfois qui passent à des actes bien plus graves une fois dehors.
« Ce n’est plus tenable. Nous allons transformer les 19 CEF publics en foyers renforcés et réorienter les 8 en construction vers des unités à priorité éducative. »
Gérald Darmanin, ministre de la Justice
Que va-t-il se passer concrètement ?
Le plan est déjà bouclé. Les 19 centres publics existants seront reconvertis en « foyers renforcés ». Les huit projets en cours seront détournés vers d’autres formes d’accompagnement. Seuls les 39 CEF gérés par le secteur associatif continueront d’exister, pour l’instant.
Parallèlement, une nouvelle circulaire – la première depuis 2016 – a été adressée aux parquets et à la PJJ. Objectif : pousser les juges pour enfants à prononcer des contrôles judiciaires plus contraignants, généraliser l’interdiction des téléphones portables et renforcer l’accompagnement éducatif hors les murs.
En clair, on abandonne l’idée même de « fermeture » pour miser tout sur le suivi en milieu ouvert ou semi-ouvert. Un pari risqué quand on connaît le profil des jeunes concernés : vols avec violence, trafics, agressions sexuelles, parfois tentatives d’homicide.
Vingt ans d’expérimentations ratées
Retour en arrière. Les CEF sont nés en 2002, puis véritablement lancés en 2007 avec la loi de prévention de la délinquance. L’idée : éviter l’incarcération tout en imposant une discipline de fer. Chaque centre accueille au maximum douze jeunes, 24 heures sur 24, avec fouilles, uniformes dans certains cas, et un emploi du temps militaire.
Mais très vite, les dysfonctionnements apparaissent. Incendies volontaires, agressions sur le personnel, consommation de drogue à l’intérieur, fugues spectaculaires par les toits ou en sciant les grilles. Certains établissements deviennent ingérables. En 2022, le centre de Pionsat dans le Puy-de-Dôme faisait la une : 17 des 18 éducateurs en arrêt maladie, des jeunes qui dictaient leur loi.
Et que dire des sorties ? De nombreux anciens pensionnaires se retrouvent quelques mois plus tard en quartier de mineurs ou en prison ferme. Le CEF n’aura été qu’une parenthèse, parfois l’école du crime en plus organisé.
Pourquoi un tel fiasco ?
Plusieurs raisons s’entremêlent. D’abord, le recrutement. Les CEF accueillent les profils les plus complexes : troubles psychiatriques lourds, addictions, absence totale de repères familiaux. Ensuite, le turnover infernal du personnel. Les éducateurs, mal payés et exposés à une violence quotidienne, craquent les uns après les autres.
Enfin, le paradoxe fondateur : comment être à la fois fermé et éducatif ? La privation de liberté sans le cadre carcéral strict crée une zone grise où ni la sanction ni l’accompagnement ne fonctionnent pleinement. Résultat : les jeunes testent en permanence les limites et finissent souvent par les franchir.
Le saviez-vous ? Un placement en CEF coûte environ 600 à 800 euros par jour et par jeune, selon les années et les régions. À titre de comparaison, une journée en quartier mineurs d’une prison revient à environ 300 euros. Le « ni fermé ni éducatif » a donc aussi été un gouffre financier.
Et maintenant ? Les dangers du tout-milieu-ouvert
La question qui brûle les lèvres : que va-t-on faire de ces centaines de mineurs ultra-violents ou multirécidivistes ? Les foyers renforcés promis seront-ils vraiment plus efficaces ? Rien n’est moins sûr. Sans murs ni grilles, le risque de fugue reste entier. Et le suivi en milieu ouvert, s’il fonctionne pour certains, s’avère souvent insuffisant pour les cas les plus graves.
Certains magistrats s’inquiètent déjà. Prononcer une mesure éducative sans véritable contrainte physique revient, dans certains cas, à laisser le jeune poursuivre ses activités délinquantes sous couvert de « prise en charge ». Les victimes, elles, risquent de payer le prix de cette nouvelle philosophie.
Car derrière les discours sur « l’humain » et « la deuxième chance », il y a des faits divers qui s’accumulent. Des viols commis par des jeunes en fugue d’un CEF. Des rodéos mortels menés par d’anciens pensionnaires. Des règlements de comptes au couteau quelques semaines après une sortie.
Une décision courageuse ou un aveu d’impuissance ?
En enterrant les CEF publics, Gérald Darmanin prend une décision forte. Reconnaître l’échec d’une politique menée par tous les gouvernements depuis vingt ans demande un certain courage. Mais cette décision ressemble aussi à un aveu : l’État n’est plus capable d’encadrer ses mineurs les plus dangereux autrement qu’en les laissant dans la nature avec un bracelet électronique ou un éducateur débordé.
Le message envoyé est terrible : on préfère transformer des centres censés être ultra-sécurisés en simples foyers parce qu’on n’arrive ni à les rendre étanches, ni à y faire de l’éducation digne de ce nom. Entre la fermeté de façade et le laxisme réel, le choix semble fait.
Et pendant ce temps, la délinquance juvénile continue d’exploser dans certaines villes. Les faits divers s’enchaînent. Les Français, eux, se demandent quand on arrêtera de tourner autour du pot et quand on osera enfin nommer les choses : certains jeunes ne sont plus éducables dans le cadre actuel et nécessitent une réponse pénale ferme, durable et assumée.
La fin des CEF n’est pas seulement la mort d’une structure. C’est peut-être le début d’une nouvelle ère où l’on devra choisir entre deux options radicales : reconstruire un vrai système de sanction pour les mineurs ou accepter que certains quartiers deviennent des zones de non-droit où même les adolescents les plus violents circulent en toute impunité.
Le compte à rebours est lancé.