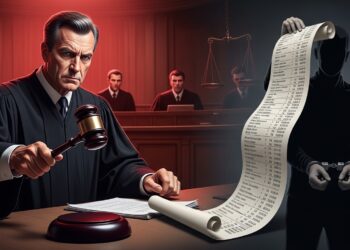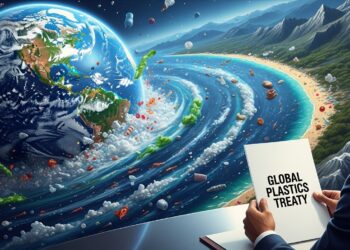Dans l’enceinte verdoyante du parc des Nations Unies à Genève, une mélodie s’élève, douce et poignante. Des voix autochtones, venues des confins de l’Amérique du Nord, s’unissent dans un chant dédié à l’eau, un appel vibrant à la préservation de la vie. Ce rituel impromptu, porté par six femmes et un jeune homme, n’est pas qu’un acte symbolique : il incarne un cri d’alarme face à une crise environnementale qui menace leur existence. Alors que 184 gouvernements peinent à s’accorder sur un traité contre la pollution plastique, ces voix rappellent l’urgence d’agir.
Un Rituel pour l’Eau et la Vie
Au cœur de Genève, sous un arbre centenaire, un cercle se forme. Les participants, pieds nus, se tiennent la main, leurs voix s’élevant dans une mélopée monotone mais chargée d’émotion. Ce chant, dédié à l’eau, est un rituel de purification, une pratique ancestrale appelée « faire la médecine ». Parmi eux, un jeune homme, coiffé d’une toque ornée de plumes, distribue une coupe où brûlent des herbes et de la graisse de phoque. Chaque femme, avec respect, guide la fumée vers son visage, comme pour se purifier et se connecter à la terre.
Ce moment n’est pas anodin. Il s’inscrit dans un contexte de négociations internationales tendues, où des délégués du monde entier tentent de rédiger le premier traité international contre la pollution plastique. Ces représentants autochtones, venus de territoires comme le Williams Treaty au Canada ou les côtes de l’Alaska, portent un message clair : la crise plastique ne peut attendre.
L’Alaska, Sentinelle de la Pollution
L’Alaska, avec ses paysages glacés et ses écosystèmes uniques, est en première ligne face à la pollution. Les courants marins et aériens y charrient des microplastiques et des produits chimiques toxiques, comme le mercure ou les PCB, des polluants interdits dans de nombreux pays mais toujours présents dans l’environnement. Ces substances, issues notamment de l’industrie pétrolière et des plastiques, s’accumulent dans les régions polaires, affectant les populations locales qui n’en sont pourtant pas responsables.
« L’Alaska est baigné de produits chimiques toxiques, attirés par les courants marins et aériens. »
Henri Bourgeois Costa, expert en pollutions plastiques
Cette réalité est confirmée par des études scientifiques. Les populations autochtones, qui dépendent de la chasse et de la pêche pour leur subsistance, se retrouvent exposées à ces polluants à travers leur alimentation. Les poissons, les phoques et les oiseaux, piliers de leur régime alimentaire, sont contaminés, menaçant la sécurité alimentaire de ces communautés.
Un Combat Autochtone pour la Justice
Panganga Pungowiyi, militante inuit de l’Alaska, incarne cette lutte. Avec ses tatouages traditionnels au menton, elle représente le « réseau indigène de l’environnement » et plaide pour une transition juste. Son message est clair : le futur traité doit protéger les populations les plus vulnérables, celles qui subissent les conséquences de choix industriels qu’elles n’ont pas faits.
« Nous avons le devoir de partager ce que nous apprenons de l’écosystème », explique-t-elle. Pour elle, la pollution plastique n’est pas un problème lointain : elle empoisonne directement les terres, les eaux et les corps des habitants de l’Alaska. Les microplastiques, ces fragments invisibles issus de la dégradation des plastiques, s’infiltrent partout, des rivières aux organismes vivants.
Les impacts de la pollution plastique en Alaska :
- Contamination des poissons et mammifères marins.
- Accumulation de microplastiques dans les écosystèmes polaires.
- Menaces sur la santé humaine via l’alimentation.
- Risques accrus pour la biodiversité locale.
Le Plastique, Ennemi des Écosystèmes
Une étude de l’université de l’État de Washington, menée en 2020, met en lumière un cas alarmant : le 6PDD, un additif chimique utilisé dans les pneus automobiles, affecte la reproduction du saumon, une espèce clé en Alaska. Ce composé, libéré par l’usure des pneus, est transporté par les eaux de pluie jusqu’aux rivières, où il devient un poison pour les poissons. Pour les communautés autochtones, cela signifie une menace directe sur leur mode de vie.
« Plus de poissons, plus de phoques, plus de nourriture. »
Panganga Pungowiyi, militante inuit
Les conséquences sont dramatiques. Les oiseaux et mammifères marins montrent des signes de maladies, et les enfants des communautés autochtones sont exposés à ces toxines dès leur plus jeune âge. « Nous sommes contaminés par l’eau, la nourriture, et même les forages que nous réalisons pour survivre », déplore Panganga.
Une Dépendance Forcée aux Produits Toxiques
Adrienne Aakaluk Blatchford, une autre militante venue d’un petit village de 750 habitants en Alaska, partage ce constat. Dans sa communauté, la dépendance aux produits importés, souvent coûteux, aggrave la situation. Un poulet congelé peut coûter jusqu’à 76 dollars dans les supermarchés locaux, rendant impossible pour beaucoup de se détourner des ressources traditionnelles, pourtant contaminées.
« Nous dépendons de produits malsains, et il devient de plus en plus difficile de garantir notre sécurité alimentaire », explique-t-elle. Cette réalité place les communautés autochtones dans une position de vulnérabilité économique et écologique, sans alternatives viables.
| Problème | Impact | Solution proposée |
|---|---|---|
| Microplastiques | Contamination des écosystèmes et de la chaîne alimentaire | Interdiction des additifs chimiques toxiques |
| Pollution chimique | Maladies chez les animaux et les humains | Réglementation stricte des industries |
| Coût des alternatives | Dépendance aux ressources polluées | Soutien économique aux communautés |
Un Appel à des Décisions Collectives
Face à cette crise, les militantes comme Adrienne insistent sur la nécessité d’un traité fort, incluant une liste claire d’additifs chimiques interdits. Ce texte, en cours de négociation à Genève, doit non seulement limiter la production de plastique, mais aussi protéger les populations les plus exposées. « Si les animaux meurent, nous mourons », résume Adrienne, soulignant la relation symbiotique entre son peuple et la nature.
Le rituel dans le parc des Nations Unies, marqué par les larmes d’Adrienne, est un symbole fort. Il rappelle que derrière les discussions diplomatiques se jouent des vies humaines, des cultures et des écosystèmes entiers. Les négociations, souvent freinées par des intérêts économiques, doivent aboutir à des mesures concrètes pour répondre à cet appel.
Un Message Universel
Le chant des autochtones à Genève résonne au-delà des frontières de l’Alaska. Il porte un message universel : la pollution plastique est une crise mondiale qui exige une réponse collective. Les populations les plus vulnérables, comme celles des régions polaires, sont les premières touchées, mais les conséquences concernent tous les habitants de la planète.
En attendant un accord, les voix de Panganga, Adrienne et leurs compagnons continuent de s’élever. Leur présence à Genève, soutenue par des associations, est un rappel que les solutions doivent inclure ceux qui subissent de plein fouet les erreurs du passé. Le traité plastique, s’il voit le jour, devra être à la hauteur de cet enjeu.
Agir maintenant pour un avenir durable :
- Soutenir les populations autochtones dans leur lutte.
- Exiger des réglementations internationales strictes.
- Promouvoir une consommation responsable pour réduire les plastiques.
Le chant pour l’eau, entonné dans le parc des Nations Unies, n’était pas seulement un rituel. C’était un appel à l’humanité, un rappel que la terre, l’eau et les générations futures dépendent des décisions prises aujourd’hui. Alors que les négociations se prolongent, une question demeure : les dirigeants mondiaux entendront-ils ce cri ?