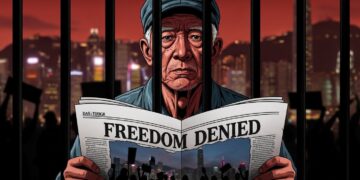Imaginez une organisation centenaire, pilier du dialogue social mondial, qui se retrouve soudain incapable de payer ses factures. C’est exactement ce qui arrive à l’Organisation internationale du travail en cette fin d’année 2025. Jeudi dernier, son Conseil d’administration a donné son accord pour lancer une réforme d’ampleur, alors que l’institution traverse la pire crise financière de son histoire récente.
Un feu vert obtenu après des négociations tendues
Après plusieurs jours de discussions particulièrement âpres, les représentants des gouvernements, des employeurs et des syndicats – cette fameuse structure tripartite qui fait la singularité de l’OIT – ont fini par tomber d’accord. Le texte adopté ouvre la voie à un processus en deux temps : des mesures d’urgence immédiates, suivies d’une refonte structurelle plus profonde.
Concrètement, le directeur général, Gilbert Houngbo, peut désormais préparer des propositions qu’il soumettra en mars prochain. En parallèle, rien ne l’empêche de poursuivre les économies déjà engagées : gel des embauches, réduction drastique des coûts opérationnels, incitations aux départs volontaires.
Un tiers du budget qui manque à l’appel
Pour comprendre l’urgence, il faut regarder les chiffres. Le montant total des contributions non versées atteint environ 250 millions de francs suisses, soit près de 271 millions d’euros. Cela représente presque un tiers du budget biennal de l’organisation.
Le principal contributeur, les États-Unis, pèse à lui seul 22 % du financement régulier. Washington accumule aujourd’hui plus de 173 millions de dollars de retard pour les années 2024 et 2025. Mais l’Amérique n’est pas seule en cause : de nombreux pays réduisent leur aide internationale ou tardent à honorer leurs engagements.
« La crise financière à laquelle nous faisons face est grave, elle est sans précédent si on regarde les dernières décennies »
Gilbert Houngbo, directeur général de l’OIT
Vers une cure d’austérité sans précédent
Le scénario le plus probable, selon la direction, prévoit une réduction du budget de 15 à 20 % pour 2026-2027 si une partie significative des arriérés n’est pas recouvrée. Autant dire que l’organisation se prépare au pire.
Parmi les pistes sérieusement envisagées :
- Réduction importante du nombre de postes
- Délocalisation de certaines activités hors de Genève
- Regroupement de services avec d’autres agences onusiennes
- Diminution du nombre de réunions et de publications
La Suisse, avec son coût de la vie parmi les plus élevés au monde, est particulièrement visée. Plusieurs agences onusiennes ont déjà commencé à déplacer des postes vers des pays moins onéreux.
Le tripartisme en question ?
Ce qui rend la situation particulièrement délicate, c’est la nature même de l’OIT. Contrairement à la plupart des organisations internationales, elle fonctionne sur un modèle où les décisions sont prises conjointement par les gouvernements, les employeurs et les travailleurs. Toute réforme touche donc à l’âme de l’institution.
Les partenaires sociaux craignent que les coupes budgétaires ne réduisent leur capacité à participer pleinement aux travaux. Moins de réunions, moins de moyens pour les délégations des pays en développement, moins d’experts… les risques sont nombreux.
Un contexte international plus large
Cette crise ne sort pas de nulle part. Elle s’inscrit dans un mouvement plus global de remise en question du multilatéralisme et des financements des organisations internationales. Plusieurs pays, notamment parmi les grands contributeurs, revoient leurs priorités budgétaires.
La tendance à la baisse de l’aide publique au développement, combinée à des arriérés croissants, touche d’autres agences du système des Nations Unies. Mais l’OIT, avec son modèle tripartite et son ancrage à Genève, se retrouve en première ligne.
Gilbert Houngbo face à un défi historique
Arrivé à la tête de l’organisation en octobre 2022, le Togolais Gilbert Houngbo hérite d’une situation qu’aucun de ses prédécesseurs n’avait connue à ce point. Il doit à la fois gérer l’urgence financière et penser l’avenir de l’institution à moyen et long terme.
Ses propositions de mars 2026 seront scrutées à la loupe. Trouver le bon équilibre entre rigueur budgétaire et préservation de l’efficacité, tout en maintenant la confiance des partenaires sociaux, relève de la mission impossible.
Quelles conséquences pour le monde du travail ?
Au-delà des questions internes, c’est toute la capacité de l’OIT à remplir sa mission qui est en jeu. L’organisation fixe les normes internationales du travail, supervise leur application, apporte une assistance technique aux pays membres.
Si ses moyens fondent comme neige au soleil, ce sont les travailleurs les plus vulnérables qui risquent d’en pâtir en premier. Moins de contrôle sur le respect des conventions, moins d’accompagnement pour les transitions écologiques et numériques justes, moins de voix pour défendre le dialogue social dans un monde où il est souvent menacé.
La réforme qui s’engage n’est donc pas qu’une question comptable. C’est un tournant potentiellement historique pour l’une des plus anciennes institutions issues du traité de Versailles de 1919.
Les prochains mois seront décisifs. Le monde du travail regarde Genève avec une inquiétude légitime. L’OIT saura-t-elle se réinventer sans renier ce qui fait son identité ? La réponse, en mars prochain, pourrait bien redessiner les contours du dialogue social mondial pour les décennies à venir.