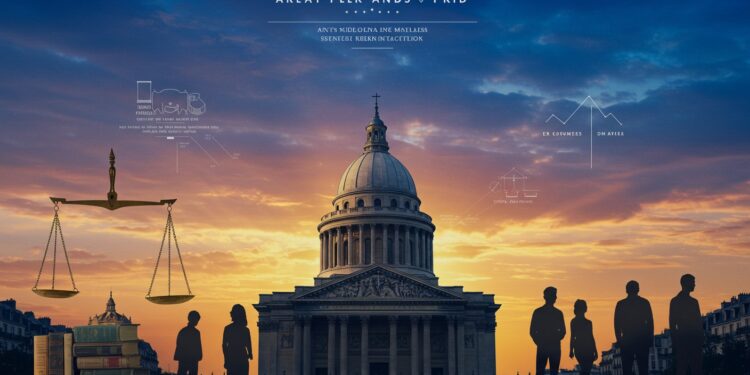Pourquoi une simple phrase gravée sur un monument peut-elle déclencher un débat national ? La devise du Panthéon, « Aux grands hommes, la patrie reconnaissante », est au cœur d’une proposition audacieuse portée par Élisabeth Borne. En s’attaquant à ce symbole, la ministre de l’Éducation nationale soulève une question essentielle : comment les mots façonnent-ils notre vision de l’histoire et de l’égalité ? Cet article explore les enjeux de ce débat, entre stéréotypes de genre, reconnaissance historique et éducation.
Un Symbole Chargé d’Histoire Face à la Modernité
Le Panthéon, joyau architectural au cœur de Paris, n’est pas qu’un monument : c’est un lieu de mémoire. Sa devise, inscrite depuis des siècles, célèbre les « grands hommes » ayant marqué la nation. Mais en 2025, cette formulation soulève une question : exclut-elle les femmes qui ont, elles aussi, façonné l’histoire ? Élisabeth Borne, dans une conférence récente, a appelé à ouvrir un débat sur cette phrase, jugée trop masculine par certains. Elle argue que les mots ont un pouvoir symbolique immense, notamment sur les jeunes générations.
Ce n’est pas la première fois que le Panthéon fait l’objet de discussions. Depuis l’entrée de figures féminines comme Marie Curie ou Simone Veil, le monument incarne une reconnaissance plus large des contributions à la nation. Pourtant, la devise reste inchangée, comme figée dans le temps. Ce contraste entre l’évolution des mentalités et la permanence des mots interpelle.
Les Stéréotypes de Genre au Cœur du Débat
Pourquoi cette devise pose-t-elle problème ? Selon Élisabeth Borne, elle envoie un « message contradictoire » aux jeunes filles. En valorisant uniquement les « grands hommes », elle pourrait renforcer des stéréotypes de genre qui limitent les ambitions féminines, notamment dans des domaines comme les sciences. Les chiffres parlent d’eux-mêmes : en France, seulement 28 % des étudiants en filières scientifiques sont des femmes, selon une étude récente.
Si en levant les yeux, les femmes ne voient pas la société reconnaître pleinement leur place dans son histoire, alors nous leur envoyons un message contradictoire.
Élisabeth Borne
Cette réflexion s’inscrit dans une lutte plus large contre les déterminismes. Les stéréotypes, souvent ancrés dès l’enfance, influencent les choix de carrière. Une jeune fille passionnée de mathématiques pourrait, par exemple, se détourner de cette voie si elle perçoit ce domaine comme « masculin ». Changer la devise du Panthéon pourrait-il contribuer à briser ces barrières invisibles ?
Un Plan pour l’Égalité dans l’Éducation
La proposition d’Élisabeth Borne ne se limite pas à un changement symbolique. Elle s’accompagne d’un ambitieux « plan Filles et Maths », destiné à encourager les jeunes filles à s’orienter vers les filières scientifiques. Ce programme, complémentaire au « plan Avenir », vise à déconstruire les préjugés dès l’école. Parmi les mesures envisagées :
- Ateliers de sensibilisation : Des interventions dans les collèges pour présenter des modèles féminins dans les sciences.
- Formations pour enseignants : Sensibiliser le corps éducatif aux biais de genre.
- Bourses spécifiques : Soutien financier pour les étudiantes en filières scientifiques.
Ces initiatives s’appuient sur un constat : l’éducation est un levier essentiel pour transformer les mentalités. En parallèle, la ministre souhaite que les symboles publics, comme la devise du Panthéon, reflètent cette ambition d’égalité.
Le Panthéon : Une Histoire Inclusive ?
Le Panthéon n’est pas qu’un mausolée : il raconte une histoire. Parmi ses « pensionnaires », des femmes exceptionnelles ont marqué leur époque. Citons par exemple :
- Marie Curie : Double lauréate du prix Nobel, pionnière en physique et chimie.
- Simone Veil : Survivante de la Shoah, figure de la lutte pour les droits des femmes.
- Geneviève de Gaulle-Anthonioz : Résistante et défenseuse des plus démunis.
Ces figures montrent que le Panthéon est déjà un lieu d’inclusion. Pourtant, la devise ne reflète pas cette diversité. Faut-il la modifier pour rendre hommage à toutes les contributions, sans distinction de genre ? Ou risque-t-on de dénaturer un symbole historique ?
Les Arguments Pour et Contre un Changement
Le débat sur la devise du Panthéon divise. D’un côté, les défenseurs d’un changement estiment qu’il est temps d’adopter une formulation plus inclusive, comme « Aux grandes figures, la patrie reconnaissante ». Ce choix enverrait un signal fort : la nation valorise toutes ses figures historiques, sans distinction.
De l’autre côté, certains s’opposent à cette idée, arguant que la devise est un héritage culturel. Modifier un symbole aussi ancien pourrait être perçu comme une rupture avec l’histoire. Un historien anonyme a récemment déclaré :
Changer la devise, c’est effacer une trace du passé. Il faut préserver notre patrimoine, tout en éduquant sur son contexte.
Historien anonyme
Ce point de vue met en lumière une tension : comment concilier respect de l’histoire et adaptation aux valeurs contemporaines ?
Un Débat qui Dépasse le Panthéon
La proposition d’Élisabeth Borne s’inscrit dans un mouvement plus large de réflexion sur la place des femmes dans l’espace public. Ces dernières années, plusieurs initiatives ont vu le jour pour promouvoir l’égalité :
- Visibilité des femmes : Des campagnes pour nommer plus de rues et de lieux publics en l’honneur de figures féminines.
- Éducation inclusive : Révision des manuels scolaires pour inclure davantage de femmes dans les récits historiques.
- Représentation médiatique : Études sur la sous-représentation des femmes dans le cinéma et les médias.
Ce débat sur la devise du Panthéon s’ajoute à ces efforts. Il invite à repenser la manière dont la société raconte son histoire et valorise ses héros, qu’ils soient hommes ou femmes.
Quel Impact sur les Jeunes Générations ?
Les jeunes filles, en particulier, sont au cœur de cette réflexion. Les stéréotypes de genre influencent leurs choix dès le plus jeune âge. Une étude de 2023 a révélé que 65 % des adolescentes estiment que les sciences sont un « domaine d’hommes ». En modifiant des symboles comme la devise du Panthéon, le gouvernement espère envoyer un message clair : toutes les carrières sont accessibles.
| Domaine | Part des femmes (2023) | Objectif 2030 |
|---|---|---|
| Sciences physiques | 28 % | 40 % |
| Ingénierie | 22 % | 35 % |
| Informatique | 18 % | 30 % |
Ce tableau illustre l’ampleur du défi. En combinant des réformes éducatives et des changements symboliques, le gouvernement espère inverser la tendance.
Vers une Consultation Publique ?
Pour trancher ce débat, une consultation publique pourrait être organisée, à l’image de celle lancée en 2013 pour choisir de nouvelles figures à panthéoniser. Une telle démarche permettrait d’impliquer les citoyens dans une réflexion collective sur l’histoire et l’égalité. Mais elle risque aussi de polariser les opinions, entre défenseurs du patrimoine et partisans de l’inclusivité.
Quoi qu’il en soit, ce débat ne se limite pas à une question de mots. Il touche à l’essence même de la société française : comment honorer le passé tout en construisant un avenir plus équitable ?
Et Après ?
La proposition d’Élisabeth Borne marque un tournant. Elle invite à repenser non seulement la devise du Panthéon, mais aussi la manière dont la société aborde les questions de genre. Si ce changement symbolique voit le jour, il pourrait inspirer d’autres initiatives pour promouvoir l’égalité dans l’éducation, les sciences et au-delà.
En attendant, le débat est lancé. Les mots gravés sur le Panthéon continueront-ils à célébrer les « grands hommes » seuls, ou évolueront-ils pour refléter une société plus inclusive ? Une chose est sûre : cette discussion ne laissera personne indifférent.
Et vous, que pensez-vous de ce débat ? Une devise inclusive est-elle nécessaire pour avancer vers l’égalité ?