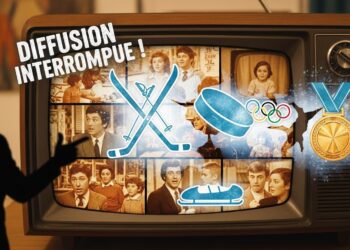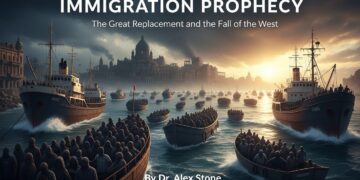Imaginez-vous sur la butte Montmartre en 1895, entouré d’une foule émerveillée par l’allumage des premiers réverbères électriques. Une lueur blanche jaillit, illuminant les visages d’une jeunesse avide de progrès. Puis, un saut dans le temps : 2025, une époque d’innovations fulgurantes, où les descendants de ces mêmes rêveurs naviguent dans un monde connecté. C’est cette passerelle entre deux époques que tisse avec brio La Venue de l’Avenir, le dernier film de Cédric Klapisch, présenté hors compétition à Cannes 2025. Une fresque qui célèbre l’émerveillement, mais n’élude pas les fragilités humaines.
Un voyage entre passé et futur
Pour la première fois, Cédric Klapisch, connu pour ses récits vibrants sur la jeunesse et les liens humains, s’aventure dans le cinéma en costumes. Son film, projeté sur la Croisette, entrelace deux temporalités : l’effervescence de l’ère impressionniste et les questionnements de notre époque contemporaine. Cette ambition narrative, qui pourrait sembler audacieuse, est portée par une mise en scène fluide et une direction d’acteurs remarquable. Mais qu’est-ce qui rend ce film si singulier ?
1895 : l’aube d’une révolution lumineuse
Le film s’ouvre sur une scène mémorable : quatre jeunes, perchés sur les hauteurs de Montmartre, assistent à l’électrification de l’avenue de l’Opéra. Cette séquence, baignée d’une lumière douce et dorée, capture l’essence d’une époque en pleine mutation. Les réverbères, symboles d’un progrès technique, deviennent une métaphore de l’espoir et de la curiosité. Klapisch excelle à retranscrire cette joie collective, cet instant où une foule entière retient son souffle devant une nouveauté.
« J’ai voulu montrer ce moment où l’humanité bascule dans une nouvelle ère, avec cette innocence face au progrès. »
Un cinéaste évoquant son inspiration
Ce n’est pas seulement un décor historique. Klapisch recrée l’atmosphère bouillonnante des années impressionnistes, où artistes, poètes et rêveurs se croisaient dans les cafés parisiens. Les costumes, minutieusement conçus, et les dialogues, pleins de fougue, plongent le spectateur dans une époque où chaque innovation semblait ouvrir un monde de possibles.
2025 : un miroir de notre présent
En parallèle, le film nous transporte en 2025, dans une société ultra-connectée où les défis sont d’une autre nature. Les descendants des personnages de 1895 affrontent des questionnements universels : comment trouver sa place dans un monde en perpétuelle accélération ? Klapisch, fidèle à son style, explore les relations humaines avec une tendresse désarmante. Les personnages, portés par un casting étoilé, naviguent entre aspirations personnelles et pressions sociétales.
Les thèmes clés du film
- Progrès : De l’électricité en 1895 aux technologies de 2025, une réflexion sur l’impact des innovations.
- Héritage : Les liens entre générations, entre rêves d’hier et réalités d’aujourd’hui.
- Émerveillement : Une célébration de la capacité humaine à s’émouvoir face au changement.
Cette alternance entre les deux époques n’est pas sans rappeler les fresques historiques comme Les Enfants du Paradis, mais avec une touche contemporaine. Klapisch ne cherche pas à opposer les époques, mais à montrer leurs échos. Les luttes intérieures des personnages de 2025 résonnent avec les espoirs de ceux de 1895, créant une harmonie narrative captivante.
Un casting qui fait vibrer la Croisette
Le film brille par son casting, un mélange d’acteurs confirmés et de jeunes talents. Vincent Macaigne, fidèle collaborateur du réalisateur, apporte une intensité émouvante à son rôle, tandis que Paul Kircher incarne une jeunesse en quête de sens. Leur alchimie, mêlée à la direction sensible de Klapisch, donne vie à des personnages complexes, jamais caricaturaux.
Chaque acteur semble avoir été choisi avec soin pour incarner les dualités du film : tradition et modernité, innocence et maturité. Les scènes de groupe, notamment, rappellent le talent du cinéaste pour orchestrer des dynamiques collectives, comme il l’avait fait dans L’Auberge espagnole.
Une mise en scène entre éclat et fragilité
La mise en scène de Klapisch est un équilibre entre exubérance visuelle et moments d’intimité. Les plans sur Paris, qu’il s’agisse de la capitale impressionniste ou de la métropole futuriste, capturent une ville en perpétuelle réinvention. Les couleurs, vibrantes dans les scènes de 1895, contrastent avec les teintes plus froides de 2025, renforçant le dialogue entre les époques.
Pourtant, le film n’est pas exempt de défauts. Certains clichés, comme des dialogues un peu trop explicatifs, ou une tendance à l’esthétique chromo, peuvent freiner l’élan. Mais ces imperfections sont éclipsées par la générosité du récit, qui embrasse une multitude de personnages et d’histoires sans jamais perdre le spectateur.
« Ce film, c’est une célébration de l’élan humain, avec ses maladresses et ses éclats. »
Un critique après la projection à Cannes
Cannes 2025 : un écrin pour Klapisch
Pour sa première participation à Cannes, Klapisch a marqué les esprits. Hors compétition, La Venue de l’Avenir a suscité des applaudissements nourris, témoignant de l’impact de cette œuvre ambitieuse. Le festival, connu pour son exigence, a offert au cinéaste une scène idéale pour dévoiler son projet le plus audacieux à ce jour.
| Aspect | Points forts | Points faibles |
|---|---|---|
| Mise en scène | Visuels saisissants, transitions fluides | Quelques clichés esthétiques |
| Casting | Alchimie parfaite, performances nuancées | Rôles secondaires parfois effacés |
| Narration | Équilibre entre époques, émotion universelle | Dialogues parfois trop didactiques |
Le choix de présenter le film hors compétition reflète peut-être une certaine humilité de la part du cinéaste, qui se décrit lui-même comme un « rêveur lucide ». Cette posture, à l’image de son œuvre, mêle ambition et retenue, audace et simplicité.
Un écho universel
Ce qui frappe dans La Venue de l’Avenir, c’est sa capacité à parler à tous. Les thèmes du progrès, de l’héritage et de l’émerveillement transcendent les époques et les cultures. En 1895, l’électricité était une révolution ; en 2025, ce sont les intelligences artificielles et les réseaux sociaux qui redéfinissent nos vies. Klapisch pose une question essentielle : comment rester humain face à tant de changements ?
Le film ne donne pas de réponses toutes faites. Il invite plutôt à la réflexion, à travers des personnages qui, malgré leurs différences, partagent une même quête de sens. Cette universalité, portée par une mise en scène chaleureuse, fait de La Venue de l’Avenir une œuvre qui résonne bien au-delà de la Croisette.
Pourquoi ce film marque-t-il un tournant ?
Pour Klapisch, ce film marque une nouvelle étape dans sa carrière. Après des œuvres comme Paris ou Ce qui nous lie, il s’attaque à un projet plus ample, plus risqué. Le pari de mêler fresque historique et récit contemporain est audacieux, mais il est relevé avec une sincérité désarmante. Le cinéaste, habitué à capturer les émotions de la jeunesse, élargit ici son regard pour embrasser plusieurs générations.
Un film qui célèbre l’élan humain, avec ses maladresses et ses éclats.
En somme, La Venue de l’Avenir est une ode à la capacité humaine à s’émerveiller, à créer et à se réinventer. Malgré quelques imperfections, le film séduit par sa générosité et son ambition. À Cannes, il a rappelé pourquoi le cinéma reste un art capable de rassembler, d’émouvoir et de faire rêver.
Et vous, serez-vous prêt à vous laisser emporter par cette fresque qui relie passé et futur ? Une chose est sûre : Klapisch signe ici une œuvre qui restera dans les mémoires, un pont lumineux entre deux siècles, entre l’histoire et l’avenir.