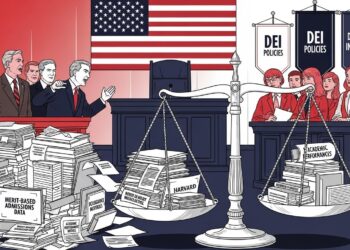À Ouagadougou, les conversations animées qui faisaient vibrer les bars populaires ont laissé place à un silence pesant. Autrefois, les Burkinabè débattaient avec passion de politique, un héritage de leur attachement à la liberté d’expression. Aujourd’hui, trois ans après le coup d’État qui a porté le capitaine Ibrahim Traoré au pouvoir, la peur étouffe les voix. Ce jeune militaire de 37 ans, inspiré par l’icône panafricaniste Thomas Sankara, dirige le Burkina Faso d’une main de fer, assumant un régime qui rejette ouvertement l’idée de démocratie.
Un climat de méfiance généralisée
Dans les rues de la capitale, la méfiance s’est installée comme un compagnon omniprésent. Les habitants, craignant des représailles, évitent les sujets sensibles. « On ne parle plus de politique, même entre proches. Un mot de travers, et tu peux disparaître, » confie un résident anonyme. Cette peur n’est pas sans fondement : un décret de 2023 autorise l’enrôlement forcé au front pour combattre les groupes jihadistes, une menace utilisée pour réduire au silence toute critique.
« Dès que tu abordes un sujet politique, tout le monde se tait. Même au sein des familles, des frères se méfient entre eux. »
Un habitant de Ouagadougou
Les comités de vigilance, surnommés « Wayiyans », jouent un rôle clé dans cette surveillance généralisée. Présents aux carrefours stratégiques, ces groupes citoyens, fervents soutiens de la junte, traquent les voix dissidentes. Leur présence constante renforce un climat où chacun surveille l’autre, transformant la société en un espace de suspicion mutuelle.
Une répression brutale des contestations
Les exemples de répression ne manquent pas. Un commerçant, qui s’était publiquement opposé à une mesure gouvernementale visant à réduire les prix des motocyclettes, a été arrêté du jour au lendemain et envoyé au front. Cet incident, loin d’être isolé, illustre la brutalité avec laquelle le régime répond à toute forme de contestation. « Pour un mot mal placé, on te traite comme un ennemi, » explique un Ouagalais, reflétant l’angoisse collective.
Un habitant raconte : « On a vu des gens disparaître pour avoir simplement exprimé un désaccord. La peur est partout, et personne n’ose défier le pouvoir. »
Ce climat de terreur s’étend même aux sphères privées. Les discussions politiques, autrefois un pilier de la culture burkinabè, sont désormais taboues. Les habitants se limitent à des sujets neutres comme le sport ou la culture, évitant soigneusement tout ce qui pourrait être perçu comme une critique du régime.
Des initiatives pour façonner une jeunesse docile
Pour imposer sa vision d’un Burkina Faso souverain et décolonisé, la junte mise sur la jeunesse. Des programmes comme les camps de vacances patriotiques forment les enfants de 10 à 15 ans à l’instruction civique et militaire. Vêtus de treillis, ils apprennent à « penser nation » avant leurs intérêts personnels. De même, les nouveaux bacheliers doivent suivre une immersion patriotique d’un mois avant de s’inscrire à l’université, une initiative visant à inculquer une identité nationale alignée sur les valeurs du régime.
« On a appris à repousser nos limites et à penser nation avant de penser à sa petite personne. »
Un participant à l’immersion patriotique
Ces initiatives, présentées comme des efforts pour renforcer le patriotisme, soulèvent des critiques. Un analyste politique anonyme y voit une tentative de « modeler un citoyen militarisé, prêt à obéir sans questionner ». Ce formatage idéologique, selon lui, vise à prévenir toute contestation future en façonnant une jeunesse docile et alignée sur les idéaux de la junte.
Une société sous contrôle : les brigades de propreté
Le contrôle s’étend également au comportement des citoyens. Des brigades laabal, unités spéciales de police, patrouillent les quartiers populaires pour sanctionner les actes jugés inciviques, comme jeter des déchets ou ignorer un feu de circulation. Les contrevenants sont souvent contraints à des travaux d’intérêt général, comme ramasser des ordures, sous l’œil des caméras de la télévision nationale.
| Infraction | Sanction |
|---|---|
| Griller un feu rouge | Travaux d’intérêt général (ex. : nettoyage) |
| Jeter des déchets | Amende ou travaux forcés |
Si l’objectif de promouvoir la propreté est louable, les méthodes musclées suscitent des critiques. « On sait que c’est pour notre bien, mais humilier les gens en public n’est pas la solution, » déplore un habitant. Ces pratiques, souvent diffusées à la télévision, renforcent le sentiment d’un pouvoir omniprésent et intrusif.
Une économie sous tension
Sur le plan économique, la junte a renforcé le secteur agricole et sécurisé les approvisionnements via le port de Lomé, au Togo, évitant ainsi des pénuries majeures. Cependant, les prix des produits de première nécessité ne cessent d’augmenter, pesant lourdement sur le pouvoir d’achat. Dans le nord du pays, plusieurs villes restent sous blocus jihadiste, rendant les convois de ravitaillement vulnérables aux attaques.
Les habitants ressentent cette précarité au quotidien. « On ne manque pas de nourriture, mais tout coûte plus cher. Et dans certaines régions, on ne peut même pas être sûr que les vivres arriveront, » explique un résident. Cette situation fragilise davantage une population déjà sous pression.
Médias muselés et propagande en ligne
La liberté d’expression est une autre victime du régime. Les médias internationaux, accusés de servir des intérêts impérialistes, ont été expulsés, tandis que les journalistes locaux marchent sur des œufs. « Faire un micro-trottoir est devenu impossible. Personne n’ose parler, de peur d’être envoyé au front, » confie un journaliste burkinabè.
« Aujourd’hui, il est difficile de réaliser un micro-trottoir. Les rares personnes qui parlent sont celles qui chantent les louanges du pouvoir. »
Un journaliste local
Sur les réseaux sociaux, en revanche, la junte excelle. Une armée de communicants, certains suivis par des millions d’abonnés, inonde les plateformes de contenus glorifiant Ibrahim Traoré. Ces publications, mêlant discours anti-français et vidéos manipulées par l’intelligence artificielle, présentent le capitaine comme un héros panafricaniste luttant contre une prétendue conspiration mondiale. « Il est le leader rêvé, capable de défier les puissances internationales, » analyse Fahiraman Rodrigue Koné, expert du Sahel.
Exemple de propagande : Vidéos virales montrant Traoré en héros militaire, souvent accompagnées de slogans comme « Le Burkina aux Burkinabè » ou d’images truquées dénonçant des complots étrangers.
Cette stratégie de communication, bien que puissante, ne masque pas les critiques. La popularité réelle du régime reste difficile à évaluer dans un contexte où la liberté d’expression est étouffée.
Un échec sécuritaire persistant
L’un des échecs les plus criants de la junte réside dans sa gestion de la crise sécuritaire. En 2022, Ibrahim Traoré promettait un retour rapide de la stabilité face aux attaques jihadistes. Pourtant, trois ans plus tard, la situation reste alarmante. Si le régime revendique avoir repris 72 % du territoire, ces chiffres sont contestés par les experts, qui estiment que de vastes zones échappent encore au contrôle de l’État.
Les jihadistes continuent d’attaquer les convois et de maintenir des blocus dans le nord, tandis que l’armée est régulièrement accusée d’exactions contre les civils. « Traoré voyait ses hommes tomber au front, mais il n’a pas mesuré la complexité politique de la crise, » explique Fahiraman Rodrigue Koné. Cette rhétorique martiale, bien qu’efficace pour galvaniser ses soutiens, ne résout pas les problèmes structurels.
« À l’intérieur, ce sont les terroristes qui terrorisent. Dans les grandes villes, c’est le pouvoir qui terrorise les populations. »
Un habitant anonyme
Ce paradoxe résume le sentiment de beaucoup : un pays pris entre deux feux, où la menace jihadiste et la répression étatique se conjuguent pour maintenir la population dans l’angoisse.
Vers un avenir incertain
Le Burkina Faso de 2025 est un pays transformé, mais à quel prix ? La junte, sous la bannière du souverainisme et du panafricanisme, a imposé un contrôle strict sur la société, muselant les voix critiques et façonnant une jeunesse à son image. Pourtant, les défis restent immenses : l’insécurité persiste, l’économie vacille, et la liberté d’expression est un lointain souvenir.
- Surveillance accrue : Les comités de vigilance et les brigades laabal maintiennent un contrôle social strict.
- Propagande efficace : Les réseaux sociaux glorifient Traoré, masquant les critiques sous un flot de désinformation.
- Insécurité persistante : Les jihadistes contrôlent toujours des zones entières, défiant les promesses du régime.
Dans ce contexte, les Burkinabè naviguent entre résignation et espoir prudent. La vision d’un Burkina Faso souverain, débarrassé des influences étrangères, séduit certains, mais le coût humain et social de cette transformation reste lourd. L’avenir dira si le régime de Traoré parviendra à concilier ses ambitions idéologiques avec les besoins d’une population en quête de stabilité et de liberté.