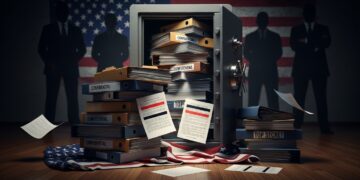Le 30 janvier 1972, une date gravée dans la mémoire collective de l’Irlande du Nord. Ce jour-là, une manifestation pacifique dans les rues de Londonderry, ou Derry pour les républicains, tourne au cauchemar. Des parachutistes britanniques ouvrent le feu sur des civils désarmés, faisant 13 morts et plongeant la région dans une tragédie qui résonne encore aujourd’hui. Retour sur cet événement, connu sous le nom de Bloody Sunday, un tournant dans les trois décennies de violences des Troubles.
Un Dimanche Sanglant à Londonderry
Ce dimanche-là, des milliers de personnes, majoritairement catholiques, défilent dans le quartier du Bogside à Londonderry. Leur objectif ? Dénoncer les injustices subies par leur communauté, notamment l’internement sans procès, une mesure imposée par Londres en août 1971. Ce régime, perçu comme arbitraire, cristallise les tensions entre républicains, aspirant à une réunification avec l’Irlande, et unionistes protestants, fidèles à la Couronne britannique.
La manifestation, organisée par des associations de défense des droits civiques, est interdite par le gouvernement provincial. Pourtant, la foule brave l’interdiction, brandissant des pancartes et scandant des slogans. À sa tête, une figure emblématique : Bernadette Devlin, jeune députée catholique, incarne la résistance face à un système qualifié par beaucoup d’apartheid protestant.
Une Manifestation Qui Dégénère
Vers 16h30, l’ambiance change. Alors que le cortège touche à sa fin, des jeunes quittent la marche pour s’approcher d’un poste militaire au croisement de Bishop Street et Rossville Street. Les parachutistes britanniques, envoyés en renfort depuis Belfast, sont sur les nerfs. Bernadette Devlin, perchée sur une chaise, tente désespérément de calmer la foule :
“Stop, stop, go home !”
Bernadette Devlin, criant à la foule pour éviter l’escalade.
Mais ses appels restent vains. Les soldats reçoivent l’ordre d’investir le Bogside, un bastion catholique où ni police ni armée n’osent s’aventurer depuis des années. La situation devient incontrôlable.
Un Chaos Mortel dans le Bogside
Dans le dédale des ruelles étroites et mal éclairées du Bogside, le drame éclate. Les parachutistes ouvrent le feu. Des cris déchirent l’air, mêlés au brouillard des gaz lacrymogènes. Treize civils, dont six adolescents de 17 ans, tombent sous les balles, la plupart touchés dans le dos. Un quatorzième mourra plus tard des suites de ses blessures. Seize autres sont blessés, certains grièvement.
Pour les habitants, c’est un massacre collectif. Denis Bradley, prêtre catholique et témoin, accuse les soldats d’avoir tiré “aveuglément, presque avec plaisir”. Ivan Cooper, député nord-irlandais, raconte avoir été visé alors qu’il agitait un mouchoir blanc pour porter secours à un blessé.
Chiffres clés du drame :
- 13 morts immédiats, dont 6 adolescents
- 1 décès ultérieur lié aux blessures
- 16 blessés, plusieurs dans un état grave
- Une manifestation pacifique interdite
Les Versions Contradictoires
L’armée britannique soutient que les parachutistes ont répondu à des tirs de manifestants armés, pointant du doigt les “terroristes” de l’IRA (Armée républicaine irlandaise). Cette version, relayée dans une enquête officielle de 1972, est largement contestée. L’IRA, de son côté, nie toute provocation et promet des représailles, ce qui alimente un cycle de violences.
Pour les habitants du Bogside, les soldats ont “perdu la tête”, tirant sans distinction sur une foule désarmée. Bernadette Devlin, dans une déclaration cinglante, qualifie l’événement de “massacre collectif orchestré par l’armée britannique”.
“Ce fut un massacre collectif commis par l’armée britannique.”
Bernadette Devlin, dénonçant l’action des parachutistes.
Une Enquête Tardive et des Excuses
En 1972, une première enquête, menée à la hâte, entérine la version de l’armée, provoquant l’indignation des familles des victimes. Ce n’est qu’en 2010, après douze ans d’investigations, qu’un nouveau rapport, le rapport Saville, rétablit la vérité. Les conclusions sont sans appel : les parachutistes ont tiré les premiers, les victimes n’étaient ni armées ni membres de l’IRA.
Le Premier ministre britannique de l’époque, David Cameron, présente des excuses publiques, qualifiant l’action de l’armée d’injustifiable. Ces mots, bien que tardifs, marquent un tournant dans la reconnaissance officielle des responsabilités.
| Année | Événement |
|---|---|
| 1972 | Enquête initiale soutient la version de l’armée |
| 2010 | Rapport Saville innocentant les victimes |
| 2010 | Excuses officielles de David Cameron |
Un Tournant dans les Troubles
Le Bloody Sunday n’est pas un simple événement isolé. Il marque un point de rupture dans les Troubles, ces trois décennies de violences qui ont opposé républicains et unionistes en Irlande du Nord. Ce drame radicalise une partie de la population catholique, qui voit dans l’IRA une réponse légitime à l’oppression. Les adhésions à l’organisation clandestine explosent, et le cycle de violences s’intensifie.
Pour les unionistes, l’événement renforce la méfiance envers les républicains, perçus comme une menace à l’unité avec la Couronne. Londonderry, déjà divisée, se replie sur elle-même. La ville devient le symbole d’une fracture profonde, où chaque communauté vit dans la peur de l’autre.
Les Répercussions à Long Terme
Plus de cinquante ans après, le Bloody Sunday reste une plaie ouverte. En 2025, un ancien soldat britannique est jugé à Belfast pour deux meurtres et cinq tentatives de meurtre liés à ce jour tragique. Ce procès, bien que tardif, ravive les mémoires et les débats sur la justice et la réconciliation.
Le drame a également transformé la lutte pour les droits civiques en Irlande du Nord. Il a mis en lumière les discriminations subies par la communauté catholique, poussant le gouvernement britannique à réformer certaines politiques. Cependant, la paix, scellée par l’accord du Vendredi saint en 1998, reste fragile.
Impacts durables du Bloody Sunday :
- Radicalisation des républicains et essor de l’IRA
- Renforcement des tensions intercommunautaires
- Pression pour des réformes des droits civiques
- Procès en 2025, symbole d’une justice tardive
Une Mémoire Toujours Vive
Chaque année, des commémorations ont lieu à Londonderry pour honorer les victimes. Les murs du Bogside, ornés de fresques murales, racontent encore cette journée funeste. Ces peintures, connues sous le nom de murals, sont un rappel constant de la lutte et du sacrifice.
Pour les familles des victimes, le rapport Saville et les excuses de 2010 ont apporté un certain apaisement, mais la douleur persiste. Le procès en cours en 2025 montre que la quête de justice reste inachevée. Comme le souligne un habitant du Bogside : “On n’oublie pas, mais on essaie de construire un avenir meilleur.”
“Ce n’est pas seulement une tragédie, c’est un cri pour la justice qui résonne encore.”
Un résident anonyme de Londonderry, 2025.
Le Bloody Sunday est plus qu’un événement historique. C’est un symbole de résistance, de douleur et d’espoir. Il rappelle que la paix, si durement acquise, demande une vigilance constante pour éviter que l’histoire ne se répète.