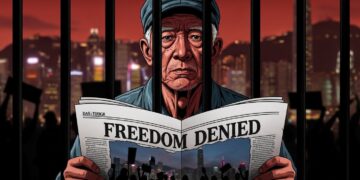Chaque année, des flammes dévorent l’Amazonie brésilienne, laissant derrière elles des cicatrices noires sur la plus grande forêt tropicale du monde. En 2024, une sécheresse sans précédent a aggravé la situation, réduisant en cendres près de 18 millions d’hectares. Mais qui allume ces feux dévastateurs ? À Sao Félix do Xingu, au cœur de l’État du Pará, les réponses se trouvent dans les pratiques agricoles, les défis climatiques et une culture profondément enracinée.
Jean Rouge : l’ami et l’ennemi de l’Amazonie
Dans le jargon local, on l’appelle Jean Rouge. Ce n’est pas une personne, mais le feu lui-même, un outil ancestral utilisé par les éleveurs pour entretenir leurs pâturages. Simple, économique, il suffit d’une allumette et d’un peu d’essence pendant la saison sèche pour nettoyer les terres. Mais ce geste, ancré dans les traditions agricoles, a des conséquences dramatiques, surtout lorsque les flammes échappent à tout contrôle.
À Sao Félix do Xingu, une municipalité aussi vaste que le Portugal mais peuplée de seulement 65 000 habitants, l’élevage bovin domine. Avec 2,5 millions de vaches, c’est le plus grand cheptel du Brésil. Cependant, cette activité économique est aussi la principale source d’émissions de CO2 du pays, en grande partie à cause de la déforestation.
Une pratique agricole à double tranchant
Pour les éleveurs, le feu est une solution économique. « La main-d’œuvre coûte cher, les pesticides aussi », explique un propriétaire terrien de 62 ans, qui gère 900 têtes de bétail. Contrairement aux grandes entreprises, les petits éleveurs n’ont souvent pas accès à des financements publics. Le feu devient alors une alternative abordable pour éliminer les herbes sèches et renouveler les pâturages, rendant le sol plus fertile pour les troupeaux.
« Quand quelqu’un va allumer un feu, il dit : Je vais embaucher Jean Rouge ! »
Propriétaire terrien à Sao Félix do Xingu
Mais cette méthode a un coût environnemental énorme. En 2024, les incendies ont détruit plus de forêt tropicale que de pâturages, une première dans l’histoire de l’Amazonie. Les flammes, souvent allumées sur des terres agricoles, se propagent rapidement à travers une végétation asséchée par la sécheresse, amplifiée par le changement climatique.
Le « Jour du feu » et ses répercussions
En 2019, un événement a marqué les esprits : le Jour du feu. Des propriétaires terriens, soutenant les politiques climatosceptiques de l’époque, ont intentionnellement déclenché des incendies massifs pour défricher des terres. Cet épisode a provoqué une indignation mondiale et mis en lumière les tensions entre développement agricole et préservation de l’environnement. Sao Félix do Xingu, avec ses 7 000 incendies recensés en 2024, reste un épicentre de cette crise.
Les grandes propriétés, souvent détenues par des entreprises basées dans des métropoles comme São Paulo, jouent un rôle clé. Par exemple, un ranch de 12 000 têtes de bétail, situé près de la rivière Xingu, a vu plus des deux tiers de ses terres brûler l’an dernier. Ces incendies ont non seulement dévasté les pâturages, mais aussi affecté des communautés autochtones voisines, enveloppées de fumées toxiques.
Chiffres clés sur les incendies en Amazonie :
- 18 millions d’hectares brûlés en 2024.
- Augmentation de 4 % de la déforestation en un an.
- 7 000 incendies recensés à Sao Félix do Xingu en 2024.
Les défis d’une culture à changer
Face à cette crise, la ministre brésilienne de l’Environnement, Marina Silva, souligne que le principal défi est de mettre fin à la déforestation par le feu. Cela nécessite non seulement des moyens matériels – plus de pompiers, des sanctions plus strictes – mais aussi un changement profond des mentalités. Les éleveurs, petits et grands, doivent adopter des pratiques plus durables, comme l’utilisation de pare-feu ou le retrait de la végétation sèche avant d’allumer un feu.
Pourtant, l’impunité reste un obstacle majeur. Dans l’État du Pará, où les incendies pour l’entretien des pâturages sont interdits, les contrevenants échappent souvent aux sanctions. Grâce à des réseaux comme WhatsApp, les éleveurs s’alertent dès l’arrivée des autorités, rendant les contrôles difficiles.
« Tout le monde a un téléphone. Quand une voiture de l’Ibama apparaît, les gens se préviennent. »
Petit éleveur à Casa de Tabua
Petits éleveurs contre géants agro-industriels
À Sao Félix, les petits éleveurs se sentent souvent injustement ciblés par rapport aux grandes entreprises. « Ils nous traitent comme des criminels, mais personne ne nous aide », déplore un éleveur de Casa de Tabua. Pendant ce temps, des géants comme Agro SB, qui exploite un immense complexe agro-industriel, continuent leurs activités malgré des amendes environnementales impayées.
Les tensions foncières aggravent la situation. De nombreux petits éleveurs revendiquent des terres par usucapion, une pratique courante en Amazonie, tandis que les grandes entreprises les accusent d’être des « envahisseurs ». Ces conflits, mêlés à l’utilisation du feu, contribuent à la dégradation de l’environnement.
Vers des solutions durables ?
En 2025, l’Amazonie bénéficie d’une accalmie. Les incendies sont à leur plus bas niveau depuis 1998, grâce à des précipitations plus régulières et à un meilleur contrôle des autorités. Depuis le retour au pouvoir de Luiz Inacio Lula da Silva, l’Ibama a intensifié ses opérations, mobilisant 4 300 pompiers et utilisant l’intelligence artificielle pour repérer les contrevenants. Mais ces efforts restent insuffisants face à l’immensité de la forêt.
Pour les experts, la solution passe par une meilleure régularisation des terres. « Les gens qui ont des titres de propriété prennent soin de leurs terres », explique le maire de Sao Félix. Des initiatives locales, comme la sensibilisation aux bonnes pratiques agricoles, commencent à émerger, mais le chemin est encore long.
| Problème | Solution proposée |
|---|---|
| Incendies incontrôlés | Renforcer les brigades de pompiers |
| Impunité | Sanctions plus strictes et suivi des amendes |
| Pratiques agricoles | Sensibilisation aux pare-feu et bonnes pratiques |
L’Amazonie, la « banlieue » oubliée du Brésil
Pour le journaliste Joao Moreira Salles, auteur du livre Arrabalde, l’Amazonie souffre d’un manque de reconnaissance nationale. « Le Brésil tourne le dos à l’Amazonie. C’est sa banlieue », affirme-t-il. La COP30, qui se tiendra en novembre 2025 à Belém, pourrait être une opportunité pour changer cette perception, mais seulement si les Brésiliens eux-mêmes s’approprient la cause.
En attendant, les habitants de Sao Félix do Xingu continuent de naviguer entre tradition et modernité, entre survie économique et préservation de l’environnement. La lutte contre les incendies en Amazonie est loin d’être gagnée, mais elle repose sur un équilibre fragile : celui entre développement et respect de la nature.