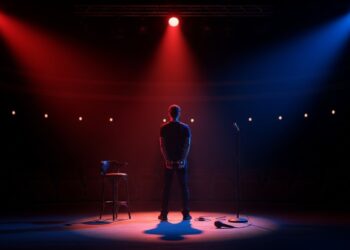Imaginez un bateau de pêche ballotté par les vagues, son bois craquant sous le poids des ans, tandis que les filets reviennent presque vides. C’est l’image qui pourrait résumer aujourd’hui la réalité de la **pêche française**, une activité historique qui, malgré sa place de géant en Europe, semble à bout de souffle. Entre une flotte qui vieillit, des ressources qui s’épuisent et des chocs extérieurs imprévisibles, les marins-pêcheurs affrontent une tempête sans fin.
Un colosse européen aux pieds d’argile
La France occupe une position enviable dans le paysage européen de la pêche. Avec **473 000 tonnes** de poissons et crustacés capturés en 2023, elle se hisse au deuxième rang des producteurs, juste derrière l’Espagne. Pourtant, ce chiffre cache une baisse préoccupante de 9 % par rapport à l’année précédente, brisant une dynamique positive observée sur deux ans.
Leader incontesté dans la production d’huîtres et solide deuxième pour les moules, le pays brille aussi en aquaculture, où il se classe troisième en Europe. Mais ces succès ne suffisent pas à masquer une vérité amère : les produits de la mer pèsent lourd dans le déficit commercial, avec **5,6 milliards d’euros** en 2022. Pourquoi ? Les Français, friands de poisson avec une consommation annuelle de **31,8 kg par habitant**, délaissent souvent le merlu ou la sole au profit du saumon et des crevettes, deux stars importées qui dominent plus d’un tiers des achats.
Une flotte qui prend l’eau
La flotte française, autrefois imposante, a fondu comme neige au soleil. En vingt ans, elle a perdu plus d’un quart de ses effectifs pour tomber à moins de **6 000 navires** en 2023. Avec une moyenne d’âge de trente ans, ces bateaux racontent une histoire de résistance, mais aussi d’usure. La grande majorité – plus de 80 % – mesure moins de douze mètres, adaptée à une pêche côtière, tandis que seulement 200 unités osent s’aventurer au grand large.
Le chalutage reste roi, fournissant la moitié des volumes capturés, des fonds marins avec le cabillaud ou la lotte jusqu’aux eaux pélagiques où nagent les anchois. Mais d’autres techniques coexistent : filets pour la sole, dragues pour les coquilles Saint-Jacques, casiers pour les crustacés ou encore palangres pour le thon. Une diversité qui ne compense pas un renouvellement au compte-gouttes : entre **60 et 70 nouveaux navires** par an, souvent conçus pour réduire l’empreinte énergétique.
- Petits bateaux côtiers : plus de 80 % de la flotte.
- Chalutage : 50 % des poissons pêchés.
- Renouvellement : 60 à 70 navires par an, hybrides ou biosourcés.
Les marins, une espèce en voie de disparition ?
Derrière ces navires, il y a des hommes et des femmes. En 2022, ils étaient **12 300 marins-pêcheurs**, soit 13 % de moins qu’il y a dix ans. Près de la moitié d’entre eux pourraient raccrocher leurs cirés dans la prochaine décennie, laissant planer le spectre d’une pénurie. Leur salaire, oscillant entre **2 500 et 3 000 euros net par mois**, dépend des caprices de la mer et des saisons, un équilibre fragile pour une profession exigeante.
« On vit au rythme des marées, mais aussi des incertitudes. »
– D’après une source proche des pêcheurs
Le métier attire peu. Les conditions rudes, les horaires imprévisibles et les perspectives incertaines découragent les nouvelles générations. Pourtant, ces marins sont le cœur battant d’une industrie qui tente de se réinventer.
Surpêche : le défi de la durabilité
La mer n’est pas un puits sans fond. En 2022, **56 % des poissons débarqués** provenaient de stocks exploités de manière durable, un progrès timide par rapport aux 54 % de 2021. Il y a vingt ans, ce chiffre n’atteignait que 18 %. Mais le chemin reste long : **20 % des captures** viennent encore de populations surexploitées, et 2 % de stocks au bord de l’effondrement, comme le merlu méditerranéen ou le lieu jaune.
L’objectif ? Atteindre **100 % de durabilité**, comme le prévoit la politique européenne. Un rêve ambitieux face à des pratiques héritées et une pression constante sur les écosystèmes marins. Les efforts se multiplient, mais les résultats tardent à convaincre.
| Année | Pêche durable | Surpêche |
| 2000 | 18 % | Non précisé |
| 2022 | 56 % | 20 % |
Des crises qui frappent fort
Le Brexit a porté un coup dur. Près de **90 bateaux** ont été envoyés à la casse, leurs équipages indemnisés après avoir perdu l’accès aux eaux britanniques. Aujourd’hui, les tensions persistent autour des quotas et des filets autorisés pour le millier de licences finalement obtenues. Londres a aussi fermé treize zones marines au chalutage en 2024, suscitant l’indignation à Paris.
Sur la façade atlantique, la fermeture temporaire du golfe de Gascogne, instaurée pour protéger les dauphins, a mis des centaines de pêcheurs à l’arrêt cet hiver. Indemnités ou pas, le moral est en berne. À cela s’ajoute la crise du thon dans l’océan Indien, où les coûts du carburant et la raréfaction des poissons fragilisent une filière déjà critiquée pour son impact environnemental.
Un avenir entre espoirs et incertitudes
Face à ces défis, des solutions émergent. Le gouvernement mise sur l’éolien offshore pour financer la transition : **700 millions d’euros** issus des taxes pourraient moderniser les ports et décarboner la flotte. Propulsion hybride, matériaux durables, réduction des émissions : les chantiers navals, qu’ils soient français, belges ou marocains, s’activent pour construire les bateaux de demain.
Mais ces promesses suffiront-elles ? Entre les exigences écologiques, les aléas économiques et la concurrence internationale, la pêche française joue sa survie. Les marins, eux, continuent de scruter l’horizon, espérant des jours meilleurs.
Un secteur en mutation, entre tradition et innovation.
La pêche française est à un tournant. Sa capacité à se réinventer tout en préservant ses racines déterminera si elle restera un pilier européen ou si elle sombrera dans l’oubli. Une chose est sûre : l’histoire de nos mers mérite d’être racontée, et ses acteurs, d’être écoutés.