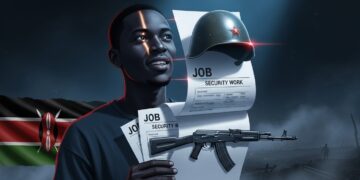Imaginez un petit pays d’à peine deux millions d’habitants, coincé entre le Sénégal et la Guinée Conakry, où les coups d’État reviennent aussi régulièrement que la saison des pluies. Mercredi dernier, ce scénario désormais familier s’est à nouveau produit en Guinée-Bissau. Des militaires ont annoncé avoir renversé le président Umaro Sissoco Embalo et suspendu les élections dont les résultats étaient attendus d’un jour à l’autre. Deux jours plus tard, l’Union africaine frappait fort : suspension immédiate du pays de toutes ses instances.
Une réaction rapide et sans appel de l’Union africaine
Dès le vendredi suivant le putsch, le président de la Commission de l’UA, Mahamoud Ali Youssouf, a confirmé la décision. La Guinée-Bissau est suspendue « avec effet immédiat » de toutes les structures de l’organisation panafricaine. Cette mesure, devenue presque automatique sur le continent ces dernières années, vise à marquer le refus catégorique des changements de pouvoir par la force.
La rapidité de la réaction montre que l’UA ne tolère plus la moindre entorse à l’ordre constitutionnel. En quelques heures seulement, le sort du pays était scellé au sein de l’organisation qui regroupe 54 États africains.
La CEDEAO emboîte le pas avec la même fermeté
Dans la foulée, la Communauté économique des États de l’Afrique de l’Ouest a pris une décision identique. Le pays est exclu de « tous les organes décisionnels » de l’organisation régionale. Pour la Guinée-Bissau, cela signifie perdre sa voix dans les instances qui gèrent commerce, sécurité et coopération ouest-africaine.
Le secrétaire général de l’ONU, Antonio Guterres, a lui aussi dénoncé publiquement cette « violation des principes démocratiques ». Un concert de condamnations qui isole immédiatement la junte naissante.
Qui sont les nouveaux maîtres de Bissau ?
À la tête de la transition, les militaires ont nommé le général Horta N’Tam, ancien chef d’état-major de l’armée de terre. Il devient président par intérim pour une durée annoncée d’un an. Un schéma classique : un officier supérieur prend les rênes avec la promesse de rendre le pouvoir aux civils… plus tard.
Quant à l’ex-président Umaro Sissoco Embalo, il a d’abord été arrêté avant de réussir à quitter le territoire jeudi pour trouver refuge au Sénégal voisin. Un exil qui rappelle celui de nombreux chefs d’État déchus avant lui.
« Je suis en sécurité et je me cache dans le pays »
Fernando Dias, candidat de l’opposition qui revendique la victoire à la présidentielle
Le candidat d’opposition Fernando Dias, qui affirme avoir remporté le scrutin du 23 novembre, reste lui sur place mais dans la clandestinité. Les résultats officiels n’ont jamais été proclamés, laissant planer un épais brouillard sur la légitimité du vote.
Un pays habitué aux soubresauts militaires
Depuis son indépendance du Portugal en 1974, la Guinée-Bissau a connu quatre coups d’État réussis et une multitude de tentatives. Aucun président élu n’a jamais terminé son mandat complet sans interruption majeure. Ce dernier putsch s’inscrit donc dans une longue tradition d’instabilité.
Les proclamations de résultats électoraux ont souvent servi de détonateur. Contestations, accusations de fraude, manifestations : le cocktail explosif est bien rodé à Bissau.
Chronologie express des coups d’État en Guinée-Bissau depuis l’indépendance :
- 1980 : Coup du commandant Nino Vieira
- 1999 : Guerre civile et renversement de Vieira
- 2009 : Assassinat du président Vieira
- 2012 : Coup d’État quelques semaines avant la présidentielle
- 2025 : Renversement d’Umaro Sissoco Embalo
Un État fragile miné par la pauvreté et le narcotrafic
Avec un PIB par habitant parmi les plus bas du continent, la Guinée-Bissau reste un pays extrêmement pauvre. La corruption gangrène l’appareil d’État et les institutions peinent à fonctionner normalement.
Surnommée parfois « narco-État », la Guinée-Bissau est devenue ces vingt dernières années une plaque tournante majeure du trafic de cocaïne entre l’Amérique latine et l’Europe. Des généraux, des politiciens et parfois des membres de la présidence ont été accusés de protéger ou de participer à ce commerce lucratif.
Cette réalité pèse lourdement sur la stabilité. L’argent de la drogue corrompt, divise et finance parfois directement les factions prêtes à prendre le pouvoir par les armes.
L’Afrique face à la vague persistante des juntes
La Guinée-Bissau rejoint une liste déjà longue de pays suspendus par l’UA après des coups de force : Mali, Burkina Faso, Niger, Soudan, et plus récemment Madagascar. Seule éclaircie récente, le Gabon a vu ses sanctions levées en avril dernier après le renversement d’Ali Bongo.
Cette multiplication des putschs interroge profondément la capacité des organisations régionales à prévenir plutôt qu’à sanctionner. Les suspensions pleuvent, mais les militaires continuent de frapper.
Dans le même temps, certaines juntes parviennent à se maintenir plusieurs années et à obtenir une forme de reconnaissance de fait, notamment quand elles surfent sur un sentiment anti-occidental ou promettent de lutter plus efficacement contre le terrorisme.
Quelles perspectives pour les douze prochains mois ?
Le général Horta N’Tam a annoncé une transition d’un an. Reste à savoir si ce calendrier sera tenu. L’histoire récente du continent montre que les délais promis sont rarement respectés. Mali, Burkina Faso ou Guinée Conakry ont tous prolongé leurs transitions bien au-delà des engagements initiaux.
La pression internationale sera forte. L’isolement diplomatique et les sanctions économiques pourraient peser lourd sur un pays déjà exsangue. Mais l’expérience montre aussi que les juntes savent parfois jouer la montre et consolider leur pouvoir.
Enfin, la question de la sécurité régionale n’est pas neutre. Un vide du pouvoir prolongé en Guinée-Bissau pourrait favoriser l’expansion de groupes armés ou renforcer les réseaux de narcotrafic, avec des répercussions directes sur le Sénégal et la sous-région.
Une chose est sûre : les prochains mois seront décisifs pour l’avenir de ce petit pays lusophone d’Afrique de l’Ouest. Entre sanctions internationales, promesses de transition et réalités du terrain, le chemin s’annonce semé d’embûches. Et l’histoire, malheureusement, a déjà prouvé qu’elle avait la fâcheuse tendance à se répéter à Bissau.