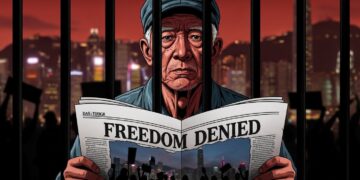Le 14 novembre 2025, vers 18 h 30, profitant d’un moment d’inattention lors du regroupement, il s’éclipse. Ni menotté, ni particulièrement surveillé de près, il fond dans la foule ou prend une ruelle adjacente. En quelques minutes, le voilà libre. Les accompagnateurs ne peuvent que constater l’absence et alerter immédiatement les forces de l’ordre.
Un profil à haut risque autorisé à sortir
La question brûle toutes les lèvres : comment un détenu aux antécédents aussi lourds a-t-il pu obtenir l’autorisation de participer à une activité extérieure ? Les sorties culturelles ou éducatives sont censées concerner des profils en fin de peine, bien intégrés et présentant un risque faible. Manifestement, ce n’était pas le cas ici.
Des sources internes évoquent une décision validée au niveau de la direction de l’établissement, peut-être dans une logique de « réinsertion par la culture ». Le résultat est cinglant : treize jours de cavale, des moyens policiers importants mobilisés, et une nouvelle tache sur le bilan déjà fragile de l’administration pénitentiaire.
« Il avait déjà fugué plusieurs fois. Tout le monde savait qu’il saisirait la première occasion. »
Source proche du dossier
Treize jours de traque intensive
Dès le soir même, Emile Siegler est inscrit au fichier des personnes recherchés. Les enquêteurs savent qu’il appartient à la communauté des gens du voyage et qu’il dispose probablement d’un solide réseau de soutien. Les recherches se concentrent rapidement sur les secteurs où il est susceptible de trouver refuge.
Le 27 novembre, treize jours exactement après l’évasion, les gendarmes le localisent dans le camp de la Clarière, prairie de Mauves, près de Nantes. À leur arrivée, il tente encore de fuir, mais les moyens déployés sont cette fois à la hauteur : important dispositif, maîtrise rapide, menottes. Un second homme, visé par un mandat de recherche, est interpellé en même temps.
Fin de la cavale. Retour à la case prison, avec, cette fois, très probablement un durcissement drastique de son régime de détention.
Un directeur qui paie l’addition
L’évasion a eu des conséquences immédiates en haut lieu. Quelques jours après les faits, le directeur du centre pénitentiaire de Vezin-le-Coquet a accepté la « proposition de mutation » qui lui a été faite : il rejoint la direction interrégionale de l’administration pénitentiaire. En langage clair : il a été démis de ses fonctions.
Le ministre de l’Intérieur lui-même a publiquement annoncé cette sanction, preuve que l’affaire a pris une dimension politique. Il est rare qu’un directeur d’établissement soit ainsi sacrifié aussi rapidement, mais l’accumulation d’évasions spectaculaires ces dernières années rend l’exemplarité obligatoire.
Un symptôme plus large du système carcéral français
Cette évasion n’est malheureusement pas un cas isolé. Les statistiques officielles font état de plusieurs dizaines de fuites chaque année, certaines lors de permissions de sortir, d’autres lors d’extractions médicales ou, comme ici, pendant des activités culturelles.
Plusieurs facteurs se combinent :
- Surcharge chronique des prisons (plus de 76 000 détenus pour 61 000 places en 2025)
- Manque de personnel (un surveillant pour 100 à 120 détenus en moyenne)
- Difficultés à évaluer correctement le risque de fuite chez certains profils
- Pression politique pour développer les activités de réinsertion, même pour des détenus à risque
Le résultat ? Des décisions parfois prises dans l’urgence ou sous la contrainte de « bons chiffres » en matière de réinsertion, au détriment de la sécurité.
La réinsertion oui, mais à quel prix ?
Personne ne conteste l’intérêt des sorties éducatives ou culturelles pour les détenus en voie de réinsertion. Des études montrent qu’elles réduisent significativement le risque de récidive lorsqu’elles sont proposées aux bons profils. Mais encore faut-il que le tri soit rigoureux.
Dans le cas d’Emile Siegler, le passif était pourtant limpide : multiples évasions, condamnations pour vols avec violence, appartenance à un réseau susceptible de l’aider en cavale. Autoriser une sortie sans menottes ni surveillance renforcée relève, pour beaucoup d’agents pénitentiaires, de l’inconscience.
Un surveillant expérimenté confiait récemment : « On nous sommes pris entre deux feux : d’un côté on nous demande d’humaniser la détention, de l’autre on nous reproche chaque évasion. Mais quand on alerte sur un profil dangereux, on nous répond que « tout le monde a droit à une chance »… jusqu’à ce que ça explose. »
Vers un durcissement des sorties ?
Cette affaire pourrait marquer un tournant. Déjà, plusieurs syndicats pénitentiaires demandent la suspension immédiate des sorties non indispensables pour les détenus présentant un risque élevé d’évasion. D’autres proposent un bracelet électronique systématique ou un encadrement policier lors de ces déplacements.
Le gouvernement, lui, marche sur des œufs : trop durcir et il sera accusé de revenir sur les avancées en matière de droits des détenus ; trop laxiste et il s’expose à de nouvelles polémiques à chaque fugue.
Une chose est sûre : l’image du planétarium de Rennes, lieu habituellement synonyme de rêve et d’évasion… dans le bon sens du terme, en prend un sérieux coup. Difficile d’imaginer que les prochains groupes de détenus y soient accueillis de sitôt.
En résumé : un détenu multirécidiviste s’évade lors d’une sortie culturelle pourtant censée favoriser sa réinsertion, reste treize jours en cavale grâce à son réseau, finit rattrapé, et provoque le départ du directeur de prison. Une affaire qui illustre parfaitement les contradictions et les failles du système pénitentiaire français actuel.
Une histoire qui, hélas, ne surprend plus grand monde… mais qui continue de choquer par son absurdité.
Et vous, pensez-vous que les sorties culturelles pour détenus à risque devraient être purement et simplement supprimées ? Ou existe-t-il des solutions intermédiaires ? Le débat est ouvert.
Imaginez la scène : un vendredi soir de novembre, six détenus sortent exceptionnellement de prison pour assister à une séance au planétarium de Rennes dans le cadre de la Fête de la Science. Encadrés par trois surveillants, ils admirent les étoiles… jusqu’à ce que l’un d’eux disparaisse purement et simplement dans la nuit rennaise. L’histoire pourrait prêter à sourire si elle n’était pas, une fois encore, le symptôme d’un système pénitentiaire à bout de souffle.
Une évasion presque prévisible
Le fugitif, Emile Siegler, surnommé « Gino », n’était pas un détenu lambda. À 37 ans, il affichait déjà un impressionnant palmarès : au moins trois évasions réussies depuis 2009, dont une très récente en 2024. Incarcéré au centre pénitentiaire de Vezin-le-Coquet pour vols aggravés, il bénéficiait pourtant d’un régime de confiance suffisant pour participer à cette sortie « hors les murs ».
Le 14 novembre 2025, vers 18 h 30, profitant d’un moment d’inattention lors du regroupement, il s’éclipse. Ni menotté, ni particulièrement surveillé de près, il fond dans la foule ou prend une ruelle adjacente. En quelques minutes, le voilà libre. Les accompagnateurs ne peuvent que constater l’absence et alerter immédiatement les forces de l’ordre.
Un profil à haut risque autorisé à sortir
La question brûle toutes les lèvres : comment un détenu aux antécédents aussi lourds a-t-il pu obtenir l’autorisation de participer à une activité extérieure ? Les sorties culturelles ou éducatives sont censées concerner des profils en fin de peine, bien intégrés et présentant un risque faible. Manifestement, ce n’était pas le cas ici.
Des sources internes évoquent une décision validée au niveau de la direction de l’établissement, peut-être dans une logique de « réinsertion par la culture ». Le résultat est cinglant : treize jours de cavale, des moyens policiers importants mobilisés, et une nouvelle tache sur le bilan déjà fragile de l’administration pénitentiaire.
« Il avait déjà fugué plusieurs fois. Tout le monde savait qu’il saisirait la première occasion. »
Source proche du dossier
Treize jours de traque intensive
Dès le soir même, Emile Siegler est inscrit au fichier des personnes recherchés. Les enquêteurs savent qu’il appartient à la communauté des gens du voyage et qu’il dispose probablement d’un solide réseau de soutien. Les recherches se concentrent rapidement sur les secteurs où il est susceptible de trouver refuge.
Le 27 novembre, treize jours exactement après l’évasion, les gendarmes le localisent dans le camp de la Clarière, prairie de Mauves, près de Nantes. À leur arrivée, il tente encore de fuir, mais les moyens déployés sont cette fois à la hauteur : important dispositif, maîtrise rapide, menottes. Un second homme, visé par un mandat de recherche, est interpellé en même temps.
Fin de la cavale. Retour à la case prison, avec, cette fois, très probablement un durcissement drastique de son régime de détention.
Un directeur qui paie l’addition
L’évasion a eu des conséquences immédiates en haut lieu. Quelques jours après les faits, le directeur du centre pénitentiaire de Vezin-le-Coquet a accepté la « proposition de mutation » qui lui a été faite : il rejoint la direction interrégionale de l’administration pénitentiaire. En langage clair : il a été démis de ses fonctions.
Le ministre de l’Intérieur lui-même a publiquement annoncé cette sanction, preuve que l’affaire a pris une dimension politique. Il est rare qu’un directeur d’établissement soit ainsi sacrifié aussi rapidement, mais l’accumulation d’évasions spectaculaires ces dernières années rend l’exemplarité obligatoire.
Un symptôme plus large du système carcéral français
Cette évasion n’est malheureusement pas un cas isolé. Les statistiques officielles font état de plusieurs dizaines de fuites chaque année, certaines lors de permissions de sortir, d’autres lors d’extractions médicales ou, comme ici, pendant des activités culturelles.
Plusieurs facteurs se combinent :
- Surcharge chronique des prisons (plus de 76 000 détenus pour 61 000 places en 2025)
- Manque de personnel (un surveillant pour 100 à 120 détenus en moyenne)
- Difficultés à évaluer correctement le risque de fuite chez certains profils
- Pression politique pour développer les activités de réinsertion, même pour des détenus à risque
Le résultat ? Des décisions parfois prises dans l’urgence ou sous la contrainte de « bons chiffres » en matière de réinsertion, au détriment de la sécurité.
La réinsertion oui, mais à quel prix ?
Personne ne conteste l’intérêt des sorties éducatives ou culturelles pour les détenus en voie de réinsertion. Des études montrent qu’elles réduisent significativement le risque de récidive lorsqu’elles sont proposées aux bons profils. Mais encore faut-il que le tri soit rigoureux.
Dans le cas d’Emile Siegler, le passif était pourtant limpide : multiples évasions, condamnations pour vols avec violence, appartenance à un réseau susceptible de l’aider en cavale. Autoriser une sortie sans menottes ni surveillance renforcée relève, pour beaucoup d’agents pénitentiaires, de l’inconscience.
Un surveillant expérimenté confiait récemment : « On nous sommes pris entre deux feux : d’un côté on nous demande d’humaniser la détention, de l’autre on nous reproche chaque évasion. Mais quand on alerte sur un profil dangereux, on nous répond que « tout le monde a droit à une chance »… jusqu’à ce que ça explose. »
Vers un durcissement des sorties ?
Cette affaire pourrait marquer un tournant. Déjà, plusieurs syndicats pénitentiaires demandent la suspension immédiate des sorties non indispensables pour les détenus présentant un risque élevé d’évasion. D’autres proposent un bracelet électronique systématique ou un encadrement policier lors de ces déplacements.
Le gouvernement, lui, marche sur des œufs : trop durcir et il sera accusé de revenir sur les avancées en matière de droits des détenus ; trop laxiste et il s’expose à de nouvelles polémiques à chaque fugue.
Une chose est sûre : l’image du planétarium de Rennes, lieu habituellement synonyme de rêve et d’évasion… dans le bon sens du terme, en prend un sérieux coup. Difficile d’imaginer que les prochains groupes de détenus y soient accueillis de sitôt.
En résumé : un détenu multirécidiviste s’évade lors d’une sortie culturelle pourtant censée favoriser sa réinsertion, reste treize jours en cavale grâce à son réseau, finit rattrapé, et provoque le départ du directeur de prison. Une affaire qui illustre parfaitement les contradictions et les failles du système pénitentiaire français actuel.
Une histoire qui, hélas, ne surprend plus grand monde… mais qui continue de choquer par son absurdité.
Et vous, pensez-vous que les sorties culturelles pour détenus à risque devraient être purement et simplement supprimées ? Ou existe-t-il des solutions intermédiaires ? Le débat est ouvert.