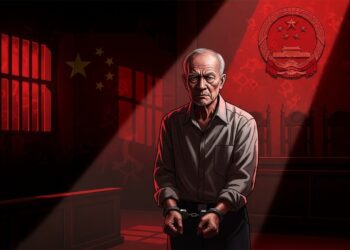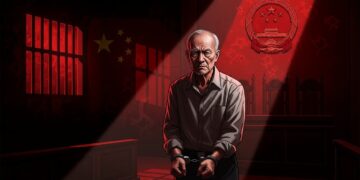Il est six heures du matin. Dans une petite maison de Cuers, dans le Var, une retraitée de soixante-dix ans, malade, est tirée du sommeil par des coups violents frappés à sa porte. Quand elle ouvre, une dizaine de gendarmes se tient sur le seuil. Motif ? Un commentaire publié quelques jours plus tôt sur Facebook au sujet du meurtre de Thomas à Crépol.
Une phrase qui vaut une descente de police
Le 19 novembre 2023, Thomas Perotto, seize ans, est mortellement poignardé lors d’un bal de village à Crépol, dans la Drôme. L’émotion est immense dans tout le pays. Comme des milliers de Français, cette septuagénaire réagit sur les réseaux sociaux. Sur son profil public, elle relaie les noms des mis en cause – alors largement diffusés – et écrit qu’ils agissent comme des « soldats de l’islam.
Ces quelques mots vont déclencher une tempête judiciaire.
« À mon âge, malade, je représentais visiblement un danger public pour que l’on vienne me chercher à six heures du matin », confie-t-elle encore choquée près de deux ans après les faits.
Un réveil brutal et une garde à vue traumatisante
Perquisition, saisie de l’ordinateur, placement en garde à vue : le traitement réservé à cette grand-mère est celui habituellement appliqué aux trafiquants de drogue ou aux terroristes. Elle passe plus de vingt-quatre heures privée de liberté pour un post Facebook. Elle qui n’avait jamais eu affaire à la justice de sa vie.
Le parquet lui reproche une « provocation à la haine ou à la violence à l’égard d’une personne ou d’un groupe de personnes à raison de leur origine ou de leur appartenance ou non-appartenance à une ethnie, une nation, une race ou une religion déterminée ».
En première instance, le tribunal correctionnel la condamne à 1 000 euros d’amende et à verser 1 euro symbolique de dommages et intérêts à chacune des parties civiles – les jeunes mis en examen dans l’affaire Thomas.
L’appel : un revirement complet de la justice
Le 20 novembre 2025, la cour d’appel de Paris rend une tout autre décision : relaxe totale.
Les magistrats estiment que les propos, bien que « outranciers », ne constituaient pas une exhortation directe à la haine ou à la violence. Ils relèvent qu’il n’y avait ni appel au meurtre, ni injonction à s’en prendre à quiconque. La cour rappelle que la provocation à la haine exige une intention claire d’inciter autrui à agir.
Maître Maxime Barnier, son avocat, avait plaidé avec force cette distinction fondamentale : « Dire que quelqu’un agit comme un soldat de l’islam n’équivaut pas à appeler à le tuer. Le droit de choquer, de déranger, d’être excessif fait partie de la liberté d’expression dans une démocratie. »
Un débat de société bien plus large
Cette affaire dépasse largement le cas personnel de cette retraitée varoise. Elle cristallise plusieurs fractures françaises :
- La gestion émotionnelle des réseaux sociaux après un drame
- La frontière, toujours plus floue, entre critique de l’islamisme et islamophobie
- Le sentiment d’une justice à deux vitesses selon le contenu des propos
- L’utilisation disproportionnée de certaines procédures pour des délits d’opinion
Beaucoup se souviennent que, dans d’autres affaires, des appels au meurtre explicites contre des « Français de souche » ou des « blancs » ont parfois été classés sans suite ou très légèrement sanctionnés. Le contraste est saisissant.
La leçon tirée par la principale intéressée
Aujourd’hui libérée de cette procédure qui aura duré près de deux ans, la septuagénaire refuse la victimisation. Au contraire, elle veut transmettre un message clair :
« Il ne faut pas avoir peur de dire ce que l’on pense. Si on commence à se taire par peur des représailles judiciaires, alors c’est la porte ouverte à tous les totalitarismes. »
Elle dit avoir reçu des centaines de messages de soutien, y compris de personnes issues de l’immigration qui partagent son effroi face à la montée de la violence et de l’islamisme radical.
Vers une évolution de la jurisprudence ?
Cette relaxe pourrait faire jurisprudence. Plusieurs avocats spécialisés en droit de la presse estiment que la cour d’appel de Paris a réaffirmé des principes fondamentaux posés par la Cour européenne des droits de l’homme : le droit au débat passionné sur des sujets d’intérêt général, même avec des termes excessifs.
Dans un contexte où les plaintes pour « provocation à la haine » se multiplient – souvent déposées de manière automatique par certaines associations – cet arrêt rappelle que la liberté d’expression n’est pas un privilège réservé aux discours modérés.
Comme l’écrivait déjà Voltaire (même si la phrase lui est parfois attribuée à tort) : « Je ne suis pas d’accord avec ce que vous dites, mais je me battrai jusqu’à la mort pour que vous ayez le droit de le dire. »
Une retraitée de soixante-dix ans, dans le Var, vient de le prouver à ses dépens… et finalement à son honneur.
Un simple commentaire Facebook peut-il valoir une perquisition à l’aube ?La justice française vient de répondre : non, tant qu’il n’appelle pas directement à la violence.
Cette affaire laisse un goût amer : celui d’une société où l’émotion collective peut parfois primer sur le droit, où la peur de « l’amalgame » conduit à traquer des mots plus que des actes.
Mais elle laisse aussi une lueur d’espoir : celle que, même après des années de dérives, la justice peut encore, parfois, sait encore dire non à l’arbitraire.
Pour Thomas, pour la liberté d’expression, et pour tous ceux qui refusent de baisser les yeux.