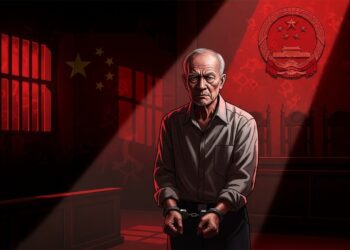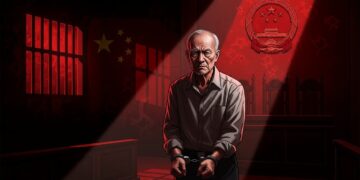Imaginez-vous à moins de trente kilomètres des lignes russes, dans une ville bombardée presque chaque nuit. Les sirènes hurlent, les vitres tremblent, et pourtant, un homme ferme les yeux et pince les cordes d’une bandoura. Chaque note est un acte de défi. Chaque livre qu’il édite est une balle tirée sans bruit contre l’oubli. À Kharkiv, Oleksandr Savtchouk mène une guerre que l’on n’apprend pas à l’école militaire : la guerre de la mémoire.
Une résistance qui a commencé bien avant 2022
Longtemps avant que les chars russes ne franchissent la frontière, Oleksandr Savtchouk avait déjà choisi son camp. En 2010, ce professeur de philosophie alors âgé de 31 ans décide de quitter l’enseignement pour devenir éditeur. Son objectif ? Ressusciter des textes ukrainiens interdits, brûlés ou simplement oubliés sous l’ère soviétique.
Sans équipe, sans gros moyens, il monte une micro-maison d’édition qu’il gère seul. En quinze ans, deux cents titres voient le jour, soit 60 000 exemplaires au total. Des chiffres modestes face aux géants, mais immenses quand on sait que chaque livre représente un fragment d’identité sauvé de l’effacement.
La bandoura, cette voix que Staline voulait éteindre
Dans l’arrière-boutique de sa librairie, Oleksandr pose ses doigts sur l’instrument traditionnel ukrainien. La bandoura, cousine du luth, était l’âme des kobzars, ces bardes itinérants souvent aveugles qui, du XVIIe siècle aux années 1930, portaient la mémoire collective du peuple.
Le régime soviétique les haïssait. Leur cécité, disait la légende, les rapprochait de Dieu. Leur répertoire, lui, parlait trop de liberté. Dans les années 1930, des centaines de kobzars furent convoqués à un prétendu congrès… et exécutés. Oleksandr a publié Retour d’une tradition, un livre qui fait revivre ces voix assassinées.
« C’est une goutte d’eau dans la mer, mais les réactions nous laissent croire que nous fournissons des réponses aux gens sur leur identité nationale. »
Oleksandr Savtchouk
Book Shelter : quand la librairie devient abri antiaérien
Mars 2023. En pleine guerre, Oleksandr ouvre une librairie à Kharkiv. Il la baptise Book Shelter – jeu de mots entre « shelter » (abri) et les abris antiaériens où les habitants courent chaque soir. Les murs sont épais, les rayons remplis d’ouvrages en ukrainien, la lumière tamisée. On y vient lire, écouter de la musique, ou simplement respirer un air qui ne sent pas la peur.
Un samedi matin, quelques clients écoutent Oleksandr chanter un poème de Hryhorii Skovoroda accompagné à la bandoura. Le même Skovoroda dont le musée, à quarante kilomètres de là, a été délibérément détruit par un missile russe le 6 mai 2022. L’attaque a été perçue comme un message : nous pouvons rayer votre histoire de la carte.
La réponse ? Continuer à chanter.
Une jeunesse qui redécouvre ses racines… ou pas encore
Varvara a quatorze ans. Elle aide bénévolement à la librairie. Depuis un an, elle dévore la littérature ukrainienne et rejette de plus en plus la culture russe dans laquelle elle a grandi. Elle écoute désormais moins de chansons en russe, lit des poètes interdits, pose des questions.
Mais elle le reconnaît : dans sa classe, elle reste minoritaire. Beaucoup de ses camarades continuent d’écouter la même musique qu’avant, parlent russe entre eux, trouvent cela « normal ». À Kharkiv, la langue et la culture russes restent omniprésentes – simple réalité géographique et historique. Le chemin vers une identité pleinement assumée est encore long.
Des églises en bois ressuscitées en 3D
Stefan Taranouchenko était historien de l’art. En 1933, il photographiait et relevait les plans d’églises en bois que le pouvoir soviétique s’apprêtait à détruire. Il fut arrêté pour cela. En 2020, Oleksandr a réussi – non sans résistances locales – à faire poser une plaque commémorative sur le lieu de son arrestation.
Aujourd’hui, il a publié un livre où ces églises « revivent » grâce à des QR codes : on pointe son téléphone et l’église apparaît en trois dimensions, intacte, majestueuse. Un acte de résurrection numérique contre la destruction physique.
Ce jour-là, devant des journalistes, Oleksandr dépose des fleurs sur la plaque. Un passant le reconnaît, s’approche… et lui serre longuement la main.
« Votre travail est aussi important que celui de l’armée ukrainienne. »
Slava Mavrychev, journaliste de 38 ans
Oleksandr sourit, un peu gêné : « Ouf, j’ai cru qu’il venait pour me frapper. »
Une continuité historique de quatre siècles
Pour Oleksandr, rien de nouveau sous le soleil. Il voit dans l’invasion actuelle la simple continuation d’une politique commencée dès le XVIIe siècle : une grande puissance militaire qui écrase son voisin plus petit et s’approprie sa culture, « un peu comme les Romains avec la Grèce ».
Ses deux grands-pères ont subi la répression soviétique. L’histoire familiale se mêle à l’histoire nationale. Publier ces textes oubliés, jouer de la bandoura sous les bombes, ouvrir une librairie-abri : tout cela n’est pas un hobby de temps de guerre. C’est une vocation ancienne qui a enfin trouvé son heure.
Kharkiv n’est pas seule : l’élan culturel dans tout le pays
Partout en Ukraine, les initiatives se multiplient. À Kiev, Lviv, Odessa ou Dnipro, les festivals littéraires ont fleuri cette année. Les maisons d’édition comme Rodovid ou Duh i litera publient sans relâche des ouvrages sur le patrimoine national. À Kharkiv même, l’écrivain star Serhiy Jadan a organisé une grande foire littéraire en août dernier.
La guerre a agi comme un accélérateur brutal de conscience. Ce qui était parfois considéré comme ringard ou secondaire – apprendre l’ukrainien, lire les classiques nationaux, écouter de la musique traditionnelle – devient soudain vital.
Parce que quand les missiles tombent, on comprend que la culture n’est pas un luxe. C’est le dernier rempart.
En résumé, la résistance culturelle ukrainienne aujourd’hui, c’est :
- • Des éditeurs solitaires qui ressuscitent des textes interdits depuis un siècle
- • Des librairies qui servent aussi d’abris antiaériens
- • Des adolescents qui, un par un, abandonnent la culture russe de leur enfance
- • Des églises détruites qui renaissent en réalité augmentée
- • Des bardes exécutés dans les années 1930 dont les chants résonnent encore sous les bombes
À Kharkiv, Oleksandr Savtchouk ne porte pas d’uniforme. Il n’a pas d’arme. Il a une bandoura, des livres, et une conviction chevillée au corps : tant qu’un Ukrainien lira ces pages et entendra ces notes, l’histoire ne sera pas finie.
Et quelque part entre deux alertes aériennes, dans la pénombre chaleureuse du Book Shelter, on comprend que certaines victoires ne se mesurent pas en kilomètres repris, mais en consciences réveillées.
La guerre des armes continue. La guerre des mémoires aussi. Et dans cette seconde guerre-là, chaque livre ouvert est un drapeau planté.