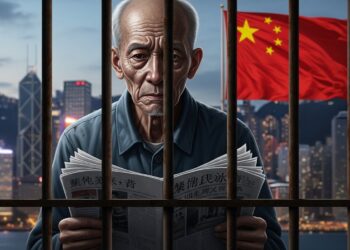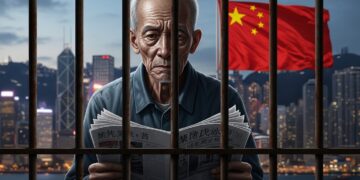Perché dans les hauteurs du Haut Atlas marocain, un son aigu et mélodieux résonne à travers les vallées. Ce n’est pas le chant d’un oiseau, mais un langage unique, transmis de génération en génération : le langage sifflé. Utilisé par les bergers pour communiquer sur des kilomètres, ce trésor culturel est aujourd’hui menacé par des bouleversements sociaux et environnementaux. Comment ce patrimoine peut-il survivre face à l’exode rural et au changement climatique ? Plongeons dans l’histoire fascinante de cette pratique millénaire.
Un Langage Qui Traverse les Montagnes
Dans les villages isolés du Haut Atlas, comme Imzerri, les bergers n’ont pas besoin de téléphones pour se parler. Leur outil ? Un sifflement précis, capable de porter des messages sur 2,5 à 3 kilomètres à travers les reliefs escarpés. Ce langage, appelé assinsg en amazigh, transforme les mots berbères en sons sifflés, une technique qui demande des années de pratique pour être maîtrisée.
Ce mode de communication, bien plus qu’un simple outil, est un véritable art. Les bergers, comme Hammou et son fils Brahim, l’ont appris dès l’enfance, au même titre que marcher ou parler. « C’est notre téléphone à nous », explique Hammou avec une pointe d’humour, soulignant l’efficacité de ce système dans un environnement où les technologies modernes peinent à s’implanter.
Une Tradition Ancrée dans le Pastoralisme
Le langage sifflé est intimement lié au mode de vie pastoral des communautés du Haut Atlas. En gardant leurs troupeaux de chèvres ou de moutons, les bergers utilisent ces sifflements pour coordonner leurs mouvements, signaler un danger ou simplement échanger des nouvelles. Cette pratique, qui repose sur la propagation du son dans les vallées montagneuses, est particulièrement adaptée à la géographie de la région.
« Le principe est simple : les mots sont dits en sifflant, et la clé, c’est la pratique », explique Brahim, 33 ans, berger et fervent défenseur de cet héritage.
Pourtant, ce savoir-faire ne se limite pas au Maroc. Des formes similaires de langages sifflés existent dans d’autres parties du monde, comme les îles Canaries, le Mexique ou la Papouasie-Nouvelle-Guinée. Selon Julien Meyer, linguiste français spécialisé, plus de 90 langues à travers le globe possèdent une version sifflée, chacune adaptée à son environnement et à ses besoins.
Un Patrimoine Menacé par l’Exode Rural
Dans des hameaux comme Imzerri, où l’accès se fait après une marche d’une heure et demie à travers des sentiers sinueux, la vie est rude. Sans eau courante ni électricité, les conditions difficiles poussent de nombreuses familles à quitter la région pour des zones urbaines. Ce phénomène d’exode rural menace directement le langage sifflé, qui dépend du mode de vie pastoral.
« Notre région est magnifique, mais nous vivons reclus », confie Aïcha, une habitante de 51 ans qui a appris à siffler dans son enfance. Avec le départ des familles, le savoir-faire risque de s’éteindre, car il n’est plus transmis aussi systématiquement aux jeunes générations. Dans la province d’Azilal, où se trouve Imzerri, le taux de pauvreté atteint 17 %, soit le double de la moyenne nationale, accentuant cette migration.
Les chiffres clés :
- Distance de propagation des sifflements : 2,5 à 3 km.
- Taux de pauvreté à Azilal : 17 % (2024).
- Nombre de langues sifflées recensées dans le monde : environ 90.
Le Changement Climatique, une Nouvelle Menace
À l’exode rural s’ajoute un autre défi de taille : le changement climatique. Depuis sept ans, une sécheresse persistante frappe le Haut Atlas, obligeant les bergers à modifier leurs pratiques ancestrales. Hammou et Brahim, par exemple, ont dû parcourir 350 kilomètres vers le sud-est entre novembre 2024 et mai 2025 pour trouver des pâturages pour leurs 250 chèvres. Ce déplacement, une première dans leur vie, illustre les bouleversements causés par la raréfaction des ressources.
« Le déplacement était pénible, mais on n’avait pas le choix. Nos animaux n’avaient plus de quoi manger », raconte Hammou, le regard marqué par l’inquiétude.
Ce nomadisme forcé perturbe l’équilibre du pastoralisme et de la transhumance, deux piliers qui soutiennent le langage sifflé. En s’éloignant de leurs vallées, les bergers ont moins d’occasions de pratiquer cet art, ce qui accélère son déclin. « Le changement climatique a bouleversé une vie organisée autour du pastoralisme », note une chercheuse marocaine qui étudie ce patrimoine depuis 2020.
Transmettre pour Survivre
Face à ces défis, certains s’efforcent de préserver ce trésor culturel. Brahim, par exemple, a enseigné le langage sifflé à son fils Mohamed, âgé de 12 ans. « Au début, c’était dur, mais maintenant, je comprends mieux », confie le jeune garçon, qui rêve de devenir pilote d’avion. Cette transmission intergénérationnelle est cruciale, mais elle reste fragile dans un contexte où les jeunes sont de moins en moins nombreux à rester dans les villages.
Brahim, qui préside une association locale dédiée à la sauvegarde de ce patrimoine, est déterminé à agir. « Mon objectif est que cet héritage survive », affirme-t-il. Des initiatives comme la sienne, combinées à des recherches scientifiques, pourraient permettre de documenter et de promouvoir ce savoir-faire unique.
Vers une Reconnaissance Internationale
Depuis 2020, une étude est en cours pour présenter un dossier à l’Unesco afin de faire reconnaître le langage sifflé comme patrimoine culturel immatériel. Cette démarche, portée par des chercheurs comme Fatima-Zahra Salih, vise à sensibiliser à l’urgence de protéger cette pratique. Une reconnaissance internationale pourrait encourager des actions concrètes, comme des programmes éducatifs ou des initiatives de développement local pour freiner l’exode rural.
Pourtant, le temps presse. Avec la sécheresse qui menace à nouveau en 2025, Hammou et Brahim espèrent que les pluies de septembre leur permettront de rester dans leur vallée. « Est-ce qu’ils vont résister à ces changements ? », s’interroge la chercheuse, soulignant l’urgence de valoriser ce savoir-faire avant qu’il ne disparaisse.
| Facteurs de menace | Impact sur le langage sifflé |
|---|---|
| Exode rural | Réduction du nombre de pratiquants |
| Changement climatique | Perturbation du pastoralisme |
| Manque d’infrastructures | Isolement des communautés |
Un Héritage à Valoriser
Le langage sifflé du Haut Atlas est bien plus qu’une curiosité linguistique. Il incarne une relation profonde entre l’homme, son environnement et sa culture. Sa survie dépendra de la capacité des communautés à s’adapter aux défis modernes tout en préservant leurs traditions. En soutenant les initiatives locales et en sensibilisant à l’échelle mondiale, il est encore possible de sauver cet héritage unique.
Alors que les vallées du Haut Atlas résonnent encore des sifflements des bergers, une question demeure : combien de temps ce chant millénaire continuera-t-il à vibrer ? L’avenir du langage sifflé repose entre les mains de ceux qui, comme Brahim et Mohamed, refusent de le laisser s’éteindre.