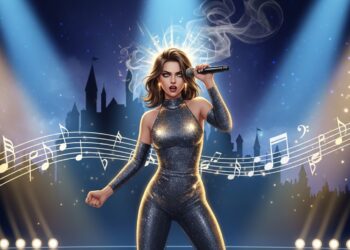Imaginez vivre dans un monde où chaque mot prononcé peut vous coûter la vie, où même vos proches pourraient vous dénoncer. C’est la réalité qu’ont connue deux femmes françaises, revenues de Syrie après avoir rejoint l’État Islamique (EI) en 2014. Leur témoignage, livré devant une cour d’assises à Paris, dévoile une atmosphère oppressante, marquée par la méfiance, la peur et le silence au sein de l’organisation jihadiste et d’un clan familial influent. Ce récit captivant nous plonge dans les rouages d’un univers où la paranoïa dictait chaque instant.
Un quotidien sous haute tension
En 2014, deux Françaises, converties et radicalisées, quittent leur pays pour rejoindre le prétendu califat de l’EI en Syrie. Leur décision, motivée par des convictions religieuses extrêmes, les conduit au cœur d’un système où la suspicion règne. L’une est la nièce de figures influentes de la propagande jihadiste, l’autre est liée à un combattant de l’organisation. Ensemble, elles intègrent un clan familial où les secrets et la peur dominent.
Leur quotidien, loin des idéaux utopiques qu’elles avaient peut-être imaginés, est marqué par un contrôle strict et une surveillance constante. Les deux femmes décrivent un environnement où personne n’ose parler librement, même au sein de la famille. La moindre critique ou le moindre doute pouvait entraîner des conséquences dramatiques : emprisonnement, torture, voire exécution.
La peur au sein du clan familial
Dans ce clan, la méfiance n’épargne personne, pas même les proches. Les deux accusées racontent comment un membre de la famille, suspecté de vouloir prendre du pouvoir, a été emprisonné sur ordre d’un des leaders du groupe. Cet épisode, relaté par l’une des femmes, illustre le climat de délation qui gangrénait les relations. « On ne parlait pas, on ne posait pas de questions », confie-t-elle, soulignant l’omerta imposée par le groupe.
« Il y avait une atmosphère de secret. On avait peur que nos paroles soient répétées, qu’on soit dénoncé. »
Ce fonctionnement sectaire, où toute voix dissidente était réduite au silence, s’étendait bien au-delà de la famille. L’EI imposait une discipline de fer, où la loyauté aveugle était la seule option. Les femmes décrivent un climat où même les enfants étaient exposés à une propagande brutale, sans jamais pouvoir remettre en question ce qu’ils voyaient.
Un endoctrinement total
L’une des accusées, âgée d’une quarantaine d’années, raconte avoir été bouleversée par les attentats du 13 novembre 2015 en France. Lorsqu’elle partage son trouble avec son mari, celui-ci lui ordonne de se taire, menaçant de graves représailles si elle continuait à réfléchir ou à questionner les actions de l’EI. Cette injonction brutale – « Arrête de penser si tu ne veux pas que ta tête se retrouve au bout d’une pique » – révèle l’ampleur de l’endoctrinement imposé aux membres.
Les deux femmes admettent n’avoir jamais vraiment questionné les exactions commises par l’organisation lorsqu’elles étaient en Syrie. « On était tous pro-Daesh, on ne remettait rien en cause », explique l’une d’elles. Même face à des scènes choquantes, comme l’arrestation et la punition d’un voisin pour avoir fumé une cigarette, elles restaient dans le déni, convaincues que leur mission était de « tuer des mécréants ».
Dans cet univers, la peur était omniprésente. Chaque mot, chaque geste pouvait être interprété comme une trahison. Les membres de l’EI vivaient dans un état de vigilance permanente, où la moindre déviation pouvait coûter cher.
Une organisation cloisonnée
Le fonctionnement de l’EI reposait sur une structure rigide, où l’information était strictement compartimentée. Les maris des deux accusées, tous deux impliqués dans l’organisation, ne partageaient presque rien de leurs activités. L’un d’eux, décrit comme particulièrement paranoïaque, évitait tout échange avec sa femme, rendant leur relation distante et froide. Cette opacité renforçait le sentiment d’isolement des femmes, qui vivaient dans l’ignorance des agissements de leurs proches.
Les armes présentes dans leur foyer ? Elles étaient là parce que l’un des maris avait suivi une formation de combattant, explique l’une des accusées. Mais au-delà de ces détails, elles affirment ne rien savoir des exactions commises par l’EI. Ce cloisonnement, combiné à la peur de la délation, empêchait toute discussion ouverte, même au sein des foyers.
Les prémices du doute
Ce n’est qu’en 2017, lorsque l’EI commence à perdre du terrain face aux forces kurdes et à la coalition internationale, que les premières fissures apparaissent dans leur foi en l’organisation. Les bombardements s’intensifient à Raqqa, forçant le clan à fuir. C’est à ce moment que les deux femmes commencent à remettre en question leur engagement.
Un événement marque un tournant décisif : l’arrestation et la torture d’un proche, accusé de dissidence par l’EI. « Là, j’ai compris qu’on nous avait menti, que ce n’était pas un État islamique, mais un lieu de tortures et de monstruosités », confie l’une d’elles. Ce témoignage poignant révèle la désillusion progressive qui s’installe face à la réalité brutale de l’organisation.
« Ce n’était pas ce qu’on nous avait promis. À l’intérieur, c’était la peur, la torture, la mort. »
Le retour et la remise en question
En 2017, les deux femmes décident de quitter l’EI et de rentrer en France. Ce retour, loin d’être un simple voyage, marque le début d’une longue remise en question. L’une d’elles, revenue en 2019 et placée en liberté conditionnelle deux ans plus tard, affirme avoir pris ses distances avec l’endoctrinement qui l’avait poussée à rejoindre l’organisation. Ce processus de déradicalisation, bien que complexe, leur permet aujourd’hui de témoigner avec une certaine distance sur leur passé.
Leur récit, livré devant la cour, met en lumière les mécanismes psychologiques et sociaux qui maintiennent les individus dans des environnements extrémistes. La peur, le silence et la soumission étaient les piliers de leur vie en Syrie, mais c’est aussi cette pression qui, paradoxalement, les a poussées à s’interroger et à partir.
Un témoignage révélateur
Ce procès, qui se tient depuis septembre 2025 à Paris, offre une plongée rare dans l’envers du décor de l’EI. Les récits des deux femmes, bien que marqués par une certaine prudence, permettent de comprendre comment une organisation comme l’EI parvient à maintenir un contrôle total sur ses membres. La paranoïa, la délation et l’endoctrinement sont au cœur de son fonctionnement, transformant même les liens familiaux en relations de méfiance.
Leur témoignage soulève également des questions plus larges sur la radicalisation, le rôle des femmes dans les organisations jihadistes et les défis de la déradicalisation. Comment des individus, initialement animés par des convictions religieuses, peuvent-ils se retrouver piégés dans un système aussi oppressant ? Et comment parviennent-ils à s’en extraire ?
| Clé de l’EI | Impact sur les membres |
|---|---|
| Paranoïa | Suspicion constante, peur de la délation |
| Endoctrinement | Acceptation aveugle des exactions |
| Cloisonnement | Ignorance des activités des proches |
Ce tableau résume les mécanismes qui ont façonné la vie des deux accusées en Syrie. Leur témoignage, bien que centré sur leur expérience personnelle, éclaire les dynamiques plus larges de l’EI, où la peur et le contrôle étaient omniprésents.
Les leçons d’un passé douloureux
Le récit de ces deux femmes, bien qu’il puisse susciter des débats sur leur degré de responsabilité, offre une perspective unique sur la réalité de l’EI. Leur expérience met en lumière les dangers de la radicalisation et les mécanismes psychologiques qui enferment les individus dans des idéologies extrêmes. Leur retour en France et leur volonté de témoigner montrent également qu’un chemin de rédemption, bien que difficile, est possible.
Ce procès, au-delà de son aspect judiciaire, pose des questions essentielles sur la manière dont les sociétés peuvent prévenir la radicalisation et accompagner les personnes qui cherchent à se reconstruire après avoir été séduites par des idéologies destructrices. Les récits des accusées, empreints de regret et de prise de conscience, rappellent que derrière chaque parcours radicalisé se cache une histoire humaine complexe.
En conclusion, le témoignage de ces deux femmes revenues de Syrie offre un regard brut et sans filtre sur la vie au sein de l’EI. Leur récit, entre peur, silence et désillusion, invite à réfléchir sur les mécanismes de l’extrémisme et sur la nécessité de comprendre, sans juger hâtivement, les parcours de ceux qui ont été entraînés dans cette spirale. Alors que leur procès se poursuit, une question demeure : comment tirer les leçons de ces expériences pour empêcher que d’autres ne tombent dans le même piège ?