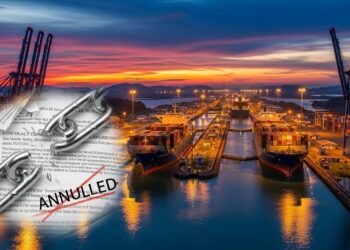Comment une ancienne éducatrice spécialisée, une jeune femme mariée à 16 ans et une étudiante basque se retrouvent-elles devant une cour d’assises à Paris, accusées de liens avec l’un des groupes terroristes les plus redoutés au monde ? Leur histoire, qui s’entrelace avec celle de l’État Islamique et des attentats meurtriers du 13 novembre 2015, est au cœur d’un procès qui débute à Paris. Ce procès, qui se tiendra jusqu’au 26 septembre, met en lumière des parcours complexes, marqués par des choix radicaux et des vies bouleversées par l’idéologie salafo-jihadiste.
Un Procès sous Haute Tension
À partir de ce lundi, trois femmes se présenteront devant la cour d’assises spéciale de Paris, une juridiction réservée aux affaires de terrorisme, sans jurés populaires. Elles sont accusées d’association de malfaiteurs terroriste, un chef d’accusation grave qui pourrait les conduire à une peine maximale de 30 ans de réclusion criminelle. Leur parcours, qui les a menées de la France à la Syrie, soulève des questions sur les mécanismes de radicalisation et les rôles joués par les femmes dans les organisations jihadistes.
Qui Sont les Accusées ?
Les trois femmes au cœur de ce procès ont des profils distincts, mais leurs trajectoires convergent vers un engagement dans l’idéologie salafo-jihadiste. La première, âgée de 34 ans, est la nièce de deux figures emblématiques de la propagande de l’État Islamique. Ses oncles, présumés morts en Syrie, ont marqué les esprits en revendiquant les attentats du 13 novembre 2015, qui ont coûté la vie à 130 personnes à Paris et Saint-Denis. Leur voix, sur fond de chants religieux, a amplifié la terreur de ces attaques.
La deuxième accusée, une femme de 67 ans, est une ancienne éducatrice spécialisée. Connue pour une vie sans histoire, elle s’est convertie à l’islam sous l’influence de son fils aîné, qu’elle considérait comme son « sauveur ». Ce dernier l’a entraînée dans une spirale de radicalisation, l’amenant à rejoindre l’État Islamique à Raqqa. Enfin, la troisième femme, originaire du Pays basque, a suivi un chemin similaire après avoir rencontré son compagnon à l’université, un homme lié aux mêmes réseaux jihadistes.
Portrait des accusées :
- 34 ans, nièce de figures de l’EI, mariée religieusement à 16 ans.
- 67 ans, ancienne éducatrice, radicalisée par son fils aîné.
- Femme basque, radicalisée via son compagnon rencontré à l’université.
Un Parcours vers la Syrie
Leur départ pour la Syrie, entre 2004 et 2014, n’était pas un coup de tête. Selon les magistrats, il s’inscrivait dans un engagement de longue date dans l’idéologie salafo-jihadiste. Pour la nièce, tout commence à l’adolescence. À 16 ans, elle épouse religieusement un homme choisi par son oncle, un futur membre de l’EI. Cette union marque le début de son immersion dans un environnement radicalisé. En 2014, elle rejoint ses oncles à Raqqa, alors capitale autoproclamée du « califat ».
L’ancienne éducatrice, quant à elle, suit son fils, qui l’a initiée au Coran. Ce dernier, figure centrale de sa radicalisation, l’entraîne en Syrie avec sa compagne, la troisième accusée. Leur installation à Raqqa s’accompagne d’avantages matériels fournis par l’EI : logements, salaires, et une vie encadrée par les règles strictes du groupe. Ce soutien logistique montre à quel point leur engagement était intégré à l’organisation.
« C’est en toute connaissance de cause qu’elles ont choisi de rejoindre l’EI en Syrie, bénéficiant de salaires et de logements fournis par l’organisation. »
Juges d’instruction
Le Rôle des Femmes dans l’EI
Contrairement à une idée répandue, les femmes dans l’État Islamique ne se limitaient pas à des rôles passifs. Si certaines, comme les accusées, n’ont pas directement participé à des combats, elles ont contribué à la pérennité de l’organisation. En rejoignant Raqqa, elles ont soutenu l’idéologie du groupe, élevé leurs enfants dans cet environnement et parfois participé à des tâches logistiques. Leur présence, avec leurs familles, renforçait l’image du « califat » comme un projet viable.
Les magistrates soulignent que leur engagement était « durable » et conscient. Les accusées ont vécu à Raqqa pendant plusieurs années, même après les premières défaites de l’EI. Leur itinérance le long de l’Euphrate, après la chute de la ville en 2017, montre leur détermination à rester fidèles au groupe, malgré les offensives kurdes qui réduisaient les territoires contrôlés.
| Événement | Date | Détails |
|---|---|---|
| Départ pour la Syrie | 2004-2014 | Les accusées rejoignent Raqqa, capitale de l’EI. |
| Chute de Raqqa | 2017 | Les accusées fuient avec l’EI le long de l’Euphrate. |
| Arrestation | 2019 | Expulsion de Turquie et inculpation en France. |
Les Enfants, Victimes Collatérales
Un aspect particulièrement troublant de cette affaire concerne les enfants. Deux des accusées sont poursuivies pour avoir emmené leurs enfants, âgés de 3 à 13 ans, dans une zone de guerre. En les exposant à la violence et à l’idéologie de l’EI, elles les ont placés dans une situation de danger physique et psychologique. Les juges ont relevé des risques de « graves traumatismes » pour ces jeunes, qui ont grandi dans un environnement marqué par la guerre et l’extrémisme.
Ce choix soulève des questions éthiques et judiciaires. Comment juger des mères qui, par conviction, ont mis en péril la sécurité de leurs enfants ? Ce point sera probablement au cœur des débats lors du procès, alors que les accusées devront répondre de leurs responsabilités parentales.
Les Attentats du 13-Novembre en Arrière-Plan
Ce procès ne peut être dissocié du contexte des attentats du 13 novembre 2015. La revendication de ces attaques, portée par les oncles de l’une des accusées, a laissé une empreinte indélébile en France. Leur rôle dans la propagande de l’EI, en diffusant un message destiné à terroriser et à recruter, a amplifié l’impact de ces événements tragiques. La cour d’assises, en 2022, avait condamné ces figures à la perpétuité incompressible en leur absence.
Le lien familial entre l’une des accusées et ces propagandistes place ce procès sous un éclairage particulier. Il rappelle la complexité des réseaux jihadistes, où les liens personnels et idéologiques s’entremêlent. La cour devra déterminer dans quelle mesure les accusées partageaient les objectifs de l’EI et jusqu’où allait leur implication.
« Leur rôle était essentiel pour diffuser et amplifier la terreur et attirer de nouveaux combattants. »
Cour d’assises, 2022
Un Procès aux Enjeux Multiples
Ce procès, qui se tient jusqu’au 26 septembre, dépasse le cadre des trois accusées. Il interroge la société sur la manière de juger ceux qui ont rejoint des groupes terroristes, en particulier les femmes, souvent perçues comme des victimes plutôt que des actrices conscientes. Les débats exploreront les dynamiques de radicalisation, les responsabilités familiales et les conséquences des choix idéologiques.
Les accusées, arrêtées en Turquie en 2019 après deux ans d’errance, encourent des peines lourdes. Leur expulsion vers la France, accompagnées de neuf enfants, a marqué la fin d’un chapitre de leur vie en Syrie. Mais pour la justice française, c’est le début d’un processus visant à établir leur culpabilité et à comprendre leur rôle dans l’EI.
Enjeux du procès :
- Établir le degré d’implication des accusées dans l’EI.
- Juger leur responsabilité dans l’exposition de leurs enfants à la guerre.
- Comprendre les mécanismes de radicalisation et de fidélité à l’EI.
Quel Avenir pour les Accusées ?
Le verdict, attendu d’ici fin septembre, pourrait avoir des répercussions importantes. Une condamnation sévère enverrait un message clair sur la responsabilité individuelle dans les actes de terrorisme, même pour ceux qui n’ont pas directement porté les armes. Cependant, les parcours personnels des accusées – marqués par des influences familiales, des conversions tardives ou des mariages arrangés – pourraient nuancer les jugements.
Ce procès est aussi une occasion de réfléchir à la réintégration des enfants, dont l’avenir reste incertain. Ayant grandi dans un contexte de guerre et d’extrémisme, ils nécessiteront un accompagnement psychologique et social pour se reconstruire. La société française, encore marquée par les attentats de 2015, observe ce procès avec attention, cherchant à comprendre comment des citoyens ordinaires ont pu basculer dans l’horreur.
Ce rendez-vous judiciaire, au croisement de l’histoire personnelle et collective, promet des débats intenses. Les réponses apportées par la cour d’assises spéciale pourraient éclairer les zones d’ombre de la radicalisation et offrir une forme de justice aux victimes des actions de l’État Islamique.