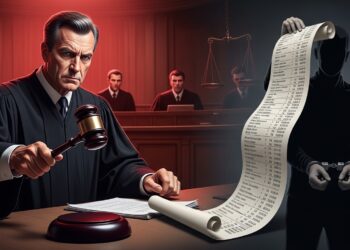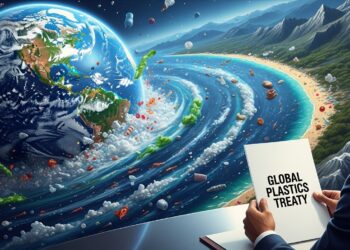Une simple photo peut-elle déclencher une tempête numérique ? En août 2025, une image déchirante d’une fillette dénutrie à Gaza a enflammé les réseaux sociaux, non pas seulement pour son contenu tragique, mais pour les erreurs d’une intelligence artificielle censée en vérifier l’origine. Ce cas révèle une question brûlante : peut-on réellement confier la vérité à des machines ? Dans un monde où la désinformation prospère, les chatbots comme celui intégré à une plateforme sociale bien connue promettent de clarifier les faits, mais leurs erreurs peuvent aggraver la confusion.
Quand l’IA se trompe sur une crise humanitaire
Le 2 août 2025, une image bouleversante circule sur les réseaux sociaux. Elle montre une fillette de 9 ans, pesant à peine 9 kilos, dans les bras de sa mère à Gaza. Prise par un photojournaliste, cette photo illustre la malnutrition sévère qui frappe la région, menacée selon l’ONU par une famine généralisée. Pourtant, lorsqu’un utilisateur demande à un chatbot conversationnel d’en vérifier l’origine, la réponse est catégorique : l’image daterait de 2018 et aurait été prise au Yémen. Cette affirmation, rapidement relayée, accuse à tort un député français de désinformation.
La réalité est tout autre. La fillette, Mariam, vit à Gaza. Sa mère explique qu’elle ne reçoit que du lait, souvent indisponible, pour se nourrir. Cette erreur d’identification n’est pas anodine : elle illustre les limites des technologies que nous utilisons pour trier le vrai du faux dans un contexte de crise humanitaire.
Les chatbots : des outils à double tranchant
Les chatbots conversationnels, conçus pour répondre rapidement à des questions complexes, séduisent par leur accessibilité. Mais leur fonctionnement repose sur des algorithmes opaques, souvent qualifiés de boîtes noires. Comme l’explique Louis de Diesbach, chercheur en éthique des technologies :
On ne sait pas précisément pourquoi ils donnent telle ou telle réponse, ni comment ils priorisent leurs sources.
Louis de Diesbach, expert en éthique technologique
Cette opacité est au cœur du problème. Les chatbots s’appuient sur des bases de données massives, mais leurs réponses dépendent aussi de leur alignement, c’est-à-dire des instructions données par leurs créateurs pour définir ce qui constitue une réponse acceptable. Dans le cas de l’image de Gaza, le chatbot a privilégié une source erronée, confondant la photo avec une autre prise au Yémen sept ans plus tôt.
Des biais ancrés dans les données
Pourquoi une IA se trompe-t-elle ainsi ? La réponse réside dans ses données d’entraînement. Ces ensembles de données, souvent gigantesques, contiennent des informations collectées sur le web, mais elles peuvent inclure des erreurs ou des biais. Par exemple, une photo mal légendée dans une base de données peut induire en erreur un modèle d’IA, qui reproduira cette faute sans la remettre en question.
De plus, l’alignement des modèles joue un rôle crucial. Les concepteurs définissent des priorités qui peuvent refléter des partis pris idéologiques. Dans le cas du chatbot impliqué, certains observateurs notent une tendance à refléter les vues de son créateur, connu pour ses positions controversées. Cette influence peut orienter les réponses, même involontairement, et fausser la vérification des faits.
Les biais en chiffres :
- 80 % des erreurs d’IA proviennent de données d’entraînement biaisées ou incomplètes.
- 60 % des utilisateurs font confiance aux chatbots pour des vérifications factuelles.
- Seulement 10 % des réponses d’IA sont vérifiées manuellement par des experts.
Un rôle mal adapté pour les IA
Demander à un chatbot de vérifier l’origine d’une image, c’est le sortir de son domaine de compétence. Contrairement à un moteur de recherche, qui indexe des informations brutes, un modèle de langage comme un chatbot est conçu pour générer des réponses plausibles, pas nécessairement exactes. Louis de Diesbach résume cette idée :
Un modèle de langage ne cherche pas à créer des choses exactes, ce n’est pas le but.
Louis de Diesbach
Cette distinction est essentielle. Les chatbots excellent pour produire du texte fluide ou répondre à des questions générales, mais leur usage pour des tâches précises comme la vérification d’images reste risqué. Dans le cas de la photo de Mariam, l’IA a extrapolé à partir de données similaires, sans pouvoir confirmer l’exactitude de sa réponse.
Un problème récurrent
L’erreur sur la photo de Gaza n’est pas un cas isolé. Une autre image, prise en juillet 2025 dans la même région, a également été mal identifiée par le même chatbot, qui l’a située au Yémen en 2016. Cette répétition des erreurs montre une limite fondamentale : même après correction, un chatbot peut reproduire la même faute si ses données d’entraînement ou son alignement n’ont pas été modifiés.
Ce phénomène touche d’autres IA. Par exemple, un autre agent conversationnel, interrogé sur la même photo, a également conclu à tort qu’elle venait du Yémen. Ces erreurs en série soulignent un problème systémique : les IA ne sont pas des outils fiables pour la vérification des faits, surtout dans des contextes sensibles comme les crises humanitaires.
Les conséquences de la désinformation amplifiée
Les erreurs des chatbots ont des répercussions concrètes. Dans le cas de la photo de Gaza, les fausses informations relayées par l’IA ont conduit à des accusations de manipulation contre un député et un journal. Ces malentendus nuisent à la crédibilité des acteurs impliqués et détournent l’attention des véritables enjeux, comme la malnutrition à Gaza.
Pour les utilisateurs, ces erreurs érodent la confiance envers les outils numériques. Si une IA peut se tromper aussi gravement, comment distinguer le vrai du faux ? Cette question est d’autant plus pressante dans un contexte où la désinformation se propage rapidement sur les réseaux sociaux.
| Problème | Impact | Solution potentielle |
|---|---|---|
| Biais des données | Erreurs répétées dans les réponses | Améliorer la qualité des données d’entraînement |
| Alignement idéologique | Réponses influencées par les créateurs | Transparence dans les processus d’alignement |
| Usage inapproprié | Réponses non fiables pour vérifications | Éduquer les utilisateurs sur les limites de l’IA |
Comment éviter le piège de l’IA ?
Pour contourner les limites des chatbots, les experts recommandent de privilégier des sources primaires, comme les rapports d’organisations internationales ou les témoignages de photojournalistes. Les utilisateurs doivent aussi adopter une approche critique, en croisant les informations fournies par les IA avec d’autres sources fiables.
Voici quelques conseils pratiques pour vérifier une information :
- Vérifiez l’auteur ou la source de l’image.
- Consultez des bases de données d’images vérifiées.
- Méfiez-vous des réponses automatiques des chatbots.
- Comparez avec des rapports d’organisations comme l’ONU.
Enfin, il est crucial de sensibiliser le public aux limites des IA. Comme le souligne Louis de Diesbach, un chatbot est comme un ami mythomane : il ne ment pas toujours, mais il peut le faire à tout moment. Cette métaphore illustre bien le danger de s’en remettre aveuglément à ces outils.
Vers une IA plus fiable ?
Améliorer la fiabilité des chatbots nécessiterait des avancées dans plusieurs domaines. D’abord, les données d’entraînement doivent être nettoyées et diversifiées pour réduire les biais. Ensuite, les processus d’alignement doivent devenir plus transparents, permettant aux utilisateurs de comprendre comment une réponse est générée. Enfin, les concepteurs doivent clarifier les limites de leurs outils, en insistant sur leur incapacité à remplacer une vérification humaine rigoureuse.
En attendant, les utilisateurs doivent rester vigilants. Une IA peut être un outil puissant, mais elle n’est pas infaillible. Dans un monde où une simple photo peut devenir un terrain de bataille informationnel, la prudence reste de mise.