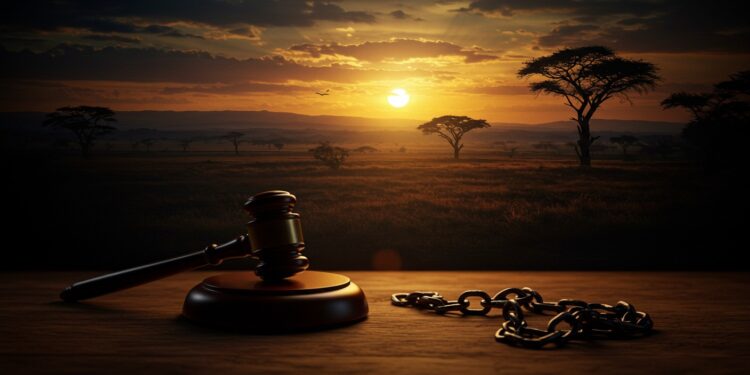Imaginez-vous arrêté dans une capitale étrangère, accusé sans preuves claires, et soumis à des traitements inhumains, simplement pour avoir voulu assister à un procès. C’est l’histoire bouleversante de deux militants des droits humains, un Kényan et une Ougandaise, qui ont vécu un cauchemar en Tanzanie. Leur combat pour la justice, porté devant la Cour de justice de l’Afrique de l’Est (EACJ), soulève des questions brûlantes sur la protection des droits dans la région. Cet article plonge dans les détails de cette affaire, explore ses implications et interroge le rôle des gouvernements face à de telles violations.
Une affaire qui secoue l’Afrique de l’Est
Le 19 mai, à Dar es Salaam, capitale économique de la Tanzanie, deux militants des droits humains, Boniface Mwangi (Kénya) et Agather Atuhaire (Ouganda), ont été arrêtés alors qu’ils tentaient d’assister au procès d’un leader de l’opposition tanzanienne, accusé de trahison. Ce qui devait être une simple observation d’un procès s’est transformé en une expérience traumatisante marquée par des allégations de torture et d’agressions sexuelles par les forces de l’ordre tanzaniennes. Cette affaire ne concerne pas seulement ces deux individus : elle met en lumière les défis auxquels sont confrontés les défenseurs des droits humains dans la région.
Un recours historique devant l’EACJ
Face à ces graves accusations, les deux militants, accompagnés de sept autres plaignants, dont une organisation kényane de défense des droits humains, ont décidé de porter l’affaire devant la Cour de justice de l’Afrique de l’Est, basée en Tanzanie. Leur plainte vise non seulement le gouvernement tanzanien, mais aussi les gouvernements kényan et ougandais, ainsi que le secrétaire général de la Communauté d’Afrique de l’Est (EAC). Ils reprochent aux autorités de ne pas avoir protégé leurs citoyens et d’avoir manqué à leurs obligations diplomatiques pour garantir leur sécurité.
« Lorsqu’un État devient voyou, la loi doit intervenir pour protéger ses victimes. »
Boniface Mwangi, militant kényan
Les plaignants dénoncent des disparitions forcées, des actes de torture, des détentions arbitraires et une expulsion illégale. Ils exigent des excuses publiques, une indemnisation d’un million de dollars par personne (environ 860 000 euros) et une condamnation officielle des actes par l’EAC. Cette démarche constitue un précédent important, car elle met en cause la responsabilité collective des États membres de l’EAC face aux violations des droits humains.
Les accusations : torture et répression
Les allégations des militants sont graves. Selon leurs témoignages, les forces de l’ordre tanzaniennes les ont soumis à des traitements inhumains lors de leur détention. Boniface Mwangi, connu pour son engagement au Kénya, a décrit des actes visant à « réduire au silence » les voix dissidentes. Agather Atuhaire, une militante ougandaise respectée, a également dénoncé des agressions sexuelles, ajoutant une dimension particulièrement troublante à cette affaire.
Le contexte de leur arrestation est tout aussi préoccupant. Ils étaient à Dar es Salaam pour soutenir un leader de l’opposition poursuivi pour trahison, une accusation passible de la peine de mort en Tanzanie. Ce procès, qui attire l’attention internationale, intervient dans un climat politique tendu, alors que des élections législatives et présidentielles approchent. La présidente tanzanienne, Samia Suluhu Hassan, est sous le feu des critiques pour une supposée intensification de la répression contre l’opposition.
Les militants affirment que leur arrestation n’était pas un incident isolé, mais une tentative délibérée de museler les défenseurs des droits humains dans la région.
Un contexte politique explosif
La Tanzanie, souvent perçue comme un modèle de stabilité en Afrique de l’Est, traverse une période de turbulences politiques. Avec des élections prévues cette année, la répression des voix dissidentes semble s’intensifier. Les militants arrêtés à Dar es Salaam ne sont pas les seuls à faire face à des obstacles. D’autres défenseurs des droits humains et membres de l’opposition signalent des intimidations, des arrestations arbitraires et des restrictions de leurs libertés fondamentales.
Dans ce contexte, la plainte déposée devant l’EACJ prend une dimension symbolique. Elle ne se limite pas à demander justice pour deux individus, mais vise à établir un précédent pour la protection des droits humains dans toute la région. Les plaignants espèrent que leur action encouragera d’autres victimes à s’exprimer et à demander réparation.
« Nous espérons que cette affaire donnera à davantage de victimes de l’État le courage de s’exprimer et d’obtenir justice. »
Boniface Mwangi
Les réactions des gouvernements
Face à ces accusations, le silence des autorités tanzaniennes est assourdissant. Malgré plusieurs demandes de clarification, le gouvernement n’a pas encore répondu officiellement. De son côté, le gouvernement kényan n’a pas non plus réagi dans l’immédiat, laissant planer des doutes sur son engagement à protéger ses citoyens à l’étranger.
En Ouganda, un porte-parole du gouvernement a pris la parole, adoptant une position prudente. Il a reconnu que chaque citoyen d’Afrique de l’Est a le droit de demander justice, mais a insisté sur la nécessité de preuves solides pour étayer les accusations. Il a également rappelé la souveraineté de la Tanzanie, un argument qui pourrait compliquer la coopération régionale dans cette affaire.
| Pays | Rôle dans l’affaire | Réaction officielle |
|---|---|---|
| Tanzanie | Accusée de torture et détention | Aucune réponse officielle |
| Kénya | Pays d’origine d’un plaignant | Silence officiel |
| Ouganda | Pays d’origine d’un plaignant | Réponse prudente, demande de preuves |
Les enjeux régionaux
Cette affaire dépasse les frontières de la Tanzanie. Elle met en lumière les défis auxquels est confrontée la Communauté d’Afrique de l’Est dans son ensemble. L’EAC, qui regroupe des pays comme le Kénya, l’Ouganda, la Tanzanie, le Rwanda, le Burundi, le Soudan du Sud et la République démocratique du Congo, a pour mission de promouvoir la coopération régionale, y compris dans le domaine des droits humains. Pourtant, les tensions politiques et les différences dans la gouvernance des États membres compliquent souvent l’application de ces principes.
Les plaignants reprochent aux gouvernements kényan et ougandais de ne pas avoir suffisamment agi pour protéger leurs citoyens. Cette inaction soulève des questions sur la solidarité régionale et la capacité des États à collaborer face à des violations des droits humains. Si l’EACJ tranche en faveur des plaignants, cela pourrait renforcer la confiance dans les institutions régionales. À l’inverse, un échec pourrait affaiblir la crédibilité de l’EAC.
Un précédent pour l’avenir
Le recours à l’EACJ est une démarche audacieuse. En s’attaquant directement aux gouvernements et à l’EAC elle-même, les plaignants envoient un message clair : personne ne devrait être au-dessus des lois, pas même les États. Leur combat pourrait inspirer d’autres victimes de violations des droits humains à demander justice, non seulement en Tanzanie, mais dans toute la région.
Pour Boniface Mwangi et Agather Atuhaire, cette affaire est personnelle, mais elle porte également une dimension universelle. En dénonçant publiquement leur calvaire, ils espèrent briser le silence qui entoure souvent les abus de pouvoir. Leur courage face à l’adversité est un rappel puissant que la lutte pour les droits humains reste un combat de tous les instants.
Points clés de l’affaire :
- Arrestation de deux militants à Dar es Salaam le 19 mai.
- Accusations de torture et d’agressions sexuelles par la police tanzanienne.
- Plainte déposée contre trois gouvernements et le secrétaire général de l’EAC.
- Demande d’indemnisation d’un million de dollars par plaignant.
- Contexte politique tendu à l’approche des élections en Tanzanie.
Vers une justice régionale ?
Alors que l’affaire progresse devant l’EACJ, tous les regards sont tournés vers cette institution. Sa décision pourrait avoir des répercussions majeures, non seulement pour les plaignants, mais pour l’avenir de la justice régionale. Une condamnation des gouvernements impliqués enverrait un signal fort : les violations des droits humains ne peuvent rester impunies, même dans des contextes politiques complexes.
En attendant, les militants continuent de plaider pour la vérité. Leur histoire, bien que douloureuse, est un appel à l’action. Elle nous rappelle que la défense des droits humains est un combat universel, qui transcende les frontières et unit ceux qui croient en la justice.
Que réserve l’avenir pour cette affaire ? L’EACJ parviendra-t-elle à rendre justice aux victimes ? Et surtout, cette plainte marquera-t-elle un tournant dans la lutte contre la répression en Afrique de l’Est ? Une chose est sûre : cette histoire est loin d’être terminée.